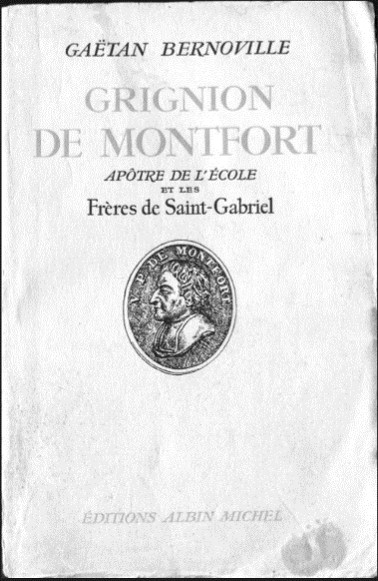Bernoville
Life
Testo corretto- Bernoville
Note a la Lecture de Bernoville
00 Avertissement - Introduction 1-12
01 Parte I chap I pp 13-69
02 Parte I chap II pp 70-112
03 Partie II chap I pp 113-147
04 Partie II chap II pp 148-173
05 Partie II chap III pp 173-209
06 Partie III chap I pp 210-239
07 Partie III chap II pp 240-265
08 Partie IV chap I pp 267-306
09 Partie IV chap II pp 307-334
10 Partie IV chap III pp 335-358
11 Conclusion 359-366
12 Tables
13 pp mancanti 205 e 206
GAËTAN BERNOVILLE
GRIGNION DE MONTFORT
APÔTRE DE L'ÉCOLE
et les
Frères de
Saint-Gabriel
ÉDITIONS
ALBIN MICHEL
22, Rue
Huyghens, PARIS (14e)
Droits de
traduction et reproduction
réservés
pour tous pays.
Copyright
1946, by Albin Michel
AVERTISSEMENT. 4
INTRODUCTION.. 5
PREMIERE PARTIE. 8
LE FONDATEUR. 8
I - VIE DE GRIGNION DE MONTFORT. 9
L'Enfance. 9
Le Collège. 11
La vocation. 13
Le Séminaire. 15
Entre Nantes et Poitiers. 19
Aumônier à l’hôpital de Poitiers. 22
Séjour à Paris. 24
Derechef Poitiers. 25
Rome. 26
Au seuil du grand œuvre. 28
A Nantes. 30
Dans les diocèses de La Rochelle et de Luçon. 35
La méthode missionnaire de Montfort. 39
Quelques traits de l'homme et du saint. 40
Procession organisée par M. de Montfort a La Rochelle, le 16 août 1711, au
cours de la mission des femmes. 45
II - L'APOTRE DE L'ÉCOLE. 47
Au séminaire de Saint-Sulpice. 48
L'école de l'hôpital de Poitiers. 51
Les premiers Frères. 54
Les Frères et l’Ecole. 60
Les écoles de La Rochelle. 63
Les Frères enseignants et les projets de M. de Montfort. 68
Mort de M. de Montfort. Ses suprêmes volontés. 71
DEUXIÈME PARTIE. 75
HISTOIRE DES FRÈRES DE L'INSTRUCTION CHRÉTIENNE DU SAINT-ESPRIT. 75
DITS AUJOURD'HUI DE SAINT-GABRIEL. 75
I - DE LA MORT DU P. DE MONTFORT A LA MORT DU P. DESHAYES (1716-1841) 75
II - LA CRISE INTÉRIEURE (1841-1875) 97
III - DÉVELOPPEMENT DE L'INSTITUT (1842 à 1935) 114
TROISIEME PARTIE. 138
L'ESPRIT DE SAINT-GABRIEL. 138
I - LA REGLE. 139
II - FORMATION RELIGIEUSE ET CULTURE INTELLECTUELLE. 157
QUATRIEME PARTIE LES ŒUVRES EN FRANCE ET A L'ETRANGER. 175
I - LES AMES DÉLIVRÉES. 175
II - UN PENSIONNAT RÉGIONAL : A SAINT-LAURENT-SUR-SÈVRE. 201
III - L'INSTITUT A L'ÉTRANGER. LE CANADA. 220
CONCLUSION.. 236
TABLES. 241
TABLE DES ILLUSTRATIONS. 241
TABLE DES MATIERES. 242
AVERTISSEMENT
Ces pages ont été
écrites dans le temps de la plus grande misère des transports. Les difficultés
de transports ne m'ont pas permis de me rendre compte autant que je l'aurais
voulu, du fonctionnement actuel des petites écoles gabriélistes dès pays
d'Ouest, par cette méthode de l’enquête directe et sur place que je mets, pour
ma part, quand elle est possible, au-dessus de toute autre forme de
documentation. Cette lacune sera, je l’espère, comblée en une édition
ultérieure.
Pour la même raison, le
tableau, tracé ici, de l’activité de l’Institut de Saint-Gabriel à l'étranger
reste bien sommaire et bien sec. Depuis le début de la guerre, la Maison-Mère
ignore ce qui s'est passé dans ses postes lointains ou ne le sait que par
bribes. Je n'ai pu joindre aucun Frère susceptible de me donner sur leur état
actuel une information vivante, sauf, en coup de vent, un Frère du Canada.
Dans ces limites,
imposées par les circonstances, j'ai travaillé sur ce que j'ai vu et entendu.
Les quelques portraits que, de-ci de-là, j'ai tracés sont ceux de Frères que
j'ai le plus fréquentés. Il en est bien d'autres, dans les diverses provinces
de l'Institut, celle dé l’Ouest comprise, dont la personnalité est éminente, le
rôle et l’influence aussi considérables. Du moins pourra-t-on discerner, dans
mes quelques portraits, dessinés, je crois, d'un crayon fidèle, avec des caractéristiques
individuelles que la Règle n'étouffe pas mais dirige, les traits majeurs d'un
esprit commun.
N'ayant à traiter, après
Grignion de Montfort, que des Frères de Saint-Gabriel, je n'ai parlé qu'incidemment
des Filles de la Sagesse qu'il fonda aussi. Je le regrette d'autant plus
qu'elles sont, dans l'enseignement des sourds-muets, des aveugles et
sourds-muets-aveugles, les répondantes, pour ce qui est des filles, de ce que
font les Frères de Saint-Gabriel pour les garçons. Par ailleurs, engagées
profondément par Montfort dans l'œuvre scolaire, elles ont après sa mort
magnifiquement développé, en ce qui relève d'elles, cette forme de son
apostolat. Je souhaite que cela soit dit par d'autres avec l’ampleur qui
s'impose.
Je dois enfin signaler
que j’ai pu largement disposer, en ce qui concerne Montfort et son œuvre, de
son vivant, de la documentation des Frères de Saint-Gabriel, et, notamment, de
la magistrale étude du S. E. le cardinal Tisserand sur leur origine montfortaine.
Il n'en a pas été de même chez les Pères de la Compagnie de Marie, ni chez les
Filles de la Sagesse, où je n'ai pu obtenir communication de certains documents
originaux de grande importance. Comment ne pas le regretter ?... J'ai, du
moins, étudié avec soin les livres et brochures publiés par les Pères de la
Compagnie de Marie, ou sous leur égide, sur le même sujet. G.
B.
INTRODUCTION
La vie de Grignion de
Montfort a été écrite, à ma connaissance, vingt-cinq fois; elle le sera encore
sans jamais être épuisée. Cet apôtre prestigieux des masses populaires, ce
fondateur de trois grandes familles religieuses, cet entraîneur d'âmes dont
l'influence fut si profonde que, mort à quarante-trois ans, au seuil du xviiie siècle, nos pays
d'Ouest vivent encore de ses surnaturelles consignes, se présente à notre
esprit avec une telle abondance de dons, une personnalité si originale et si puissante,
une si dynamique alliance de la nature et de la surnature, des méthodes de
conversion parfois si déconcertantes et toujours, cependant, d'une si durable efficacité
que les portraits, même les plus fidèles au modèle, pourront longtemps se
succéder sans faire double emploi. Au reste, ceux que nous possédons sont-ils complets
? Loin de là.
Un aspect notamment, et
non des moindres, de son apostolat multiforme, a été soit passé sous silence,
soit à peine mentionné. Une ombre persiste, que je voudrais ici dissiper, sur
cette fonction d'instituteur qu'il a exercée, puis transmise, parmi ses
disciples, aux Frères pour faire l'Ecole charitable, appelés, après sa mort,
les Frères de l'instruction chrétienne du Saint-Esprit, puis les Frères de
Saint-Gabriel. Or ce fut là une de ses grandes pensées, une de ses tâches
maîtresses. Des documents inédits, aussi nombreux qu'importants, permettent
aujourd'hui de jeter un faisceau de lumière sur ce Montfort presque inconnu.
Ce n'est pas un autre
Montfort que celui des Missions : c'est le même. Quand il fonde des écoles charitables
et des Frères pour les tenir, le mouvement qui l'y pousse est de même portée et
de même incandescence que celui qui le jette à ses missions, lui fait chercher
des collaborateurs missionnaires, l'entraîne à servir amoureusement les pauvres
ou à soigner les malades. Un seul texte, parmi d'autres analogues, suffit à
rendre compte de tout lui-même.
« Qui seront — écrit-il
de ceux qu'il nomme les Apôtres des derniers Temps — ces serviteurs esclaves et
enfants de Marie ?
« Ce seront un feu
brûlant ; des ministres du Seigneur qui mettront le feu de l'amour divin
partout... Ce seront, sicut sagittæ in
manu potentis, des flèches aiguës dans la main de la puissante Marie pour
percer ses ennemis... Ce seront des enfants de Lévi, bien purifiés par le feu
des grandes tribulations et bien collés à Dieu, qui porteront l'or de l'amour
dans le cœur, l'encens de l'oraison dans l'esprit et la myrrhe de la
mortification dans le corps et qui seront partout la bonne odeur de
Jésus-Christ aux pauvres et aux petits, tandis qu'ils seront une odeur de mort
aux grands, aux riches et orgueilleux mondains.
« Ce seront des nuées
tonnantes et volantes par les airs au moindre souffle du Saint-Esprit, qui sans
s'attacher à rien, ni s'étonner de rien, ou se mettre en peine de rien,
répandront le génie de la parole de Dieu et de la vie éternelle; ils tonneront
contre le péché, ils gronderont contre le monde, ils frapperont le diable et
ses suppôts, et ils perceront d'outre en outre, pour la vie ou pour la mort,
avec leur glaive à deux tranchants de la parole de Dieu, tous ceux auxquels ils
seront envoyés de la part du Très-Haut...
« Enfin, nous savons que
ce seront de vrais disciples de Jésus-Christ, marchant sur les traces de sa
pauvreté, humilité, mépris du monde et charité, enseignant la voie étroite de
Dieu dans la pure vérité, selon le saint Evangile, et non selon les maximes du
monde, sans se mettre en peine, ni faire acception de personne, sans épargner,
écouter, ni craindre aucun mortel, quelque puissant qu'il soit...
« Voilà de grands hommes
qui viendront, mais que Marie fera par ordre du Très-Haut, pour étendre son
empire sur celui des impies, idolâtres et mahométans. Mais quand et comment
cela sera-t-il ? Dieu seul le sait ; c'est à nous de nous taire, de prier,
soupirer et attendre. Exspectans
exspectavi...[1]
»
Tel est le feu dont
Montfort fut incendié. Son âme y était toute rassemblée et effervescente comme
au centre d'un volcan. Nul doute qu'il ne vise expressément les prêtres dont il
fera sa Compagnie de Marie puisqu'il les voit « au milieu des autres prêtres,
ecclésiastiques et clercs. » Mais ses Frères enseignants, eux aussi, il les a
voulus tendus vers cet idéal, car ils sont également des missionnaires dont la
tâche propre est d'assurer à la prédication une efficacité durable. Verba volant, les paroles s'envolent,
mais quand le prédicateur, au terme de plusieurs jours de mission, lève sa
tente, il laisse derrière lui l'Ecole, mission permanente, l'instituteur,
missionnaire quotidien. Nul n'a mieux saisi que Montfort la précarité d'une mission
prêchée que rien ne prolongerait, ni n'a cherché davantage à lui faire pousser
dans les âmes de profondes racines par le moyen d'institutions stables, confréries
ou autres, mais surtout écoles. Pour celles-ci, il a voulu des instituteurs qu'animât
l'esprit missionnaire, compris et vécu à sa manière ignescente.
Le sublime de leur fonction
s'égale à celui des prédicateurs, s'il ne le surpasse. L'enfance est chérie du
Christ. Nulle substance plus pure, plus délicate et plus belle ne s'offre aux
formateurs d'âmes. Elle est aussi le terme spirituel auquel l'Evangile provoque
celui qui cherche le royaume de Dieu. C'est par cette neige immaculée qu'est
sans cesse recouverte et sollicitée à la purification et au redressement une
humanité pourrie par le péché. On ne peut douter du salut du monde tant que
l'enfant est là. Montfort, qui n'a rien pensé ni fait médiocrement, a vu
l'école sous cet angle et ceux qui « font l'école », il ne les souhaite autrement
que ces apôtres des derniers temps qu'il a dessinés en traits de feu.
L'idéal montfortain de
l'école s'impose à nous avec une force singulière en cette époque tourmentée et
anxieuse de notre histoire où le problème scolaire prend une acuité prépondérante
— tout l'avenir français dépendant en fin de compte de l'éducation qui sera
donnée à l'enfant. Comment ne pas souhaiter que les éducateurs chrétiens,
conscients du danger qui, de toutes parts, les presse, fassent passer en eux
cette âme brûlante dont Montfort a animé ses créations scolaires et leurs
premiers ouvriers ? La conjonction est saisissante de l'actualité de l'école et
de celle que suscite la prochaine canonisation de Montfort. Le hasard, disait
Léon Bloy, n'existe pas.
Tout étant, chez
Montfort, d'un seul tenant et ses fondations comme son apostolat procédant
d'une même pensée, c'est par tout l'homme et toute l'œuvre, connus au moins
dans leurs lignes essentielles, que l'apôtre de l'école s'éclaire, s'explique
et se définit. Et de même il faut avoir vu cette âme exceptionnelle en action
sur les plans divers où elle a mené sa course pour s'assurer de quelle trempe
il a voulu ces Frères qui ont vécu durant plus de deux siècles et vivent encore
aujourd'hui de son esprit.
Novembre 1945.
PREMIERE
PARTIE
LE
FONDATEUR
I - VIE DE GRIGNION DE MONTFORT
L'Enfance.
Louis Grignion naquit le
31 janvier 1673, à Montfort-la-Cane[2],
non loin de Rennes. Il était l'aîné d'une famille qui, en vingt ans, devait
compter dix-huit enfants du même lit[3].
De pareilles tribus ne s'entretiennent pas sans difficultés ; celles que rencontrait
Jean-Baptiste Grignion, père de Louis, étaient extrêmes. Il était « homme noble
», possesseur de « terres nobles », « avocat au bailliage de Montfort et au
Parlement de Bretagne ». Mais « homme noble » n'était pas alors autre chose que
bourgeois roturier, soumis à la taille et d'ailleurs, ces titres, apparemment
pompeux, doraient fort mal une médiocrité de fortune qui tournait à la gêne. Si
furieusement procédurière que fût la gent bretonne, elle avait encore trop
d'avocats pour ses causes. En fait, la famille Grignion subsistait, vaille que
vaille, sur ses champs plus que sur les grimoires. Son chef en prenait fort mal
son parti ; de tempérament sanguin, puissant, il témoignait d'une aigreur
continue, traversée d'éclats, dont pâtissait fort Mme Grignion. Mais cette
chrétienne exemplaire était sans cesse appliquée à se tasser sans murmures, et
fort exactement, dans l'ombre de son mari. Les tracas d'argent sont la pire
peine des ménages : mal supportés, comme faisait Jean-Baptiste, ils créent une
accablante atmosphère. Mme Grignion s'appliquait à faire aimer de ses enfants
Dieu et la Vierge Marie ; pour le reste, elle priait et souffrait en silence.
En 1675, comme Louis
allait avoir trois ans, son père s'avisa que, décidément, la profession
d'avocat le jetait en trop d'embarras et que mieux valait s'en remettre à la
terre, et à elle seule, du soin de les nourrir, lui et les siens. Il acquit
dans la région le manoir du Bois-Marquer, sis en la commune d'Effendic, avec
les deux fermes du Plessix et de la Chesnaie [4].
Il n'y avait point
d'école à Effendic. Les rudiments de l'instruction durent donc être dispensés à
l'enfant par ses parents jusqu'à l'âge de douze ans où il entra au collège.
L'ambiance de son
enfance fut donc rurale et bretonne-bretonnante. Les splendeurs du règne de
Louis XIV expiraient au seuil de la Bretagne champêtre, terre hostile et
d’instincts hérissés contre tout ce qui pouvait menacer son farouche amour de
l'indépendance et son être propre. Louis est un petit gars de la vieille et
rude Armorique, au surplus bien fait, par la constitution exceptionnellement
robuste qu'il tient de son père, pour jouir de ses forces neuves parmi les
champs et les bois. De son père aussi, il tient une humeur naturellement
violente, à l'unisson du chant vigoureux de son sang. Mais au lieu de
l'épancher, comme Jean-Baptiste, en propos atrabilaires, il la tourna, dès ses
plus tendres années, à se mater, au point de paraître le plus doux des enfants,
mais cette douceur était la conquête d'une énergie singulièrement précoce. La
force est sa marque ; elle eût pu en faire un aventurier d'envergure ; elle en
fera, Dieu seul l'attirant, un fougueux ascète.
Si jeune, il se
manifestait tout habité de Dieu, par ses longs recueillements et ses prières ferventes.
Au centre de son âme croissait, comme un beau lis, sa dévotion à la Vierge
Marie. Il écoutait parler d'elle inlassablement et ne passait point un jour
sans réciter le chapelet. C'est de lui-même qu'il désira joindre à son nom
celui de Marie, affirmant ainsi, dès sa prime jeunesse, cette appartenance
singulière et sublime à la Mère de Dieu qui sera l'axe de sa doctrine et de sa
vie. Aimable et tendre, il s'ingéniait à consoler Mme Grignion, souvent
désemparée par le passage en cyclone des colères paternelles. A l'égard de ses
parents, il était d'une parfaite docilité, alors que l'ardeur de son
tempérament et l'originalité marquée de son caractère l'inclinaient
naturellement à l'indépendance. L'apôtre qu'il devait devenir se révélait par un
prosélytisme précoce à l'égard de ses petite camarades, de ses frères et sœurs,
de l'une de celles-ci surtout — sa préférée, parce qu'elle avait mêmes goûts,
même piété que lui. Elle était de sept ans plus jeune ; son nom de baptême
était Guyonne mais très vite elle fut appelée Louise, sans doute à cause de sa
conformité de sentiments et de nature avec son frère. Pour l'entraîner à ses
pratiques religieuses coutumières, et particulièrement à la récitation du
chapelet, Louis-Marie se faisait délicieusement ingénieux. Quand il éprouvait quelque
peine à lui faire quitter ses jeux, il lui donnait un petit cadeau, puis : « Ma
chère sœur, disait-il, vous serez toute belle et tout le monde vous aimera si
vous aimez Dieu. » Admirons cet adroit appel à l'éternel féminin, déjà discerné
par le garçon de dix à onze ans, déjà embusqué dans la petite fille de quatre
ou cinq. Il atteignait si bien son but que Louise à son tour entreprenait ses
compagnes et toutes, de concert, ronronnaient leurs dizaines. Et Louis-Marie
exultait que Marie, Mère de Dieu, fût ainsi louée.
Le
Collège.
Cet enfant, dont on
admirait la vive intelligence et l'imagination ardente, comment le laisser
étioler ses facultés intellectuelles au Bois-Marquer ? On l'envoya au collège
des Jésuites à Rennes. Qu'on ne l'imagine pas, passant ainsi de l'intimité du
foyer familial à la serre close d'un pensionnat, celui-ci jalousement préservé,
comme celui-là, des bruits et dangers de la ville. Les collèges des Jésuites
étaient alors de vastes externats, des sortes de facultés secondaires, dont
l'enseignement rassemblait, comme c'était le cas à Rennes, jusqu'à deux mille
élèves. Gratuits, ils groupaient toutes les classes sociales, les pauvres comme
les riches. Après les cours, cette foule de jeunes étudiants se répandait dans
la ville, où elle jouissait d'une liberté que le règlement du collège
n'atteignait pas. Cette liberté se faisait parfois licence, chez la plupart;
elle s'exprimait alors en jeux bruyants, en farces souvent pendables, en
tumultes dont les gens du guet avaient à connaître. De 1685, année de son
entrée au collège, à 1690, Louis-Marie prit pension chez un brave homme
d'oncle, messire Alain Robert, sieur de la Viseule, prêtre-sacriste de l'église
Saint-Sauveur. En 1690, Jean-Baptiste Grignion vint, avec tous les siens,
s'installer à Rennes, sous le toit de messire Alain Robert, pour y mieux
assurer l'éducation de ses enfants. Louis-Marie vécut donc, dans l'intervalle
des classes, la vie de famille. Il n'en avait pas moins, sous les yeux, des
spectacles et des séductions dont les calmes campagnes du Bois-Marquer et les
rues engourdies de Montfort ne lui avaient même pas donné l'idée.
Or il défendit
magnifiquement son âme. D'abord par une dévotion croissante à la Vierge Marie ;
chaque jour, se rendant du collège chez lui, il la priait en trois églises qui
lui étaient dédiées. Il n'était pas une de ses démarches intimes qu'il ne
confiât à sa protection. A vivre ainsi dans le sillage de l'Immaculée, il se
garda dans une pureté immarcescible; à qui lui parlait des tentations contre la
pureté, il pouvait affirmer ne pas savoir ce que c'était. Ce témoignage est de
Blain, son condisciple et ami au collège de Rennes (en attendant de devenir son
admirateur, conseiller et biographe comme il le sera de saint Jean-Baptiste de
la Salle) Louis mortifiait ses sens. Nul penchant à l'ivresse de la vie, si
forte en cette période de l'adolescence, où la jeunesse agite tous ses grelots ;
il témoignait au contraire d'un goût marqué pour la plus austère pénitence. Par
là-dessus, une sérénité inaltérable. Il était l'image ambulante de la paix.
Les Jésuites ont eu
grande part dans son ascension spirituelle. Il trouva parmi les professeurs du
collège des guides dignes de lui : un P. Gilbert, régent de rhétorique, un des
nombreux saints non canonisée dont fourmille l'Eglise, à ce point macéré dans
l'ascétisme, qu'il supporta maintes foie l'outrage public de certains écoliers
libertins sans le moindre frémissement d'impatience ; un P. Descartes, neveu du
philosophe, psychologue attentif et délié et qui s'apparentait, par le tour
mystique de son esprit, à l'école du P. Lallement ; il était le directeur de
conscience de Louis-Marie ; le P. Gilbert, pour n'avoir été que son professeur,
ne semble pas avoir eu sur lui moindre influence. C'était le vrai pédagogue
chrétien, qui forme l'âme autant que l'intelligence. Il avait d'ailleurs la
charge d'entretiens spirituels aux élèves qui lui firent distinguer Louis-Marie
comme un être exceptionnellement appelé par les puissances d'en haut ; aussi
lui communiqua-t-il avec prédilection sa flamme apostolique. Une des gloires de
la Compagnie est d'avoir discerné un Montfort, dès ses origines, et, plus tard,
de l'avoir indéfectiblement soutenu.
Parmi les moyens dont
usaient les Jésuites en leurs collèges pour faire de leurs élèves des chrétiens
actifs et généreux, figuraient en première ligne les Congrégations. Elles ne
visaient point à faire ânonner aux enfants de pieux formulaires, mais à leur
donner le sens et le goût de la piété authentique. C'étaient aussi des
associations d'action charitable dont les membres consacraient leurs loisirs à
soulager les infortunes de la ville. Entré dans la « grande Congrégation »,
celle de la Sainte Vierge, Louis-Marie se donna à ces pratiques généreuses avec
d'autant plus de conviction que sa vie intérieure était déjà largement aérée
par le souffle de l'apostolat. Il avait quêté bien souvent, pour des camarades
pauvres, dont certains, pour assurer leur subsistance, servaient de domestiques
à leurs condisciples plus aisés. Il s'était d'autre part enrôlé dans une équipe
d'écoliers, groupés par l'aumônier de l'hôpital général, M. Bellier, et qui,
soit à l'hôpital général lui-même, soit à l'hospice des Incurables, visitaient
les infirmes et les malades, les servaient, leur enseignaient le catéchisme, ou
leur faisaient quelque lecture. Ne voyons pas là, dans la vie de Louis-Marie,
un pieux exercice quelconque, car il s'y est allumé une flamme inextinguible
qui fera de lui un des plus grands amoureux qui aient jamais existé de la
divine Pauvreté. Dans ces hôpitaux de Rennes, le jeune Breton a rencontré le
Pauvre, cet autre Jésus-Christ. C'est une date dont toute sa vie retentira.
A Rennes encore, s'est
façonné en lui l'Humaniste, et un Humaniste de grande lignée. On n'a guère de
détails sur ses études, sur les matières notamment qui eurent sa prédilection,
alors que l'on sait par le menu les succès scolaires d'un de ses condisciples
plus jeune, Claude Poullart des Places, le futur fondateur de la Congrégation
du Saint-Esprit. Mais on n'ignore pas que Louis-Marie, élève remarquable,
enlevait brillamment tous les premiers prix. Par ailleurs, quels animateurs et
formateurs, en grammaire, humanités et rhétorique furent les Jésuites, cela est
bien connu. Or de tels maîtres, modeleurs de l'homme cultivé, quand ils tombent
sur un disciple de la qualité de Louis Grignion, ne manquent pas leur statue.
Au reste, les écrits de Montfort sont là qui témoignent de la manière dont
l'élève de Rennes profita d'un enseignement de premier ordre.
La
vocation.
Comme Louis-Marie
achevait sa philosophie, l'appel à une vie supérieure montait en lui, plus
pressant, tandis qu'augmentait son dégoût du monde des apparences et des joies
charnelles. C'est à la Vierge qu'il demandait, en longues et suppliantes
oraisons, de dénouer son destin. Or, au pied d'une image de la Madone, il eut,
certain jour, de sa vocation ecclésiastique une connaissance si claire que, sur
l'heure, sa décision fut prise. Malgré le mécontentement de son père qui, ayant
manqué sa carrière temporelle, entendait réussir au moins celle de son fils, il
commença ses études théologiques à Rennes ; les facultés complètes qu'étaient à
cette époque les collèges des Jésuites comportaient en effet l'enseignement des
sciences sacrées.
Mais se former au
sacerdoce dans une atmosphère qui ne fût pas de strict recueillement et de
règle religieuse lui pesait. A ce moment, passe dans sa vie une de ces vieilles
filles providentielles dont le dévouement souligne la nécessité de certains
célibats. Mlle de Montigny, Parisienne de passage à Rennes, parle, dans le
cercle de famille, du séminaire de Saint-Sulpice où s'opère à merveille la
réforme, tant désirée, du clergé. De Paris, elle écrit qu'elle paierait la
pension de Louis-Marie au séminaire. Sur quoi, on remet dix écus et un habit de
rechange au jeune homme qui, refusant un cheval qu'on lui offrait, part à pied
pour la capitale. Chemin faisant, il fait don à des mendiants de ses écus, puis
de son habit de rechange ; finalement, il troque celui qu'il portait sur lui
contre des guenilles et, ainsi nippé, se présente à Mlle de Montigny.
A ce tournant décisif,
voyons-le bien tel qu'il est et même tel qu'il sera, car les traits majeurs dont
étincelleront plus tard le Saint et l'Apôtre sont déjà fermement dessinée. Ce
jeune homme de vingt ans — nous sommes en 1693 — est déjà accompli en son être
profond. Le dévot de Marie, qui fait tout sous son signe, s'est révélé dès le
plus jeune âge ; auprès de Guyonne-Louise, de ses autres frères et sœurs, de
ses camarades de collège, le Missionnaire, avec son zèle dévorant, voire
dominateur, est apparu ; le saint est là aussi, avec sa pureté sans ombre, sa
mortification extrême, son humilité, sa soumission à la volonté divine, qui lui
est connue par Marie ; et encore l'ami incomparable du Pauvre, l'amant de la
Pauvreté qu'il ne lui suffit pas de porter en son cœur, qu'il veut réaliser
jusqu'en son accoutrement. Et dès que ce lui est possible, c'est-à-dire dès
qu'il est libre et seul, voilà qu'il coupe toutes les amarres, qu'il se sépare
violemment de ce qui, dans le monde, n'est pas de l'âme, se prive d'un coup de
toutes les manières ordinaires de subsister, se jette à corps perdu dans la
folie de la Croix. De plus en plus, il n'aura, et d'ores et déjà il n'a plus
d'autre logique dans sa vie que surnaturelle. Son comportement, en ce trajet de
Rennes à Paris, nous livre le secret des méditations de son enfance et de sa
jeunesse, je veux dire ce totalitarisme ascétique et mystique qui, entre tous
les saints, même les plus prodigieusement détachés du monde, sera sa marque
propre et imprégnera la moindre de ses démarches. Certains des gestes de
l'enfant préfiguraient ceux qui, venant de l'homme fait, déconcerteront ses
contemporains et effareront tant de prudents ecclésiastiques. Ainsi, ayant
découvert, au cours de vacances au Bois-Marquer, dans la bibliothèque
paternelle, un livre obscène, il l'envoie au feu sans solliciter l'avis de son
père. Pas davantage, en se rendant à Paris, il ne se demande s'il convient de
se présenter en loques à une demoiselle d'âge et de condition. Pour passer de
l'éphémère à l'éternel, du monde méprisable des apparences à la réalité divine,
il n'admet aucune transition, fait foin de toutes les nuances. Par là, il
appelle dès maintenant sur lui cette réputation de bizarrerie, d'étrangeté,
d'extravagance dont ses contemporains, puis la postérité l'ont chargé. Il n'en
a cure, parce que le jugement de Dieu seul lui importe et qu'il n'aura de
comptes à rendre qu'à Dieu, au jour où sonneront les trompettes de la fin des
fins. A cet absolutisme évangélique, son tempérament propre apporte un renfort.
Les forces de sa puissante constitution refoulées, refusées aux joies de ce
monde, se déchaînent au service de Dieu en des gestes définitifs et fracassants
; il a le tempérament de son père, sanguin et violent ; c'est le même arbre, le
même chêne, mais toutes racines tournées vers le ciel. C'est aussi l'Armoricain
jailli, comme un roc, d'entre ses landes ; il reste un bon Breton, sous sa
culture humaniste, et, sous les puissances et les grâces de son esprit et de
son cœur, un primitif. Son apostolat, ce sera l'invasion des grandes eaux et,
dans la chanson si pure de ce torrent, on discernera toujours le bruit sourd
des gros cailloux roulés par le courant. A vingt ans, il est entré, tout d'une
pièce et d'emblée, dans la plénitude du don. Le texte de l'Ecriture, qu'il
citera si souvent, l'obsède d'une obsession qui ne le quittera plus. Egredere de cognitione tua et vade in terram
quam monstrabo tibi : Sors de ta famille et marche vers la terre que je te
montrerai... Il part en effet et, comme il n'a pas entendu que Jésus et les
Apôtres aient voyagé autrement, il part à pied, délesté au plus vite de son
argent, n'en gardant pas un sol et le chapelet à la main. Il ira ainsi, pendant
huit à dix jours, mendiant abreuvé de rebuts et d'humiliations, mais soulevé
d'une joie surnaturelle. C'est la première de ces randonnées qu'il multipliera
au long de sa vie de missionnaire et dont le tracé sur la carte ferait pâlir le
plus entraîné des sportifs modernes. Par cette entrée immédiate dans l'absolu
de l'Evangile, il se définit tout entier; il ne fera plus que s'accentuer dans
ce sens, s'appliquant, à force de pénitence, de charité, de mépris de soi-même,
à atteindre l'impossible, à crever le plafond de la sainteté. Par là, le point
de départ et le point d'arrivée se confondent dans sa vie.
Le
Séminaire.
Quand elle vit surgir
dans l'encadrement de sa porte un loqueteux, couvert de poussière et de boue,
et fleurant l'écurie où il avait passé la précédente nuit, Mlle de Montigny en
eut les mains figées dans ses mitaines. Ce n'est point ainsi accoutré qu'elle
attendait le fils d'un bon petit bourgeois breton, élevé chez les Pères de
Rennes. Lui acheter des habits neufs n'était point chose difficile et elle s'en
acquitta. Mais le fait revêtait à ses yeux une originalité déconcertante.
Jamais elle n'oserait présenter cet irrégulier aux messieurs de Saint-Sulpice
dont l'austérité respectait ponctuellement les règles des politesses et
convenances ecclésiastiques dont M. Branchereau, de la même Compagnie, fut
l'exemplaire législateur. Elle le fit donc entrer dans une communauté ouverte
aux jeunes gens qui ne pouvaient payer leur pension au grand séminaire. Le
directeur en étant M. de la Barmondière, membre fort en vue de la Société de
Saint-Sulpice, le règlement et l'esprit du séminaire y florissaient. Les cours
étaient suivis en Sorbonne. Dans les études théologiques, Louis-Marie, aussi
laborieux qu'intelligent, excella aussitôt. Pour juguler en lui le moindre
éveil d'amour-propre, il pratiqua les plus âpres macérations corporelles. Il se
plia avec joie aux très humbles exercices manuels prescrits par le règlement,
tout ce qui pouvait humilier l'enchantant. La communauté vivait à grand'peine,
les élèves ne payant qu'une faible rétribution ; elle connut une période à ce
point nécessiteuse que M. de la Barmondière engagea les plus dévoués de ses
pensionnaires à veiller, moyennant salaire, les morte du quartier
Saint-Sulpice. Grignion était de ceux-là et passa, en ces veillées funèbres,
nuit sur nuit. Loin de chercher à se distraire d'une aussi macabre expérience,
il la prit corps à corps et en reçut une définitive illumination sur le néant
de ce monde, la précarité de la vie humaine et la seule solution raisonnable
qui est de vivre par rapport à l'éternité. L'ami Blain qui, sur son invite,
l'avait rejoint chez M. de la Barmondière, nous dit qu'il se plaisait « à
découvrir la face des cadavres et à considérer à loisir, dans leur laideur et
leur difformité affreuse, le charme trompeur d'une jeunesse et d'une beauté
évanouies et la folie extrême de ceux qui s'en laissent enchanter ». Pour une
âme aussi fortement trempée, de telles visions ont valeur de leçons exceptionnelles.
Comme, à Rennes, il rencontra le Pauvre, Grignion de Montfort, en la paroisse
de Saint-Sulpice, a rencontré la Mort. De ce double choc, il fera, plus tard,
passer, Jans l'âme de milliers d'auditeurs, le salutaire frisson.
Le 18 septembre 1694, M.
de la Barmondière, son unique protecteur, mourut. Le 26 — il venait de recevoir
les ordres mineurs — Grignion plonge sa plume d'oie dans l'écritoire et écrit à
son oncle de Rennes avec une magnifique sérénité : « M. de la Barmondière, mon
directeur et supérieur, est mort... Il a vécu en saint et est mort de même...
Je ne sais point encore comment tout ira, si j'y demeurerai ou si j'en
sortirai. Quoi qu'il m'en arrive, je ne m'en embarrasse pas ; j'ai un Père dans
les cieux qui est immanquable. » L'œuvre de M. de la Barmondière se trouvant
dissoute, on admit Louis-Marie dans la « petite communauté des pauvres écoliers
» de M. Boucher. C'était descendre à pic au dernier échelon des privations.
Louis-Marie les compliqua par des austérités sans nombre ; discipline, haire et
chaînes le déchirèrent tout à tour. Il tomba gravement malade et fut envoyé à
l'Hôtel-Dieu au milieu des égrotants de la plus pouilleuse misère de Paris. Il en
exulta : pauvre parmi ses chers pauvres, quel Paradis ! On le saigne, à la mode
du temps, jusqu'à la dernière goutte de son sang. De ladite saignée, il manqua
mourir plus que de la maladie. Cependant, il guérit, la Providence ayant ses
raisons que la médecine ne connaît pas.
A Saint-Sulpice, on
commençait à s'aviser que tant de vertu était d'un saint, et que le jeune
Grignion serait fort à sa place au petit séminaire[5]
de Saint-Sulpice pour le plus grand profit spirituel de ses condisciples. Mais
nul n'y était admis s'il ne disposait d'une pension de 260 livres. Une
bienfaitrice, la marquise d'Allègre, qui était au fait de son dénuement et de
sa sainteté, y pourvut pour 160 livres. M. Baüyn, un des directeurs de la
maison, fort mystique et mortifié lui-même, obtint qu’un bénéfice de 100
livres, provenant de la chapellenie de Saint-Julien-de-Concelles, près de
Nantes, fût attribué à Louis-Marie. Celui-ci entra donc au petit séminaire.
Il y va connaître crucifiante
épreuve. Autour de lui, nul ne balance sur son extraordinaire vertu, mais sa
manière de ne jamais prendre pied, de vivre en toute circonstance, en
récréation par exemple, au dedans de lui-même, de tenir les yeux baissés, la
tête penchée sur le col, agace ses condisciples. Les séminaristes, si pieux
qu'ils soient, sont des jeunes gens en qui subsiste l'écolier. Aussi
couvrent-ils le nouveau venu de brocards malicieux ; ils y vont même, au
besoin, de quelques gifles pour lui faire redresser la tête « comme il faut ».
Il supporte tout cela avec une patience, une douceur invincibles. M. Baüyn, son
directeur de conscience, l'engage à parler à ses camarades, à se montrer ouvert
et gai avec eux. Il s'y efforce mais n'y réussit pas. Hors les choses de Dieu qui
le trouvent éloquent, vif, magnifique, enflammé, il ne sait rien dire et
bredouille. Il s'ingénie à composer un recueil de bons mots, de petites
histoires amusantes, et à les débiter, pour faire figure de cordial jeune
homme, comme on l'y invite. Mais il les déroule avec tant de componction et
d'une mine si forcée, il est si peu badin qu'on se moque de lui. Son
impuissance à se mouvoir dans les bêtises dont s'amusent les gens est
saisissante. Il y fait figure de sot, lui dont nous savons de quel vol puissant
son imagination l'emporte dans les cieux chrétiens. Il est comme l'albatros de
Baudelaire : ses ailes de géant l'empêchent de marcher.
Des hommes bien ennuyés,
et devenus du coup inquiets et sourcilleux, ce sont ces messieurs de
Saint-Sulpice. Ils aiment que la piété soit réglée, ordonnée, comme un jardin à
la française, et le comportement exempt de toute originalité. Des voies hors du
commun, ils se méfient, d'instinct et toujours. Un Leschassier, un Tronson,
sont des prêtres de haute vertu, des formateurs remarquables, mais qui
travaillent en série. Grignion de Montfort est proprement un être extraordinaire
; eux, c'est du grand ordinaire, et ils veulent tout ramener à leur toise.
Impossible de s'évader de ce malentendu. Ils s'y efforcent cependant. Ces
maîtres de l'examen particulier observent et dissèquent longuement leur
nouvelle recrue. Ils distinguent en lui une soumission exemplaire au règlement,
toutes les marques qui font le saint dont Saint-Sulpice s'honorera et tout ce
qu'il faut aussi pour l'en renvoyer, cette bizarrerie, encore un coup, cette
étrangeté, cette obstination à ne rien faire comme tout le monde. Qu'était par
exemple cette manière de se taire en compagnie, de sembler hors du monde à tout
instant, ou, accompagnant quelque séminariste en visite, de l'attendre à genoux
sur l'escalier ? Quant à ces oraisons où il s'attardait, souvent à contretemps,
le visage tout enflammé, n'y fallait-il point soupçonner de ces fausses
illuminations où le démon s'embusque ? Tant de traits singuliers ne
seraient-ils pas le fait d'un être obstiné en son sens propre ? On convint de
traquer cette singularité jusqu'à en avoir raison. M. Brenier, supérieur de
Saint-Sulpice, et M. Leschassier, devenu, après la mort de M. Baüyn, directeur
de conscience de Louis-Marie, s'y employèrent. Durant des mois et des mois, ils
s'ingénieront impitoyablement à l'humilier, multipliant les « expérimentes »
les plus âpres auxquels puisse être soumis un novice dans la plus austère des
trappes. M. Brenier lui montrait dur et méprisant visage en toute rencontre,
l'accablant de dédaigneuses paroles, surtout en public. M. Leschassier refusait
souvent de l'écouter ou le rebutait de cent manières, traitant d'imaginations
les aspirations ou sentiments dont il lui faisait confidence, freinant son âme
dans ses plus sublimée envolées, ne le consolant ou approuvant jamais, se
montrant, comme dit Blain, tout de glace, quand il était tout de feu, bref,
faisant, comme M. Brenier, tant et si bien que tout autre eût pris le large. Or
il apparut que, de tant d'avanies, Grignion prenait occasion pour grandir
intérieurement, à l'image de son maître crucifié. Jamais on ne put observer en
lui le moindre tressaillement d'humeur. Il n'opposait que silence, humilité,
soumission. Les pieux tortionnaires renoncèrent. Louis-Marie restait aussi «
singulier » que par devant, mais il leur était devenu évident qu'il n'y pouvait
rien, car en l'obéissance, ce critère de l'ascèse chrétienne, il ne défaillait
jamais. Ils durent convenir d'une action spéciale de l'esprit de Dieu, et
l'admirent à la prêtrise qu'il reçut le 5 juin 1700.
Le voilà donc prêtre,
après une intense formation de sept années. En sciences sacrées, il est
fortement armé. Depuis son entrée au petit séminaire, il n'avait pas suivi les
cours de Sorbonne, mais seulement les répétitions de théologie à l'intérieur du
séminaire. Il y a gagné, par le tour plus personnel qu'il a donné ainsi à ses
études et qui convient à son génie si original. Il a pu faire part plus large
aux auteurs mystiques, ses préférée. Il s'est enchanté des œuvres des Bérulle,
des Condren, des Bourgoing, des Olier et son esprit s'est assimilé leur
substance. Ses premiers cantiques datent de cette époque ; il préparait encore
des plans de sermons, en vue de son apostolat futur. L'éloignement de la Sorbonne
lui a encore valu d'être radicalement préservé du Jansénisme et du Gallicanisme
dont elle était infestée. Quelque peine dont il ait pâti du fait de la prudence
sulpicienne, il n'en a pas moins bénéficié, en la personne de ses directeurs,
de l'idéal sacerdotal le plus pur et le plus élevé. Sa dévotion à Marie, pivot
de sa vie intérieure, s'est trouvée comblée à Saint-Sulpice où la Vierge était
grandement honorée par l'image, par les cérémonies, par les prières. Elle s'est
nourrie de la lecture des Oratoriens et de M. Boudon, en lesquels il puisera le
principe de sa doctrine sur l' « esclavage de la très Sainte Vierge ». Il avait
même pris l'initiative de fonder une association mariale avec quelques
condisciples qui voulaient comme lui être « esclaves de Jésus en Marie ».
Enfin, il s'est abondamment exercé dans ce support joyeux des croix qui sera
l'âme de son ascèse. Et maintenant, que va-t-il faire ?
C'est à M. Leschassier
de répondre. Il reste le directeur de conscience de Louis Grignion, et celui-ci
attend le verdict de son directeur comme la manifestation même de la volonté
divine. Au vrai, la flamme qu'il porte en lui est inclinée par le vent de
l'Esprit dans un sens bien précis. Ce qu'il souhaite, c'est la Mission, et
auprès des plus petits, des plus déshéritée. Breton, il porte en lui de grandes
puissances de songe. Son imagination le précède comme la colonne de feu. Aussi
souhaite-t-il d'abord partir pour les lointaines forêts du Canada évangéliser
les Indiens. Le positif M. Leschassier ne l'entend pas ainsi, craignant, dit
Blain « qu'il ne s'y perdît, se laissant emporter par l'impétuosité de son zèle
». Et puis, chose curieuse, lui et les autres messieurs de Saint-Sulpice ont le
secret désir de le retenir pour leur Compagnie. Mais Grignion n'y a visiblement
aucune inclination; par ailleurs, eux-mêmes le voudraient avant tout délesté de
ses originalités et ils attendent ce résultat d'une certaine pratique du ministère.
Après, on verrait. M. Leschassier décide donc de confier son pénitent à un M.
Lévèque, homme de Dieu, fort mortifié, grand ami de Saint-Sulpice où il venait
souvent retremper ses forces spirituelles et qui, ayant connu Grignion,
désirait fort se l'attacher. M. Lévèque dirigeait à Nantes la communauté de
Saint-Clément, en principe maison de retraite pour le clergé, de formation pour
les jeunes prêtres, foyer de missionnaires pour l'évangélisation des paroisses
de la région nantaise.
Entre
Nantes et Poitiers.
Arrivé à Saint-Clément
en septembre 1700, M. de Montfort[6]
y trouva surtout du désordre. Des pensionnaires, de catégories fort diverses,
tiraient à hue et à dia, chacun entendant vivre à sa façon. Pas de discipline.
Le Jansénisme sévissait, introduit et attisé par le maître de conférences de la
communauté, l'astucieux et brillant M. de La Noë-Mesnard. M. Lévèque, trop âgé
pour s'imposer, en gémissait, mais n'y pouvait rien. Dans un tel milieu, M. de
Montfort ne se plut pas et ne plut pas. On prétendit qu'il se rangeât dans le
parti des novateurs ; l'homme de ferme doctrine qu'il était s'y refusa. Aussi
fut-il accablé d'avanies. On lui dénia le droit de confesser et de prêcher des
missions parce qu'il n'avait pas passé l'examen requis ; or, cet examen, il ne
voulait pas l'affronter, y ayant décelé un piège tendu à son orthodoxie.
Dès le 6 novembre, il
alerte M. Leschassier. Il lui démontre que Saint-Clément n'est pas fait pour
lui, que sa situation y est impossible. « Je me sens de grands désirs,
écrit-il, de faire aimer Notre-Seigneur et sa Sainte Mère. Je ne puis m'empêcher,
vu la nécessité de l'Eglise, de demander continuellement, avec gémissement, une
petite et pauvre compagnie de bons prêtres qui, sous l'étendard et la
protection de la très Sainte Vierge, aillent, de paroisse en paroisse, faire le
catéchisme aux pauvres paysans, aux dépens de la seule Providence. » Voilà ce
qu'il faut retenir ; Montfort sait parfaitement où il veut aller et ce pourquoi
il est fait. Ce sont les missions qui l'attirent, et il voit un moyen pratique
de s'y donner, celui de s'unir à M. Leuduger « grand missionnaire et homme de
grande expérience ». Si sa vie donne une impression de décousu, d'incohérence,
cette vie toute en zigzags, en arrivées et en départs, c'est le fait, non de
son humeur, mais de circonstances contraires, d'hommes qui ne le comprennent
pas ou le rebutent, de son esprit d'obéissance aussi qui le fait s'incliner
toujours devant les ordres et même les conseils de directeur» ou supérieurs,
souvent mal inspirés. Mais, au dedans de lui-même, il ne balance pas sur sa vocation
particulière. Or, il ne reçoit de M. Leschassier qu'un bref billet daté du 31
décembre 1700, qui est d'un homme énervé, pressé. « Je ne puis rien vous dire
sur M. Leuduger, n'ayant pas l'honneur de le connaître. Néanmoins, je ne
voudrais pas vous empêcher de profiter des avantages que vous pourriez trouver
en sa compagnie. Donnez-vous à Notre-Seigneur et lui demandez qu'il vous fasse
connaître sa volonté. » En somme, M. Leschassier invite Montfort à se
débrouiller.
Sur ces entrefaites, en
avril 1701, M. de Montfort se rend à l'abbaye de Fontevrault. Deux de ses sœurs
s'y trouvaient, de par la bienveillance de Mme de Montespan, occupée à faire en
ce lieu pénitence de ses scandales. L'une d'elles devait recevoir l'habit.
Montfort décida de se rendre à Fontevrault à pied, ce qui le fit arriver au
lendemain de la vêture. Encore une de ces particularités dont M. Leschassier se
fût offusqué. Du moins, Montfort put-il prendre occasion de ce voyage pour
présenter ses hommages à la bienfaitrice de ses sœurs. Celle-ci l'invitant à
lui faire part de ses projets, il lui dit, avec sa simplicité coutumière, son
désir de s'associer à des missionnaires. Mme de Montespan l'engagea à aller
visiter, sous son égide, Mgr Girard, évêque de Poitiers, capable, pensait-elle,
de comprendre et d'approuver son dessein.
Et M. de Montfort
d'abattre aussitôt vingt-cinq lieues, toujours pédestrement, pour gagner
Poitiers. Mgr Girard ne s'y trouvait pas. Les quatre jours que dura encore son
absence, Montfort les passa en prières, de préférence dans la chapelle de
l'hôpital. Les loqueteux qui l'y virent s'émerveillèrent que, prêtre, il fut
aussi dénué et misérablement accoutré qu'eux-mêmes, et se cotisèrent — qui d'un
denier, qui d'un sol — pour lui faire l'aumône, car il y a grande solidarité
dans les cours de miracles. Là-dessus, Mgr Girard, de retour à son évêché,
reçoit Montfort. Plus exactement, il l'éconduit, effaré de sa mine et de sa
mise. Mais, ému par le gémissement des pauvres de l'hôpital qui réclament à
grands cris Montfort comme aumônier, il le rappelle, l'avertit de son intention
de lui confier l'aumônerie, l'invite à soumettre cette éventualité au jugement
de M. Leschassier et, en attendant une solution, de s'en retourner à Nantes.
Montfort écrit aussitôt à son directeur, par le menu, ce qui s'est passé. Lui
ayant relaté l'émouvante démarche des loqueteux de l'hospice : « Je bénis Dieu
mille fois, fait-il, de passer pour pauvre et d'en porter les glorieuses
livrées et je remerciai les chers frères et sœurs de leur bonne volonté. Ils
m'ont en ce temps-là pris en telle affection qu'ils disent tous publiquement
que je serai leur prêtre, c'est-à-dire leur directeur, car il n'y en a point
dans l'hôpital depuis un temps considérable, tant il est pauvre et abandonné. »
Et il ajoute : « Je sacrifierais volontiers mon temps, ma santé et ma vie même,
pour le salut des pauvres de cet hôpital abandonné, si vous le jugez à propos.
» Nulle contradiction en ceci. Montfort cède à un pur mouvement d'amour. Toute
son âme le porte aux Missions mais il est prêt à en faire le sacrifice pour les
préférés de Jésus-Christ. Au reste, plus haut, il a écrit : « J'ai à la vérité
beaucoup d'inclination à travailler au salut des pauvres en général mais non
pas tant de me fixer et m'attacher dans un hôpital. Je me mets pourtant dans
une entière indifférence, ne désirant que de faire la sainte volonté de Dieu...
» La réponse de M. Leschassier est aussi décevante que possible. Vous ne me
dites pas ceci, vous ne me dites pas cela, ronchonne-t-il : « Au reste, mon cher
monsieur, il me sera difficile de vous déterminer quand vous m'aurez donné tous
ces éclaircissements. Je ne suis pas assez éclairé pour des personnes dont la
conduite n’est pas ordinaire. » Il est clair que M. Leschassier en a assez de
son pénitent et voudrait n'en plus entendre parler. N'ayant pu le ramener à
leur norme, ces messieurs de Saint-Sulpice ont gardé de cette expérience
manquée amertume et méfiance qui, Montfort ne se résolvant pas à une « conduite
ordinaire », sont en train de tourner à l'acrimonie et à l'abandon.
De fin mai à fin
septembre 1701, Montfort est à Nantes, où il se débat, dans la communauté de
Saint-Clément, avec les mêmes difficultés, voire aggravées. Mais il y a, en
cette période, une date lumineuse. M. Lévèque l'envoie évangéliser, pendant une
dizaine de jours, la paroisse de Grand-Champ. Pour la première fois, des paysans
de l'Ouest vont le voir arriver, missionnaire. Comment l'accueilleront-ils ? Ce
n'est pas sa personne physique qui peut les séduire. Il est laid, de traits disgracieux,
avec une grande bouche, et ce nez osseux, démesuré, que les imagiers d'aujourd'hui,
avec une piété déplorable, s'efforcent de ramener à un canon plus esthétique.
Et puis, il a toujours, dans ses manières, une singularité bien faite pour dérouter
le bon public. Cependant son succès est complet. C'est que, dans la mission
pour quoi il est fait, dans la mission, chose de Dieu, où il n'est question que
de Dieu, de sa Mère et de ses saints, le génie de Montfort se déchaîne, son âme
prend feu, et l'on ne voit plus que cela. Dans son temps de séminaire, Montfort
a accumulé les thèmes de sermons et son verbe est magnifique. Même à
Saint-Sulpice, on s'en était rendu compte par éclairs. La doctrine de sa prédication
est à la fois riche et limpide, le développement vivant et imagé, le terme,
souvent très réaliste, est juste et fait balle. Par là-dessus, une
appropriation étonnante à l'âme populaire. Le résultat obtenu à Grand-Champ
fait envoyer Montfort en plusieurs paroisses où il soulève les âmes.
Il reste que, pour
Montfort, la communauté de Saint-Clément est inviable. Aussi, quand Mgr Girard
lui fait savoir, le 25 août 1701, que l'aumônerie de l'hôpital l'attend, il
n'hésite pas, pour ce qui est de lui, à quitter Nantes pour Poitiers. Bien
entendu, il en demande permission à M. Leschassier. Songe-t-il à abandonner les
Missions ? Loin de là : il écrit à son directeur : « L'espérance que je
pourrais avoir de m'étendre avec le temps dans la ville et dans la campagne
pour profiter à plusieurs, peut seule me donner quelque inclination d'aller à
l'hôpital. Le catéchisme aux pauvres de la ville et de la campagne est mon
élément. » Entendez ici catéchisme au sens large d'évangélisation. M.
Leschassier donne son approbation, le plus désagréablement qu'il peut et non
pas, bien entendu, sans recommander à son dirigé de suivre « les règles
ordinaires » et de ne pas s'en écarter « sous prétexte de dévotion ».
Aumônier
à l’hôpital de Poitiers.
Alors commence une des
plus étonnantes et fécondes périodes de la vie de Montfort. Des premiers jours
d'octobre à fin novembre, il dut attendre, pour prendre ses fonctions, la
réunion du conseil d'administration de l'hôpital, alors en vacances, et dont
dépendait son admission officielle. L'évêque l'installa provisoirement dans le
petit séminaire Saint-Charles, lui donnant tous pouvoirs et toute latitude
d'exercer son zèle apostolique dans la ville. De quoi M. de Montfort s'acquitta
à sa manière dévorante. Visites aux pauvres de l'hôpital et aux prisonniers,
catéchisme aux enfants, et aussi aux mendiants, dans une chapelle de
Saint-Nicolas, puis, à cause de l'affluence, sous les Halles, fondation enfin
de sociétés pour les écoliers et jeunes gens. Ces sociétés groupaient surtout
des externes du collège des Jésuites qui, n'ayant pas leur famille à Poitiers,
logeaient dans des pensions particulières, et se trouvaient livrés à eux-mêmes.
Il en fit une élite et les moins ardents à embrasser une vie chrétienne ne
furent pas les plus libertins ; quelques paroles du jeune prêtre avaient suffi
à les jeter au Christ. Ainsi se constituait une réserve d'apôtres qui, plus
tard, serviront ses surnaturels desseins. Il fonda aussi une association de
filles et ce sera le noyau des Filles de la Sagesse.
Aumônier, Montfort fait
pratiquement aussi fonction de directeur. Dès son arrivée, il constate que tout
va à vau-l'eau — « une pauvre Babylone », dit-il de l'établissement — et prend
en main, à la grande satisfaction des supérieurs, une réforme générale. Il
entend introduire et faire observer une règle. Il fixe l'heure du lever, du
coucher, de la prière vocale, du chapelet en commun, du réfectoire en commun, des
cantiques et même de l'oraison mentale. Les revenus de l'hôpital étant
insuffisants, il s'improvise quêteur, à travers la ville, une bourse à la main
pour les dons en argent et suivi d'un âne, portant des paniers, pour les dons
en nature. Il organise une répartition rationnelle du pain. Surtout, il fait
rayonner partout son âme — et quelle âme dont la tendresse pour les déshérités
de la vie est sans limites ! Il la leur témoigne d'abord en vivant comme eux,
gîté dans une soupente, et refusant les honoraires auxquels il avait droit. Il
entoura de prévenances ses pauvres — ils étaient, de tout sexe et âge, quatre
cents — les soignant, les consolant, les dorlotant. Une fois, comme certains
soins à donner, particulièrement répugnants, avaient fait se cabrer en lui la
nature, il prit, pour mater cette instinctive révolte, un verre empli du pus
d'un ulcère et l'avala d'un trait. De telles victoires sur soi-même le
cuirassaient contre le pire.
La médiocrité humaine se
satisfait davantage du laisser-aller que de la règle ; et les jaloux n'aiment
pas qui réussit. Il y eut cabale parmi les cadres, auxquels se joignirent
quelques pensionnaires aigris. Elle se manifesta si violemment que Montfort dut
se réfugier chez les Jésuites où il fit retraite. Or, quand il en sortit,
l'animateur du complot tomba malade et mourut peu après ; la supérieure, sa
complice, le suivit aussitôt dans la tombe ; quatre-vingts pauvres tombèrent
malades ; plusieurs moururent. On reconnut la main de Dieu qui passait.
Montfort put reprendre son ministère. Pour améliorer l'atmosphère de la maison
qui pâtissait particulièrement du mécontentement de ses « gouvernantes »
séculières[7],
il groupa, en une association pieuse, quelques femmes hospitalisées, plus ou
moins infirmes, et mit à leur tête une aveugle. Voilà bien le sublime paradoxe
montfortain. De belles âmes habitaient ces corps débiles et contrefaite ;
n'est-ce point assez pour faire éclater la gloire de Dieu ? Montfort avait
raison contre la raison. De jour en jour s'étendit, bienfaisant, le rayonnement
du foyer de ferveur qu'il avait ainsi créé.
En juillet-octobre 1702,
Montfort profite des vacances pour aller à Paris. Il s'y occupe de sa chère
sœur Louise qui se trouvait abandonnée de sa protectrice, Mme de Montespan, et
sans ressources. Il la fait entrer chez les bénédictines du Saint-Sacrement, où
elle deviendra bientôt la sœur Marie-Bernard, et revient à Poitiers, à la fin
d'octobre. Il y trouve sa petite association aussi fervente qu'avant son
départ. Parmi ces pieuses filles, il y a maintenant Marie-Louise Trichet, qui
deviendra, sous le nom de sœur Marie-Louise de Jésus, la première supérieure
générale des Filles de la Sagesse.
Tout Poitiers retentit
de Montfort, soit que la ville clabaude et s'indigne, soit qu'elle
s'émerveille. Mais le courant hostile l'emporte, car sa personnalité puissante
fait craquer trop de cadres, bouscule trop de conventions, de pharisaïsmes,
d'usages établis. Et puis, le Jansénisme, irréductible ennemi du héraut de la
miséricorde et de l'amour divins, s'inquiète, intrigue, réussit à impressionner
le nouvel évêque de Poitiers, Mgr de la Poype de Vertrieu. Là-dessus, en un de
ces éclats dont il est coutumier, quand le péché s'étale trop insolemment et
fait scandale, il avise des jeunes gens qui, se baignant dans le Clain,
manquent à la pudeur devant les lavandières. Il s'arme de la discipline qu'il
porte toujours sur lui et en fustige les impudiques. Les parents portent
plainte à l'évêché et l'évêque interdit à Montfort de célébrer la messe. Le
Père de la Tour, jésuite, intervient en faveur de Montfort. L'interdit est
levé. Mais l'atmosphère avait été trop troublée par les passions. La position
devenait intenable pour l'aumônier à l'hôpital, et, en ville, pour l'apôtre. On
signifia à Montfort qu'il devait s'en aller et il s'en alla.
Séjour à
Paris.
Quelle déréliction !
Quelle solitude ! Tout ce qu'il a entrepris semble s'écrouler. Il n'a plus un
appui. M. Leschassier lui-même ne l'a-t-il pas abandonné, dès novembre 1701, en
l'invitant sans ambages à prendre un autre directeur ? Il y a pis : passant par
Angers, quand il se rendit à Paris dans l'été de 1702, il avait voulu présenter
ses devoirs à M. Brenier, alors supérieur du grand séminaire de cette ville. M.
Brenier l'avait honteusement chassé, sans même offrir un repas à ce pèlerin
exténué et affamé. Arrivé à Paris, Montfort, doucement, humblement obstiné à
rester fidèle à M. Leschassier, était allé lui rendre visite et M. Leschassier,
dur et dédaigneux, n'avait pas voulu l'entendre. C'est dire que, de
Saint-Sulpice, il ne pouvait rien espérer. L'ami Blain lui-même, influencé par
ces messieurs, ne s'était-il pas refroidi à son égard ? Cependant, c'est à Paris
qu'il va. Ne cherchons pas à ce choix d'humaines raisons. Il obéit, selon son
propre témoignage, à une impulsion de l'Esprit Saint.
Arrivé en avril 1703, il
passe cinq mois à l'hôpital de la Salpêtrière, soigné d'abord, puis soignant
lui-même ses chers pauvres. Il en est congédié brutalement. Il élit domicile
dans une soupente de la rue du Pot-de-Fer, fait son repas des restes du couvent
des bénédictines du Saint-Sacrement. Son ministère ? Il n'a pas de peine à
trouver des miséreux à Paris. Il leur parle de Jésus-Christ crucifié, de sa
tendre Mère, les console, les confesse, prêche en quelques églises. Tout cela
dans la pénombre. Mais il ne peut passer inaperçu. Une lumière émane de lui.
Ses conversions font le bruit qu'il ne fait pas. On en parle au cardinal de
Noailles qui l'envoie réformer les ermites du mont Valérien, société de pieux
laïques, bien déchus de leur ferveur primitive. Par son seul exemple, il les
régénère, fait passer en eux sa flamme. Parmi tous ces travaux, il ne lâche pas
l'idée-mère de son apostolat, sa vocation essentielle : les Missions. Ce serait
ne rien comprendre à Montfort que de l'imaginer, quand les circonstances ou les
hommes le criblent de contradictions et d'épreuves, en désarroi. Il reste dans
une paix profonde et joyeuse et, malgré les apparences, suit le chemin de sa
vocation propre. A Poitiers, où il semble avoir tout perdu, le germe de
l'institut des Filles de la Sagesse est en bonne terre. U songe plus que jamais
à réaliser son grand rêve : une société de missionnaires. A Paris, il revoit son
ancien condisciple de Rennes, Claude Poullard des Places, qui a fondé le
séminaire du Saint-Esprit, communauté de clercs, recrutés parmi les moins
fortunés, et voués à aller partout où il est besoin de prêcher la parole de
Dieu. Poullard des Places est un homme du XVIIe siècle, de la
famille intellectuelle et spirituelle de Jean-Baptiste de la Salle. Montfort
est un homme du moyen âge qui travaille les âmes par les moyens les plus
étrangers à ce xviiie
siècle où il se meut. Mais ils ont en commun l'amour passionné du Pauvre et de
Jésus-Christ. Poullard accepte la proposition de Montfort qui est de faire de
sa communauté une pépinière pour la future société de Montfort.
Un an s'était écoulé. En
mars 1704, il reçoit, par l'intermédiaire de M. Leschassier, une lettre qui le
bouleverse : « Nous, lut-il, quatre cents pauvres, vous supplions très
humblement par le plus grand amour et la gloire de Dieu, nous faire venir notre
vénérable Pasteur, celui qui aime tant les pauvres, M. Grignion. Hélas !
monsieur, nous ressentons plus que jamais la perte que nous avons faite pour le
salut de nos âmes. Nous voyons tous les jours visiblement que l'édifice qu'il
avait commencé, pour n'être pas assez affermi, se va détruisant petit à petit
et comme, dans cette maison, c'est un flux et un reflux de monde qui entre et
qui sort, il y a toujours à convertir plusieurs âmes... Pardon, mon bon
monsieur, de la hardiesse que nous prenons ; c'est notre indigence de toute
manière qui nous fait vous importuner et les grandes peines que nous avons...
Si nous pouvons une fois le revoir, nous serons plus obéissants et fidèles à
nous donner à notre bon Dieu. » Cela était signé : les Pauvres de Poitiers.
Comment M. Leschassier ne fut-il pas éclairé et ému en ses profondeurs «
ordinaires » par cette prière gémissante ? Montfort, en tout cas, n'y peut
résister : il part pour Poitiers.
Derechef
Poitiers.
Il revient à l'hôpital,
vers avril, sous le couvert de ses pauvres, mais aussi — ce qu'il ignorait — de
Mgr de la Poype de Vertrieu qui l'a réclamé à deux reprises aux Sulpiciens sans
qu'ils aient daigné répondre. Tant chez les administrateurs qui lui donnent
pratiquement les fonctions de directeur, que chez les pensionnaires, c'est un
joyeux enthousiasme ; feu de joie, mais qui s'éteint vite. La conjuration, au
bout de quelques mois, se ranima. Le P. de la Tour lui conseilla de
démissionner. Il voulut solliciter le conseil de Marie-Louise de Jésus, dont le
jugement égalait la vertu ; elle ne parla pas autrement. II décida alors de
s'en aller. « Quant à vous, dit-il à la sœur Marie-Louise, ne quittez point
vous-même cet hôpital avant dix ans. Quand l'établissement des Filles de la
Sagesse ne se ferait qu'au bout de ce temps, Dieu serait satisfait et ses
desseins sur vous seraient remplis. » Ce disant, comme on le verra, il
prophétisait. Le soir même, il démissionna. C'en est bien fini maintenant avec
l'hôpital.
Mgr de la Poype qui
l'admire, l'aime et le soutient, l'autorise à donner des missions dans la ville
et les campagnes voisines. Montfort débute par le quartier très mal famé de
Montbernage. La mission obtint un tel succès qu'elle se termina par une
procession monstre à travers ce faubourg où abondaient mauvais garçons, filles
publiques et détrousseurs en série. Partout où il passe, il en sera ainsi. Mais
un incident viendra tout compromettre. Au cours d'une mission qu'il prêche en
l'église des religieuses du Calvaire, il convainc ceux de ses auditeurs qui
ont, en leurs bibliothèques, de mauvais livres, de les porter sur la grande
place pour y mettre publiquement le feu. De tristes farceurs plantèrent sur le
tas une effigie impudique. Aussitôt les gens de le tourner en raillerie : « M.
de Montfort va brûler le diable ! » Le vicaire général, M. de Villeroi, alerté,
accourt, et blâme à haute voix, en termes sévères et devant tous, le
missionnaire. Celui-ci accueille cette admonestation avec une humilité et une soumission
profondes... Il continue ses missions avec le même brio, et ce sont
d'étourdissantes victoires apostoliques : ainsi transforme-t-il tel jardin, où
se rencontrent les débauchés, en un lieu de prières. Mais l'incident de
Montbernage a été, en sous-main, habilement exploité. Mgr de la Poype, cédant à
une cabale des jansénistes, défend à Montfort toute prédication. L'apôtre
abandonne le diocèse de Poitiers, où il ne fera plus que des apparitions
fugitives.
Rome.
Entre temps, il avait
fait merveilleuse recrue, celle de Mathurin Rangeard, jeune homme qu'il avait
rencontré, priant dans une église et qui s'est attaché à lui irrévocablement.
Pour l'heure, il lui enjoint de l'attendre aux alentours de Poitiers, car il
allait trop loin, et de trop incommode façon, pour se laisser accompagnera.
Montfort, en effet, a décidé de se rendre à Rome, auprès du pape, et de faire
le voyage à pied, comme il a accoutumé depuis le temps qu'il quitta Rennes. Ce
n'est pas un coup de tête, quelque envol de chimère. Il a un dessein fort
précis. On se laisse généralement dérouter par les méandres imprévus et
apparemment désordonnés de son existence, on s'arrête trop à ses saillies
excessives, on ne voit pas assez avec quelle fermeté, à la fois persévérante et
souple, avec quelle lucidité et quelle sagesse dans le choix des moyens, il s'applique
à réaliser sa vocation exceptionnelle de missionnaire. Rome est un pèlerinage
qui comblera son cœur si ardemment catholique, qui satisfera ses puissances de
rêve, qui lui permettra de prier auprès du tombeau des Apôtres pour ses chers
pauvres et pour les pécheurs, mais le but qui le met en marche, c'est, lâché
par les Sulpiciens, banni du diocèse de Poitiers, contredit dans les plus
hautes sphères ecclésiastiques avec acharnement, de se faire approuver et confirmer,
comme missionnaire apostolique, par le pape en personne. Le meilleur des témoins,
le jésuite de la Tour, à qui il en fit confidence, nous dit expressément qu'il
comptait, par ce voyage, obtenir « son ministère plus efficace pour la gloire
de Dieu et le salut des âmes ». Voilà le but que Montfort poursuit. Par
ailleurs, il a judicieusement choisi et sollicité son introducteur auprès de
Clément XI : le théatin Tommasi, confesseur du pape, qui recevra le chapeau en
1712 et sera béatifié en 1803. Cet influent personnage est, comme tous les
religieux de son ordre, un fervent propagateur de la dévotion du
Saint-Esclavage de Jésus par Marie. Par là, c'est l'homme fait entre tous pour
comprendre Montfort. De fait, dévot de Marie, il recevra à bras ouverts son
chevalier de France ; saint, il discernera, du premier coup d'œil, le saint. Au
surplus, Montfort prend à Rome le temps qu'il faut pour se faire connaître et
de Tommasi et de toutes personnalités utiles, puisque, arrivé au début de mai
1706, il n'est reçu par le pape que le 6 juin. Clément XI était donc bien
informé quand il lui donna audience. Le pape de la bulle Unigenitus n'ignorait pas non plus que les jansénistes exécraient
celui qu'il allait recevoir. Les résultats de l'entrevue ne furent pas moins
précis, tels en vérité que Montfort les désirait. Comme il parlait de prêcher
l'Evangile aux infidèles : « Vous avez, monsieur, lui dit le Souverain Pontife,
un assez grand champ en France pour exercer votre zèle ; n'allez point ailleurs
et travaillez toujours avec une parfaite soumission aux évêques dans les
diocèses desquels vous serez appelé. Dieu, par ce moyen, donnera bénédiction à
vos travaux. » Puis, comme nous le verrons, le pape l'orienta nettement, entre
autres buts apostoliques, vers l'éducation de l'enfance. C'étaient à la fois
une approbation et un encouragement très explicites que Clément XI renforça en
donnant à Montfort le titre et les pouvoirs de missionnaire apostolique. Cette
grave affaire, si sagement préparée, si heureusement conduite et avec tant
d'intelligence pratique, est comme sublimée par ce lyrisme intérieur, cet
ascétisme pathétique qui composent autour de toute démarche de Montfort un halo
qui n'est que de lui. Il revient comme il est parti, sans un denier en poche,
mendiant dans les bourgs sa subsistance, couchant dans les granges, ou, rebuté
par les gens, dans les vestibules des églises. Sur les routes, il récite son
chapelet, compose et chante ses fameux cantiques, s'exalte aux lieux saints
qu'il rencontre et visite. La poussière des chemins, aux soleils couchants
d'Italie, de Provence et de Languedoc, élève sous ses pas une nuée d'or.
Au seuil
du grand œuvre.
Il a trente-trois ans et
le voici maintenant devant son épopée missionnaire : dix ans au cours desquels
il évangélisera sans répit les pays d'Ouest. Il y aura dans cette dernière et
glorieuse époque deux périodes bien distinctes : l'une qui va de ce mois de mai
1706 à 1710, où son apostolat, tantôt réclamé, tantôt refoulé, se heurte à la
méfiance, voire à l'hostilité, des administrations diocésaines, l'autre de 1710
à 1716 où il rencontrera enfin ce qu'il n'a jamais jusque-là connu : l'appui
déclaré et fidèle de deux évêques : celui de La Rochelle et celui de Luçon.
Le 25 août, Montfort
arrivait à Ligugé, à une lieue de Poitiers : Mathurin Rangeard, disons
maintenant Frère Mathurin, qui l'y attendait, reste sans voix quand le pèlerin
lui apparaît, tenant souliers d'une main, chapelet de l'autre, et chapeau sous
le bras.
Il a les pieds
boursoufles et saignants ; les traits de son long visage forment de profonds
sillons de fatigue ; sa contenance trahit l'épuisement. Mais il ne vient pas
pour se reposer : en route, Frère Mathurin, en route ! Avec son compagnon,
Montfort se rend à Poitiers, mais il y peut à peine rester vingt-quatre heures.
La ville, où il est reconnu par ses ennemis, le vomit aussitôt. Il se concentre
aux environs de Poitiers, dans une retraite de huit jours, pour y prendre le
vent, le vent de Dieu. Puis, il va pèleriner à Notre-Dame des Ardilliers, à
Saumur, au mont Saint-Michel. Frère Mathurin commence à prendre la mesure des
rudes randonnées pédestres de son maître. Montfort reflue sur Rennes, seule
ville de la région qui lui reste ouverte. Là, il est un évêque qui s'oppose
fermement au jansénisme. Il pourra missionner dans le diocèse. Sa famille est
toujours à Rennes ; mais il n'appartient plus qu'au Christ et à sa Mère ; il
n'est plus Louis Grignion ; couvert du nom de Jésus, il ne logera pas sous le
toit familial, mais dans une pauvre auberge à rouliers. Une fois seulement il
acceptera de prendre repas chez ses parents. Pendant quinze jours, il prêche
dans les églises, les séminaires, donne des conférences chez ses anciens
maîtres, les Jésuites. Mais les calomnies de Poitiers ont couru jusqu'à Rennes.
Sa barque apostolique à peine amarrée, il doit lever l'ancre, et, en cette fin
de 1706, passant par la Bachelleraie, le pays de son enfance, où il rend visite
à sa bonne femme de nourrice, la mère André, il se rend à Dinan, dans le
diocèse de Saint-Brieuc, où il prêche notamment aux soldats de la garnison,
puis il évangélise les alentours. Une solution providentielle s'offre à lui. «
Il me vient des désirs de m'unir à M. Leuduger, grand missionnaire », avait-il
écrit à M. Leschassier au temps de la communauté de Saint-Clément. Or, M.
Leuduger, supérieur des missionnaires de Saint-Brieuc, averti de sa présence,
lui offre spontanément de se joindre à lui. Il s'insère ainsi dans un cadre qui
lui est protection. Et ce sont missions sur missions à La Chèze, à Plumieux, à
Moncontour, sans préjudice d'un magnifique travail apostolique à Saint-Brieuc.
Mais il est dit que toute stabilité lui sera refusée. Il a, au cours de ses
missions, de magnifiques audaces, dont M. Leuduger, ami des moyennes, s'effraie
et quelques autres missionnaires avec lui. De nouveau, Montfort est invité à
quitter les lieux.
Comme tous les grands
saints, quand l'épreuve se fait démesurée, asphyxiante — ainsi procédait son
contemporain Jean-Baptiste de la Salle — Montfort se replie dans la retraite.
Il se souvient qu'entre sa ville natale et la Bachelleraie, il est, sur une
éminence cernée de forêts, un prieuré en ruines dont subsiste, seule respectée
par le temps, la chapelle. C'est là qu'il se réfugie, au cours de l'automne de
1707, avec le Frère Mathurin et un compagnon qui vient de se joindre à eux, le
Frère Jean. L'existence qu'il y mène, durant une année, n'est pas uniquement
érémitique. Certes, il se ménage de longs jours de solitude, dans les oraisons
et les macérations, mais sa renommée attire de vraies foules qu'il porte au
point d'incandescence. C'est une sorte de mission permanente dans les bois.
Plusieurs fois, il ira même donner de véritables missions au dehors, notamment
en sa ville natale. Il fut prophète en son pays : cette mission à Montfort fut
un de ses grands succès. M. et Mme Grignion étaient venus de Rennes ; ils lui
firent accepter, à force d'insistance, de dîner avec eux. Ainsi fit-il, mais il
arriva suivi d'un cortège de mendiants et, à la stupeur générale, les fit
placer à table, à la place d'honneur. Auparavant, il les avait présentés : « Voilà,
mes chers amis, messieurs les Pauvres de Jésus-Christ. » C'est par de telles
leçons qu'il rappelait l'Evangile et sa loi d'amour.
Seulement, les jansénistes,
là comme ailleurs, veillaient, pestaient en leur cœur sec et intriguaient.
L'évêque, Mgr Desmaretz, leur était favorable et soumit Montfort à un tel
régime qu'il lui rendit l'apostolat impossible. Une fois de plus, le
missionnaire dut partir. La chapelle de Saint-Lazare, restaurée, embellie par
ses soins et ceux des Frères, était devenue le sanctuaire de Notre-Dame de la
Sagesse ; il la confia à la garde d'une sainte femme du pays, Guillemette
Rouxel. Celle-ci prit la consigne à la lettre ; elle s'établit sur les lieux,
ne vivant que d'aumônes et il en fut ainsi pendant vingt ans. C'est le propre
de Montfort que de susciter de puissantes fidélités. Là-bas, à l'hôpital de
Poitiers, dans un héroïque isolement, Marie-Louise de Jésus, de son côté,
égrène sans broncher les dix années d'attente que Montfort lui a imposées.
A
Nantes.
Le diocèse de Nantes
possède heureusement un vicaire général, de ferme doctrine, de vraie valeur et
de grande vertu, M. Barin, qui est au fait de la question Montfort et souhaite,
pour son diocèse, le passage de ce bolide de Dieu. De plus, tant par sa famille,
une des premières de Nantes, que par le crédit dont il jouit auprès de
l'évêque, Mgr Gilles de Beauvau, il est fort influent. Sur la fin de 1708, il
fait signe au missionnaire, que Saint-Brieuc, après Rennes, après Poitiers, ont
rejeté et celui-ci accourt. A Nantes, Montfort trouvera aussi le puissant appui
des Jésuites qui nulle part ne lui a manqué. Pour reprendre le mot savoureux de
Blain, ce n'est pas eux qui, à l'instar des Sulpiciens, l'auraient cru saint
sans le croire dans la voie des saints. Ainsi le P. de la Tour l'a-t-il soutenu
à Poitiers. Dans l'accablante année qu'il a passée à Paris, en 1703-1704, qui
donc, presque seul, l'a encouragé, approuvé, sinon le P. Descartes, son ancien
directeur du collège de Rennes? A Rennes même, tous les Pères lui avaient fait
fête. A Nantes, le P. Joubert sera son confesseur compréhensif dont le concours
ne fléchira point. Par la longueur et la profondeur de leur formation, leur
puissance d'adaptation, par l'envergure et la variété de leurs travaux
apostoliques, les Jésuites sont, entre tous, faits pour discerner et comprendre
un Montfort, sans se scandaliser ni s'émouvoir des soubresauts de ce
tempérament original... Par eux comme par Barin, Montfort va bénéficier à
Nantes d'une atmosphère heureusement neuve. A Nantes, il n'aura pas seulement
pour lui, comme partout ailleurs, le cœur populaire. La protection de M. Barin,
et aussi sans doute l'appui des Jésuites, lui ont valu de solides amitiés dans
la noblesse et la haute bourgeoisie nantaises. Celle de la présidente de
Cornulier, par exemple, et de sa famille. Un passage de la correspondance de
l'intendant de Bretagne, Ferrand, est révélateur : « Je me divertis bien hier,
aux Croix, avec la présidente de Cornulier sur le Grignonisme dont elle est
plus infatuée que l'abbé Barin. »
Vous diriez d'un
papotage de Mme de Sévigné à propos de Bourdaloue ou de quelque prédicateur à
la mode. En fait, ce que pense Montfort du monde et des mondains, il l'a fait
savoir une fois pour toutes. Tel de ses cantiques et d'ailleurs toute sa
conduite en témoignent. A Nantes comme ailleurs, son sublime parti pris pour la
pauvreté les éclabousse. Mais son amour des âmes n'exclut aucune condition,
fût-elle très élevée selon le monde. Une âme faite pour le bien, il l'abordera,
s'il le faut, au milieu des pompes du siècle et avec des manières qui
surprendront ceux qui voient en lui un saint sans doute, mais le plus fruste
des hommes. Il témoigne alors de la bonne éducation reçue dans son enfance et
de ses années de formation chez les Jésuites de Rennes. Au témoignage d'une
jeune femme fort brillante, point du tout dévote, qui pensait s'amuser de lui
et, au contraire, l'ayant entendu, puis ayant causé avec lui, l'admira, on trouvait
auprès de lui « de quoi s'instruire et se recréer » ; il savait prendre « en
badinant, sans jamais s'en fâcher... » telle parole un peu étourdie. C'est
qu'en celle-ci ou celle-là, il savait voir, derrière les allures de perruche,
une aspiration vers le bien dont ce grand convertisseur faisait merveille.
Il ne bride pas pour
autant la fougue de ses réactions publiques, ni l'audace de ses méthodes d'apostolat.
Il s'oppose en pleine rue au scandale de certaines intrigues amoureuses, de
telle façon que les étudiants, dont il dérange ainsi les transports, le laisseraient
plus mort que vif sur le pavé, si quelques artisans n'intervenaient. Ailleurs,
il voit des soldats autour d'une table de jeu ; sachant que cela finit presque
toujours par des bagarres souvent sanglantes, il n'hésite pas, renverse la
table d'un coup de pied, la réduit en morceaux ; il manqua, ce jour-là encore,
d'être occis. Pour prêcher la parole de Dieu, il entrait jusque dans les
maisons closes. Les prostituées, le voyant se jeter à genoux pour implorer la
miséricorde de Dieu, en restaient stupéfiées. Tel de leurs clients, un jour,
pointa son épée sur la gorge du trouble-fête : « Oh ! monsieur, fit le
missionnaire, ôtez-moi la vie. Je vous pardonnerai pourvu que vous me
promettiez de vous convertir, car j'aime mieux mille fois le salut de votre âme
que dix mille vies comme la mienne. » Les traits de ce genre s'étaient
multipliés au cours de son apostolat antérieur à Poitiers, Rennes et autres
lieux. La vue du péché est insupportable à Montfort ; l'horreur qu'il en
ressent est telle qu'elle en devient physique ; elle provoque instantanément la
mise en action de son sang tumultueux, de ses muscles puissants. Il se souvient
toujours de la table des changeurs et de ce que Jésus en fit. Il reste que la
tâche des protecteurs du bouillant apôtre n'est pas dans ces conditions une
sinécure. Il leur faut sans cesse intervenir, régler des incidents, provoqués
par les intérêts lésés, apaiser des mécontentements, souvent redoutables parce
que haut placés. M. Barin dut avoir fort à faire et aussi les Jésuites.
Pendant plus de deux
ans, mettant à profit la faveur de l'administration diocésaine, Montfort
missionne et moissonne sans répit, à Saint-Similien, à Vallet, à la Remaudière,
à Pontchâteau, à Landemont, à la Chevrolière, à Saint-Blaise-de-Vertou, à
Cambon, à Saint-Fiacre, en d'autres lieux, secondé, en maintes de ces missions,
par deux prêtres nantais, MM. Ernand des Bastières et Obvier. Le paroxysme de
son activité se situe en ce terrible hiver de 1709 où le verglas, le gel, la
neige alternèrent avec d'inimaginables cataractes, suivies d'inondations.
L'admirable est que toutes ces rigueurs conjuguées, qui faisaient périr
jusqu'aux chèvres, ne purent détourner de la prédication de Montfort ses foules
habituelles. C'est par ces températures inhumaines ou sous le ruissellement des
cieux que les hommes, pieds nus par pénitence, portaient au sommet des collines
les statues et matériaux des calvaires que faisait édifier Montfort. La
sainteté seule, par sa surnaturelle valeur d'entraînement, peut rendre compte de
telles abnégations collectives. Et cependant la plus triomphale, la plus
conquérante de ces missions devait voir l'apostolat de Montfort brisé dans le
diocèse de Nantes.
En mai 1709, comme cette
mission, celle de Pontchâteau, s'achevait, Montfort déclara qu'il convenait
d'ériger en ces lieux un calvaire géant. Pour le dresser, il ne voulait
d'autres ouvriers que les humbles amoureux de la gloire de Jésus crucifié, ces
hommes, ces femmes qui l'écoutaient et tous ceux aussi qui viendraient du pays breton,
animés par la même foi... Que ne pouvait-il demander ? Cette foule, que, de ses
soucis terriens, il jetait à l'Eternel, l'eût suivi jusqu'au bout du monde.
Montfort avisa, sur la lande de la Madeleine, une modeste éminence qu'il décida
de transformer en colline. Autour de ce renflement de terrain, on creusa une
douve. Avec la terre ainsi extraite, on fit le « mont » sacré. Cela signifiait
huit mille mètres cubes de terre à extraire et deux millions quatre cent mille kilos
à transporter à dos d'homme. Une muraille de quatre-vingts pieds de
circonférence soutint le sommet, une autre de quatre cents pieds encercla la
base. La croix du Christ fut taillée dans un châtaignier, orgueil des landes de
Camoël, de cinquante pieds de haut. Il fallut douze paires de bœufs pour l'amener
sur place. Flanquée des croix des larrons, elle domina chapelles et stations du
calvaire qui s'échelonnaient sur le monticule. Tout alentour, une procession
d'arbres formait rosaire : des cyprès, dix par dix, figurant les ave, des sapins les Pater. Quatre à cinq cents personnes se relayèrent, pendant quinze
mois, pour mener à bien ce gigantesque travail : paysans surtout, mais aussi
prêtres, châtelains, dames, jeunes filles. Nul autre salaire que
l'autorisation, le soir venu, de se recueillir devant la statue du Christ
crucifié. L'âme du moyen âge, l'âme des bâtisseurs de cathédrales surgissait
ainsi miraculeusement du XVIIIe siècle blasé et déjà, par larges
zones, sceptique.
Mais tandis que
s'élaborait le grand œuvre, se reformait la contradiction mystérieuse qui se
lève sous chaque pas de Montfort et freine brutalement son élan, à l'heure où
il atteint le triomphe. C'était une forteresse de la foi qu'avait élevée
Monfort. Les douves et souterrains qui la figuraient symboliquement, donnèrent
ombrage à M. de Châteaurenault, gouverneur de Bretagne, ancien homme de mer
qui, à force d'avoir pourchassé les navires anglais, avait la phobie et
l'obsession de l'Anglais dont il croyait voir partout l'action néfaste. Il
s'avisa, un peu tard, que cette construction pourrait bien servir, par
d'obscures complicités dont Montfort serait l'agent conscient ou inconscient,
la cause de ses vieux adversaires. D'où rapports, enquêtes, intrigues, et
finalement le coup de foudre de l'ordre royal à M. de Châteaurenault : « Sa
Majesté ayant sceu, monsieur, que ce Calvaire estoit plus propre à donner
retraite à des gens de mauvaise volonté qu'à entretenir la dévotion des
peuples, Elle m'a ordonné de vous écrire que son intention est que tout ce qui
a esté fait soit détruit, que les fossés soient entièrement comblez de la terre
qui en a esté tirée et les croix, les figures de dévotion et les autres
établissements supprimés. » Ainsi fut fait. Un autre cœur que celui de Montfort
eût sombré dans cet océan d'amertume. Mais lui, comme on le voulait consoler :
« Je n'en suis ni bien aise, ni fâché. Le Seigneur a permis que j'aie fait
faire ce Calvaire ; il permet aujourd'hui qu'il soit détruit : que son saint
Nom soit béni. » Et, levant les mains et les yeux au ciel : « J'aimerais mieux,
ô mon Dieu, mourir mille fois que de m'opposer à vos saintes volontés ! »
Le froncement de sourcil
du grand roi rendit Mgr Gilles de Beauvau sourcilleux à son tour. Montfort
était en pleine mission à Saint-Molf quand il reçut de l'évêque ordre de laisser
là immédiatement sa mission et de cesser tout ministère dans le diocèse de
Nantes. Il supporta ceci comme cela, sans une plainte. Il regagna la maison
dite de la Cour-Catuit, dans la rue des Hauts-Pavés, où il se retirait pour
faire oraison entre deux missions. Il avait pu l'acquérir d'une excellente
veuve chrétienne, Mme Olivier, mère de l'un des deux prêtres (l'autre étant M.
des Bastières) qui l'accompagnaient dans ses missions nantaises. Cette maison,
dont on voit encore à Nantes les murs grisâtres et les toits gondolés, on
imagine bien que Montfort ne l'affecta point à son seul usage personnel. Bien
vite, il y avait recueilli quelques mendiants, atteints d'ulcères. Il avait
constaté que la ville de Nantes laissait à l'abandon vieillards, invalides, pauvres
hères dont la médecine ne pouvait guérir les plaies purulentes. C'est un
véritable petit hôpital d'incurables qu'il avait établi ainsi, dont il s'occupait
dans les intervalles de ses missions et auquel il se voua entièrement au
lendemain de l'affaire de Pontchâteau, c'est-à-dire durant tout l'hiver de 1710
à 1711. Une de ses dirigées, qu'on appela sœur Mathurine, s'en occupait. En
décembre 1710, s'y adjoignit Mlle Elisabeth Dauvain, fille d'un marchand
drapier. L'hôpital des incurables ne fut pas la seule des fondations nantaises
de Montfort. Il créa deux fraternités, la Société des cœurs voués à Marie,
reine des cœurs, en la paroisse de Saint-Donatien, et ces Amis de la Croix à Saint-Clément,
qui lui furent l'occasion d'écrire, sous forme de lettre, une page de lumière
et de feu.
Sa présence à Nantes, si
discrète qu'elle fût et comme enfouie parmi ses pauvres, continuait d’irriter
les ennemis d'envergure qu'il s'était faits par ses audaces. Pour les administrations,
un saint est toujours un gêneur, surtout doué d'une personnalité aussi tranchée
que celle de Montfort, et les fonctionnaires n'aiment pas les « histoires ».
L'intendant général Ferrand ne pardonnait pas au missionnaire les ennuis que
lui avait, valu Pontchâteau. Sa correspondance trahit son acrimonie
persistante. C'est un fou, c'est un extravagant, écrivait-il, « M. de Nantes
(l'évêque) l'est plus que Grignion de ne pas le chasser de son diocèse. » Ces
propos colportés chatouillèrent désagréablement les oreilles de Mgr de Beauvau
qui invita Montfort à évacuer son territoire. Où aller ? Montfort offrit ses
services à Mgr de Lescure, évêque de Luçon et à Mgr de Champflour, évêque de La
Rochelle. Ce n'était pas au hasard : l'un et l'autre étaient des adversaires
résolus et militants du jansénisme et fort amis de l'apôtre. Quant à Mgr de
Lescure[8],
il était renommé pour sa piété, sa vertu, son zèle hors du commun. C'était une
sainte âme faite pour comprendre un saint. L'offre de Montfort fut, à Luçon
comme à La Rochelle, acceptée avec enthousiasme.
En mars 1711, M. de
Montfort se dirige vers Luçon, flanqué du Frère Mathurin et de M. des Bastières.
Chemin faisant, il donne une mission à la Garnache. Il en devait donner une
aussi à Saint-Hilaire-de-Loulay, sur la demande du curé, mais celui-ci, prévenu
entre temps contre le missionnaire, le chasse dès qu'il le voit. Arrivé à
Luçon, les Jésuites, auxquels il va rendre visite aussitôt, lui font fête et
aussi les Capucins qui, depuis saint François, s'y connaissent en apostolat pédestre
et peuvent saluer en lui un maître sublime de la route. L'évêque l'accueille
avec bonne grâce, le fait prêcher à la cathédrale et lui conseille de commencer
son apostolat par La Rochelle. Ainsi fait-il. En cette ville, un jésuite, le P.
Collusson, l'introduit auprès de Mgr de Champflour.
Dans les
diocèses de La Rochelle et de Luçon.
Et maintenant, pendant
six ans, son activité va surpasser celle, pourtant prodigieuse, qu'il a
déployée jusqu'ici. Epreuves d'autre sorte, contradictions, embûches, attaques,
qui mettront même maintes fois sa vie en danger, vont abonder. Mais
l'opposition ne lui viendra plus d'où elle est douloureuse entre toutes au cœur
des saints. Ce sera l'éternel honneur de Mgr de Lescure et de Mgr de Champflour
d'avoir laissé se déchaîner librement l'apôtre et de l'avoir soutenu contre
vents et marées. Grâce à eux, il va sillonner l'Aunis et la Saintonge, le
Bas-Bocage poitevin, les contours du Bocage angevin. Il va et vient du diocèse
de La Rochelle, qui, à cette époque, a sa pointe extrême à Cholet, au diocèse
de Luçon qui tient le Marais, les îles d'Yeu et de Noirmoutier. Ainsi, de fin
juillet 1712 au 28 avril 1716, jour de sa triomphante mort en plein combat,
évangélise-t-il, outre la ville de La Rochelle, au moins une cinquantaine de
gros bourgs ; et ce chiffre prend tout son sens quand on sait qu'à l'île d'Yeu,
par exemple, sa mission ne dura pas moins de deux mois et que, partout, il
prend son temps, s'acharnant à laisser derrière lui des fondations durables. La
somme de ses travaux apostoliques, quand on en a prospecté le détail, donne le
vertige.
Et que de traverses !
Ses ennemis ne cessent en tout lieu de le traquer : jansénistes, calvinistes,
conformistes de tout poil, gens bien nantis dont il dérange les aises et les
habitudes, grands seigneurs ou hauts fonctionnaires dont sa surnaturelle
indépendance bouscule les traditions ou les privilèges ou même les droits
légaux, parfois sans ménagements suffisants, mandarins de toutes catégories,
vexés de ses succès immenses, petits esprits que la grandeur irrite, et encore
et surtout la foule des pécheurs irréductibles, troublés dans leurs jouissances
et que contrarie ce continuel et lancinant rappel de la mort et des fins
dernières, cette provocation retentissante à une vie mortifiée. C'est que sa
manière est celle d'un paladin de Dieu qui partout fonce pour que Dieu passe et
tous sont excédés de cette désinvolture sublime, de cette indiscrétion totale,
de cette prédication menée, selon la recommandation de l'Apôtre, à temps et à
contretemps. Combien de fois les uns ou les autres n'ont-ils pas cherché à en
finir avec lui soit spontanément, nous l'avons vu, au cours d'une de ses offensives
spirituelles, soit par un complot soigneusement préparé! Son compagnon, M. des
Bastières, a conté comment, averti providentiellement, il empêcha Montfort de
tomber dans un traquenard où quelques misérables comptaient l'occire ainsi que
le Frère Mathurin. A La Rochelle, en 1713, la vengeance des calvinistes manqua
de peu atteindre son but. Grâce à certaines complicités, ils purent mêler du
poison à un bouillon qu'on donna au missionnaire à la fin d'un sermon. Un
contrepoison, pris aussitôt, en conjura pour l'immédiat l'effet mortel, mais
désormais Montfort n'eut plus à la disposition de son âme l'exceptionnelle
robustesse qu'il tenait de ses aïeux. S'il survécut aux maux d'entrailles qui,
accompagnés d'affreuses douleurs, le tenaillèrent durant deux longs mois, son
être physique resta miné en ses profondeurs par l'action du poison. La volonté
devait désormais suppléer à la défaillance du corps.
Montfort pensait plus
que jamais, au milieu de ses prédications, à cette Compagnie de Missionnaires
qui devait, à son exemple et sur ses pas, prêcher partout la parole de Dieu et
propager, comme un feu brûlant, la dévotion à Marie. Il partit dans ce but pour
Paris à la fin d'août 1713. Poullard des Places était mort, mais sa belle âme
candide rayonnait encore parmi les siens et Montfort obtint sans peine de son
successeur, M. Bouic, la signature d'un véritable contrat d'alliance par lequel
le séminaire du Saint-Esprit s'engageait à fournir des recrues à la future
société qui se nommait déjà, dans la pensée de Montfort, la Compagnie de Marie.
Plusieurs séminaristes se déclarèrent prêts à suivre Montfort au premier
signal. L'un d'eux, M. Vatel, devait en effet le rejoindre peu après.
Sur le chemin du retour,
Montfort saisit l'occasion de s'occuper de sa première fondation, qui lui était
si chère : celle des Filles de la Sagesse. Il s'arrêta à Poitiers pour y
encourager l'étonnante Marie-Louise de Jésus qui, depuis sept ans, s'y
consumait dans une patience infinie. Il la trouva aussi magnifiquement résolue
à attendre le moment de Dieu. Une autre jeune fille, infirmière de l'hôpital,
Catherine Brunet, vive, rieuse et charmante comme un buisson d'aubépines en
fleurs et qui, sous le pétillement de sa jeunesse, avait la générosité des âmes
fortes, aspirait à se placer sous la règle que suivait jusqu'ici la seule
Marie-Louise de Jésus. Montfort décida que l'habit lui serait donné l'année
suivante. Il ne put consacrer que quelques heures à ses filles spirituelles,
car, déjà, sa présence était éventée et l'administration diocésaine lui
enjoignait de partir le jour même.
Assurer ses fondations,
c'était son souci majeur, sa poignante anxiété aussi, car il éprouvait en lui
l'imminence de la mort. Sous l'empire de cette préoccupation, il fit l'année
suivante, au cours de l'été, un voyage à Rouen pour voir son ami Blain. Au
juste, qu'attendait-il de lui ? Un conseil ? A Nantes, à Luçon, à La Rochelle,
il ne manquait pas de conseillers éminents. Les joies de l'amitié ? Il est
invraisemblable que Montfort, ayant réalisé en lui, à un degré impressionnant,
le sacrifice de toute satisfaction personnelle, si pure fût-elle, ait consacré
à celle-ci les deux bons mois que lui prirent voyage et séjour. La seule conjecture
sérieuse est qu'il ait voulu rallier le chanoine Blain à sa Compagnie de Marie,
peut-être même pour mettre à sa tête ce prêtre de vertu solide, de jugement sûr
et si expérimenté dans les choses spirituelles comme dans l'administration
temporelle. C'est ainsi que Blain le vit un jour arriver : « sur le midi,
raconte-t-il, avec un jeune homme de sa compagnie, après avoir fait dix lieues le
matin à pied et à jeun, une chaîne de fer sur son corps et des bracelets à ses
bras ; car il était toujours muni de quelques instruments de pénitence et
souvent de plusieurs ; il ne quittait les uns que pour reprendre les autres.
Dès que je le vis, je le trouvai fort changé, épuisé et exténué de travaux et
de pénitence ; je me persuadais que sa fin n'était pas éloignée quoiqu'il n'eût
alors que quarante ou quarante-deux ans. »
Une si émouvante vision
était bien faite pour conjurer l'ombre funeste, entre eux, de M. Leschassier.
Des quelques préventions semées par le Sulpicien dans l'esprit de Blain, il ne
reste plus rien. Blain a consigné, avec une précieuse fidélité, les propos
essentiels dont fut formé l'entretien. Ce sont pages décisives sur la
psychologie de Montfort et sur la manière dont le moteur surnaturel s'est
ajusté à sa nature. Au vrai, si Montfort, comme tout le fait penser, a vraiment
voulu s'agréger Blain, le but principal de l'entretien ne fut pas atteint. Sans
doute en faut-il chercher la raison dans une des objections que fit le chanoine
de Rouen à son extraordinaire visiteur, à savoir « que, s'il voulait s'associer
dans ses desseins et dans ses travaux d'autres ecclésiastiques, il devait
rabattre de la rigueur de sa vie ou de la sublimité de ses pratiques de
perfection pour condescendre à leur faiblesse et à se conformer à leur genre de
vie ordinaire ou les faire élever à la sienne par l'infusion de sa grâce et de
ses attraits si parfaits. » C'est dire que M. Blain, chanoine considérable et justement
considéré, entendait demeurer dans les voies ordinaires ; ce n'est pas là
critique et il faut même noter, comme un trait fort sympathique de la
physionomie morale de M. Blain, que, de vertu plus commune, il ait su si bien
comprendre, admirer et soutenir, de son efficace amitié, ceux que la folie de
la Croix entraînait au delà. Au reste, Montfort ne lui tendait-il pas la perche
en répondant : « Ceux qui ne veulent pas me suivre vont par une autre voie
moins laborieuse, moins épineuse ; je l'approuve, car, comme il y a plusieurs
demeures dans la maison du Père Céleste, il y a aussi plusieurs voies pour
aller à Lui ; je les laisse marcher dans la leur ; laissez-moi marcher dans la
mienne... » « — Moi aussi, pensait assurément Blain, qui ne s'imaginait pas
sans malaise lancé sur les routes du Poitou, laissez-moi marcher dans la
mienne. » Après avoir visité les bénédictines du Saint-Sacrement et prêché une
retraite à la Congrégation du Sacré-Cœur d'Ernemont, Montfort prit congé de son
ami. Il ne devait plus le revoir.
A son retour à La
Rochelle, il s'occupa des écoles que, comme nous le verrons, il y avait fondées
pour les garçons. Quant aux écoles de petites filles, il les destinait aux
Filles de la Sagesse. Au début de 1715, il jugea le moment venu de faire venir
Marie-Louise de Jésus et sa compagne. En mars, elles étaient à leur poste ; les
dix années d'attente, prophétisées par Montfort, touchaient exactement à leur
terme. L'été suivant, Montfort donnait l'habit à plusieurs postulantes. Sa
famille religieuse prenait corps. Il se retira quelque temps dans une solitude
qu'il s'était aménagée, dès 1712, aux environs de La Rochelle : l'ermitage
Saint-Eloi, petite maison que lui avait prêtée une pieuse femme. Il y avait
composé déjà l'admirable Traité de la dévotion à la Sainte Vierge ; il y
rédigea cette fois les constitutions des Filles de la Sagesse.
Sans cesse donné à la
multitude, il aimait les ermitages — Saint-Eloi après Saint-Lazare — pour ces
retrouvailles avec Dieu seul qui étaient l'unique repos de son âme. Ainsi, en
1715, prêchant une mission à Mervent, avait-il avisé, à trois kilométrée de là,
dominant la vallée de la Vendée, dans un paysage de hautes collines,
fastueusement boisées, une colline granitique où s'ouvrait une grotte. Il y
avait jeté son dévolu, mais n'y put passer, en macérations et oraisons, que
quelques semaines. Il s'était en effet installé sans autorisation sur le
domaine de Sa Majesté et n'avait le droit de s'y livrer à aucun aménagement.
Signification lui en fut faite. Il partit, mais son souvenir demeure à jamais
sur la colline.
Mervent, Vouvant,
Fontenay-le-Comte, Saint-Pompain, Villiers-en-Plaine, ce sont ses dernières
missions...
Chers
habitants de Saint-Pompain,
Levons-nous
donc de grand matin !
Dieu nous
appelle à son festin,
Cherchons la
grâce.
Qu'il vente
ou qu'il glace,
Cherchons la
grâce et l'amour divin.
Tout le
ménage y contredit;
Le démon
crie et la chair dit :
Restez au
feu, restez au lit !
Cherchons la
grâce.
Qu'il gèle
ou qu'il glace,
Cherchons la
grâce avec Jésus-Christ!
Quand nous évoquons
aujourd'hui ce pimpant cantique de Montfort, chanté dans le frileux automne de
1715, il prend des résonances mélancoliques. L'apôtre ne devait-il pas expirer,
un mois après, au début d'une mission à Saint-Laurent-sur-Sèvre ? Mais le mot
de saint Paul s'impose ici : « O Mort, où est ta victoire ? » L'œuvre du
missionnaire des pays d'Ouest allait prendre un magnifique développement. La
survie de Montfort est aussi étonnante que sa vie.
La
méthode missionnaire de Montfort.
C'est que, conçue et
réalisée comme il a fait, la mission est un instrument apostolique d'une
extraordinaire puissance et qui s'inscrit profondément dans l'avenir comme le
soc de la charrue dans la glèbe. Trois éléments majeurs composent la mission
montfortaine, l'un spectaculaire qui va à émouvoir l'âme par les sens ;
l'autre, proprement spirituel, qui suscite, dans les profondeurs de l'être, par
la prédication et la confession, le pathétique chrétien ; le troisième, de
caractère permanent, qui, par des fondations durables, perpétue dans les âmes,
de génération en génération, les bienfaits de la mission. L'arrivée de
Montfort, escorté d'un ou de deux prêtres, d'un ou de plusieurs Frères, tandis
qu'un âne porte, dans un panier, les manuscrits, cantiques et divers, dans un
autre, la « boutique », c'est-à-dire les chapelets, étendards, images et
instruments de pénitence dont la vente couvrira les frais de la mission ; les
processions — il y en avait jusqu'à sept par mission — formées souvent, telle
celle de La Rochelle, d'illustre mémoire, de milliers de personnes, rangées en
un ordre parfait, catégories par catégories, et que distinguaient des guidons de
couleurs diverses, ou des bannières aux motifs chamarrée, parmi la musique et
les chants; les « procédés » abondants par lesquels Montfort frappait
l'imagination des fidèles : ainsi, quand il jouait, au milieu de l'église, le
rôle du mourant, assisté de deux Frères ou prêtres, l'un figurant le démon
tentateur, l'autre l'ange consolateur ; tout cela, inouï de mouvement, de
scintillement, de variété, de pittoresque, est fait pour capter les puissances
sensibles des assistants au profit de l'esprit pur. Par là-dessus, opérait au
tréfonds des âmes la prédication de Montfort, nullement improvisée, du moins
dans son ensemble, très préparée, au contraire, comme en témoignent ses
manuscrits, substantiellement nourrie de doctrine et d'Ecriture Sainte, soulevée
par le frémissement du verbe, l'ardeur de l'âme sainte, prédication telle
qu'elle subjuguait et convertissait des foules. La confession parachevait la
merveille. Enfin venaient les fondations : fondations de pierre d'abord :
églises nouvelles ou restaurées, calvaires, chapelles, statues — Montfort, qui
sculptait lui-même, et assez bien, rassemblait et utilisait des sculpteurs et
des peintres — fondations spirituelles surtout : écoles charitables, comme nous
le verrons, confréries et autres associations, portant les unes et les autres
le caractère très ascétique de la spiritualité montfortaine, cantiques composés
par Montfort et qui, monument de vingt mille vers, sont bien la plus durable des
fondations, étant chantés aujourd'hui dans l'Eglise universelle et plus à
l'honneur que jamais dans nos pays d'Ouest ; ces trois congrégations enfin qui,
la Compagnie de Marie par la prédication, les Filles de la Sagesse et les
Frères de Saint-Gabriel par l'école, perpétuent l'apostolat de Montfort.
Montfort missionnaire
n'est pas un phénomène de génération spontanée ; son génie, comme tous les
génies d'ailleurs, s'insère dans une tradition. Il s'agit ici de celle, fort
riche, des missions de Bretagne, qu'illustrèrent au XVe siècle
Vincent Ferrier et Alain de la Roche, que poursuivirent au XVIe
siècle, isolés et obscurs, mais magnifiques, un P. Morin, un P. Quintin, que
ranimèrent — et de quel feu ! — Michel Le Nobletz et le P. Maunoir. En gros,
les méthodes de ces derniers ne diffèrent pas essentiellement de celles de
Montfort, jusque dans les procédés spectaculaires les plus « gros ». C'est
toujours l'utilisation à plein des procédés collectifs. La scène du mourant
traqué par le démon, assisté par l'ange, et que l'on cite trop souvent comme la
marque d'une excentricité proprement montfortaine, il n'est pas sûr que Le
Nobletz et Maunoir n'aient pas fait aussi fort, ou davantage. De même, le trait
dominant de la dévotion mariale, selon Montfort, qui fait du chrétien l'esclave
volontaire et aimant de la Mère de Dieu, se trouve déjà dans Bérulle, dans
l'Ecole française, et, nous l'avons vu, était propagé par les Théatins de Rome.
Ici et là, l'affaire de Montfort est d'avoir porté ces initiatives à un degré
de plénitude et de perfection tel qu'elles prennent l'envergure d'une création.
Il renouvelle ce qu'il touche et le conduit au sublime par la force de sa
personnalité... Mais, si loin qu'on pousse l'étude psychologique d'un Montfort
et l'examen de ses méthodes d'apostolat, on s'aperçoit qu'une seule chose, en
définitive, peut rendre compte de résultats aussi prodigieux, et c'est la
sainteté.
Quelques
traits de l'homme et du saint.
Oraisons extatiques,
mortifications extrêmes, charité sans mesure, dont l'enveloppante et tendre
compassion ne fut jamais si grande qu'envers les plus rebutés, humilité telle
que, brutalement et dédaigneusement brisé au milieu de ses plus grands triomphes,
il n'eut jamais que le sourire de l'homme heureux, don de lui-même qui brise
toutes limites, amour des épreuves et des contradictions poussé au point qu'il
s'inquiète de telle mission sans traverses parce qu'il n'y voit pas la croix,
marque de Dieu, il y a tout cela et bien plus que cela dans Montfort, cet
amoureux de Jésus, ce serviteur de Marie comme nul ne le fut. Saint, il l'est
de telle façon qu'on ne saisit plus dans son action, dans sa pensée, un élément
qui se rattache, pour ce qui est de lui, à un souci d'ordre temporel. Il est
projeté dans l'éternel avec une incroyable violence, et si habituellement hors
de l'ordinaire que, thaumaturge aux nombreux miracles, ceux-ci disparaissent en
quelque sorte dans le miracle continuel qu'est sa vie. Il faut renoncer à le
comprendre pleinement parce qu'il a vécu, dans ses ferveurs intérieures, ce que
nous n'avons pas vécu. Par la plus belle part de lui-même, au moment que nous
le voyons agir, il est déjà sur l'autre versant.
Quand Blain lui objectait
que, s'il entendait s'associer des ecclésiastiques, il ne les pourrait
soumettre à une rigueur aussi extrême, ce n'était pas sans raison. Le caractère
absolu et véhément de sa vie intérieure, échauffée encore par les puissances de
rêve de l'âme
bretonne, lui a fait appeler d'un consumant désir des missionnaires qui « aillent
partout, le flambeau luisant et brûlant du Saint Evangile dans la bouche et le
Saint Rosaire à la main, aboyer comme des chiens, brûler comme des feux et
éclairer les ténèbres du monde comme des soleils ».
Pour les obtenir, il a
adjuré Dieu comme personne : « C'est pour votre Mère que je vous prie.
Souvenez-vous de ses entrailles et de ses mamelles et ne me rebutez pas.
Souvenez-vous de qui vous êtes fils et m'exaucez ! Souvenez-vous de ce qu'elle
vous est et de ce que vous lui êtes et satisfaites à mes vœux. » Cet idéal du
missionnaire qu'il a réalisé en sa personne n'est pas transposable tel quel
dans une règle religieuse, mais il l'a posé avec force, comme un terme
accessible, avec le secours de Dieu, aux plus généreux et, à tous, comme une
invitation à se dépasser.
A une Mère Marie de
Jésus, et à ses premières compagnes, parce qu'il les savait fastueusement
héroïques, que ne demandait-il pas ? N'a-t-il pas été jusqu'à ordonner aux
premières Filles de la Sagesse de dormir dans des cercueils pour qu'elles se
souvinssent n'être que poussière ? Mais cette recommandation, excessive à coup
sûr, Montfort n'a garde de l'inscrire dans sa règle de 1714, à l'usage de
toutes les Filles de la Sagesse. Celle-ci précise même expressément qu'il n'est
point, dans l'Institut, de mortifications extérieures imposées. Le plus
fougueux des apôtres, certes, mais aussi le plus sage des fondateurs. Quant aux
chrétiens qui vivent dans le monde, il avait la vue la plus raisonnable de ce
qui leur pouvait être demandé. Les règlements qu'il donnait à ses confréries,
voire aux Amis de la Croix, ne comportent rien de déraisonnable. A tous, il
ouvrait les perspectives enflammées où il se complaisait, mais n'exigeait de
quiconque ce qu'il ne pouvait pas donner. Les hauteurs où il était parvenu ne
lui faisaient pas oublier la plaine où peinent les hommes. Il savait que la
folie de la Croix et la consommation même de la sagesse, mais que tous ne sont
pas faits pour en recevoir la pleine lumière et en vivre l'intégrale leçon.
On ne saurait trop y
insister. Chez Montfort, être riche et complexe, la fougue du mystique, de
l'ascète et de l'apôtre, unique peut-être par son bouillonnement inapaisable et
sa tension continue, de même qu'elle ne fait jamais extravaguer sa doctrine,
nourrie des sucs les plus orthodoxes, lui laisse aussi dans l'ordinaire de la vie
— conduite des âmes ou organisation des œuvres — le jugement le plus pondéré.
S'il est, quant aux choses purement temporelles, distrait et gauche au point de
faire rire de lui, c'est qu'il en fait foin. Il s'est situé tout d'une pièce,
et une fois pour toutes, sur le plan surnaturel. Il s'y montre fort avisé,
pratique, voire bon organisateur. Directeur de l'hôpital de Poitiers, la
manufacture où travaillaient les hospitalisés relevait de lui. Or, largement
déficitaire, elle devint bénéficiaire sous sa gestion. Au cours de ses
missions, pour faire cesser les procès, générateurs de discordes et propos
salaces, il établit sous son contrôle des sortes de bureaux volants « où les
affaires sont terminées sans frais ». Va-t-il voir son ami Blain à Rouen ? Il
profite de son séjour pour étudier la règle de la jeune congrégation du
Sacré-Cœur d'Ernemont, et il s'inspirera de ses excellentes constitutions pour
établir sa règle des Filles de la Sagesse. De tels exemples pourraient être
multipliés. Il était d'ailleurs servi par une faculté d'observation fort agile
et toujours en mouvement. Certains de ses biographes veulent absolument qu'il
allât les yeux toujours baissés. Accordons-leur tout au plus qu'il les tint
mi-clos ; ses cantiques[9]
témoignent que rien ne lui échappait, même des petits ridicules de ses contemporains.
Quand Montfort fonce sur les danseurs et danseuses, le crucifix à la main, il
sait bien pourquoi :
Hélas ! comment danse-t-on ?
La manière en est infâme.
Tout inspire le poison
D'une très impure flamme;
Ces regards si doux et perçants,
Ces mouvements si pressants...
Que dire de ces baisers
Qu'on donne pour la clôture?...
Et s'il fustige les
mondaines, en ascète qui voit sous les atours le squelette de la mort, c'est
aussi avec la verve d'un satirique au regard aigu :
Voyez leurs
queues traînantes,
Leurs beaux
linges transparents,
Leurs
étoffes différentes
A trois ou
bien quatre rangs.
Leurs
écharpes composées
De morceaux
tout rapportés,
Par artifice
plissées
Avec cent
diversités.
Leur
coiffure à triple étage...
Apôtre populaire et qui
s'est délibérément voulu tel, chérissant le petit peuple et chéri de lui, il se
révèle également, en toute occasion, apte à ramener à la vraie doctrine des
esprits fort cultivés, voire familiers avec les questions théologiques. Il
obtient ainsi, dans l'élite des calvinistes de la Rochelle, des conversions
retentissantes. Et de même, maître incontesté du cantique, genre
essentiellement populaire, où il manifeste son sens incomparable de la foule et
de ses goûts, où il sait si bien faire passer, de façon aimable, imagée et
vivante, les thèmes essentiels de la doctrine chrétienne, il s'affirme, dans
ses divers écrits — Dévotion à la Sainte
Vierge, Lettre aux amis de la Croix, Prière à Dieu pour demander des
missionnaires — un des meilleurs prosateurs du XVIIe siècle
attardé et, par continuelles envolées, un lyrique puissant, riche en symboles,
dont le flot, à la fois ordonné et fougueux, charrie des expressions d'un
réalisme parfois brutal, qui agissent sur l'esprit comme des explosifs, et
dénotent la curieuse persistance, chez cet humaniste de grande lignée, du fond
primitif breton.
La manière dont on
insiste sur l'extravagance de ses manières le fait considérer par trop de gens
comme une sorte de phénomène dans le monde des saints, comme un original
fieffé, admirable assurément, mais qu'il faut se garder d'imiter, au surplus
inimitable. Ainsi risque-t-on de ne le plus voir dans sa caractéristique la
plus efficace qui est d'être un modèle pour les apôtres de tous les temps. Il
ne s'agit pas de nier, ni de minimiser son éclatante singularité. Mais il faut
en voir la cause essentielle : le caractère absolu de son détachement du monde
et de son don à Jésus crucifié. L'objection, Blain la lui a posée sans ambages,
et Montfort s'en est expliqué de la façon la plus posée et raisonnable. Il fait
remarquer : « qu'après tout, on acquérait à peu de frais dans le monde le titre
de singulier ; qu'on était sûr de cette dénomination pour peu qu'on ne voulût
pas ressembler à la multitude ni conformer sa vie sur son goût ; que c'était
une nécessité d'être singulier dans le monde, si l'on veut se séparer de la
multitude des réprouvés ; que, le nombre des élus étant petit, il fallait
renoncer à y tenir place ou se singulariser avec eux, c'est-à-dire mener une
vie fort opposée à celle de la multitude ».
Il faut encore se demander
si bien des gestes et coutumes auxquels nous contraignent les conventions mondaines
et dont le ridicule nous est masqué par la généralité de leur usage sont de soi
moins biscornus que telles des « étrangetés » de Montfort. Nombre de celles-ci,
par ailleurs, sont à imputer à des pratiques fort courantes alors jusque dans
la meilleure société. Ne vivait-il point en un temps où saint Jean-Baptiste de
la Salle, dans ses fameuses Règles de
bienséance et de civilité chrétiennes, recommandait à des gens, réputés bien
élevés, de ne pas se servir à table du mouchoir de leurs voisins et de ne pas
cracher sur les murs, chose d'ailleurs que l'on n'a point, à ma connaissance,
reprochée à Montfort. Il reste assurément, à son compte personnel, des façons
déconcertantes et qui tiennent bien, soit à une originalité de nature, soit à
quelque excès dans le mépris des contingences. Il en venait parfois, lui la
charité même, à ne pas s'aviser de l'incidence fâcheuse sur autrui de telles de
ses démarches. Ainsi quand, rencontrant Blain, il s'en détourne et part, sans
un mot, il ne veut que se mortifier, se priver d'une pure joie d'amitié, mais
ne s'aperçoit pas que, du même coup, il peine son ami. De même, quand il fait
badigeonner, sans avertir quiconque, les armoiries seigneuriales qui s'étalent
inconsidérément, selon lui, dans le lieu saint, sans doute conviendrait-il
qu'il y mît quelque tempérament. Des impairs de ce genre abondent dans sa vie.
Il les a lui-même reconnus en précisant à Blain que « s'il avait des manières
singulières et extraordinaires, c'était bien contre son intention; que, les
tenant de la nature, il ne s'en apercevait pas et qu'étant propres à
l'humilier, elles ne lui étaient pas inutiles ». C'est dire, entre autres
choses que, là-dessus, il n'entend point qu'on le suive, et souhaiterait se
corriger.
Au reste, si certains le
voudraient pareil à ces saints de tout repos, laminés par des hagiographes
circonspects, qui les rendent tous l'un à l'autre semblables comme peupliers
sur la route, bien plutôt convient-il de se féliciter que la force de sa
personnalité — même au prix de saillies excessives — fasse éclater les vitraux
tout faits. Il était de ces violents, bâtis de pied en cap pour suivre le
Maître qui est venu apporter le feu sur la terre, et non la paix mais la
guerre. Il s'est affirmé tel avec une telle force que les conformistes, historiens
ou imagiers, qui affadissent tout, ne peuvent rien sur lui. Il faut le prendre
tout d'une pièce et l'admirer comme il est. Il est la preuve éclatante que le
surnaturel ne détruit ni ne déforme la nature, mais la sublime et la jette aux
cimes, où elle resplendit avec ses traits originels et originaux. L'admirable
est que, si particulier, et par là, selon une fausse apparence, inimitable, il
demeure, pour ceux qui veulent travailler au Royaume de Dieu, un parfait modèle
et un entraîneur exceptionnel. Le résultat de ses missions — résultat tel que
nos pays d'Ouest et, particulièrement, la Vendée dite militaire, renouvelés par
lui, vivent encore de son esprit — tient à son exemple plus qu'à son génie
missionnaire ou à l'excellence de ses méthodes. Or, par ses missions, qui
atteignait-il ? Quelques âmes supérieures, sans doute, saisies au hasard de la
confession, mais surtout et essentiellement, les masses, médiocres et amorphes.
Tant de génie et de
sainteté, nous allons les voir maintenant appliqués à une œuvre capitale :
l'école charitable pour les garçons.
Procession organisée par M. de Montfort a
La Rochelle, le 16 août 1711, au cours de la mission des femmes.
Dessin d'un spectateur,
Claude Masse, ingénieur du roi, qui y a joint cette légende explicative.
(D'après le dessin de Masse, bibliothèque de la ville de La Rochelle.)
A - Bannière des
Révérends Pères Jacobins devant laquelle marchait une quantité de peuple de
tout sexe.
B - Troupe de filles du
commun peuple habillées en blanc et pieds nus.
C - Troupe de filles
marchant la plupart pieds nus, portant une croix, un cierge, un chapelet et une
image où était écrit contrat du renouvellement des promesses du baptême.
E - Guidon bleu des
filles bourgeoises.
F - Frère Mathurin
serviteur du missionnaire faisant marcher par ordre et dirigeant le chant des
différents cantiques.
G - Clercs faisant aussi
marcher par ordre et dirigeant aussi le chant des cantiques.
H - Guidon rouge pour
les femmes mariées dont quelques-unes marchaient pieds nus.
I - Guidon aurore pour
les demoiselles bourgeoises.
K - Deux dames portant des torches.
L - Deux hautbois des
canonniers qui jouaient à la fin de chaque verset que chantaient les femmes.
M - Bannière de Notre-Dame
des Sept-Douleurs.
N - Guidon noir et blanc
pour les sœurs du tiers-ordre des Jacobins.
O - Soldats de la marine
pour maintenir le bon ordre et empêcher la foule du peuple : il y en avait en
différents endroits.
P - Croix des Pères
Jacobins avec le rosaire autour.
Q - Les principaux
maîtres de danse et violon de la ville contre lesquels le Père missionnaire
s'était déchaîné dans ses sermons et qui furent payés par un bon souper comme
les sergents et les soldats.
R - M. Chauvet, aumônier
de l'hôpital, dispensateur des cas réservés.
S - M. Grignion, frère
du missionnaire, qui fit plusieurs essais de processions dans la ville et au
dehors pour accoutumer les femmes : il portait presque toujours le livre des
Evangiles.
T - M. de Montfort,
missionnaire, prêtre séculier de la province de Bretagne : il a fait déjà
plusieurs missions en ayant toujours pour principe le chapelet.
V - Le R. P. Colusson,
Jésuite, professeur au séminaire, qui suivit une partie de la procession.
X) Le R. P. Doiteau,
Jacobin, qui accompagna toujours le missionnaire dans ses processions.
Y) Sergents et soldats
du régiment des Angles et de la Lande alors en garnison à La Rochelle, pour
empêcher la foule du peuple.
II - L'APOTRE DE L'ÉCOLE
Sur l'œuvre scolaire de Montfort, il est un témoignage décisif : son
testament. Autour de cette pièce maîtresse, s'ordonnent quelques faits incontestables,
quelques textes substantiels de ses premiers biographes, notamment du précieux
Grandet, sulpicien contemporain du bienheureux, qui écrivit en 1724 et dont le
petit livre rachète l’erreur de jugement des Leschassier et des Brenier. Ceci
posé, l'historien éprouve une difficulté extrême à reconstituer, sur ce plan,
la suite des faits. Et d'abord, par un phénomène psychologique bien naturel,
les missions elles-mêmes ont absorbé trop exclusivement l’attention, non
seulement de la postérité, mais des contemporains. Leur magnificence
spirituelle et leur éclat spectaculaire, ont rejeté dans la pénombre des
réalisations d'un intérêt capital, mais qui se perdent dans la grisaille de la
vie courante, telles les Confréries — Amis de la Croix et autres — que Montfort
a couvées avec amour, telles surtout les écoles charitables, dont la splendeur
est celle du diamant dans la mine. Il est patent aussi que la personnalité
savoureuse de Montfort a mis en vedette les anecdotes pittoresques dont sa vie
foisonne, au détriment souvent de la part la plus importante de son apostolat.
L'image d'Epinal a submergé l'histoire. Il faut encore compter avec nombre de
documents disparus — parfois de façon singulière — ou actuellement
inaccessibles. De larges zones de nuit s'ouvrent ainsi soudain, au moment qu'on
croyait accéder à la lumière.
Y a-t-il eu d'ailleurs cheminement logique et suivi dans l'apostolat
scolaire de Montfort ? Assurément non. Sans cesse traqué, persécuté, contrarié,
rejeté d'un diocèse dans un autre, au surplus presque toujours sur les routes,
appelé pour une mission, tantôt ici, tantôt là, Montfort n'a travaillé à ses
plus chères institutions que d'une façon irrégulière, pressée, bousculée, voire
clandestine, étant à la merci le plus souvent de quelque foudre épiscopale ou
de quelque puissante cabale. Il s'en occupait au hasard de ses itinéraires
imprévisibles, parfois avec des intervalles de plusieurs années. Passait-il à
Nantes, il complétait l’organisation de son hôpital des incurables, vaquait au
recrutement et aux besoins spirituels des Amis de la Croix. Donnait-il à
Poitiers quelques heures? Il en profitait pour réconforter Marie-Louise
Trichet, lui donner ses instructions ou alimenter la ferveur de ses
associations de jeunesse. Dans ces conditions, comment s'étonner que, sur les
trois familles religieuses dont il est le fondateur, l’une soit posthume, et
les deux autres, au jour de sa mort, à l'état embryonnaire? Il convient plutôt
d'admirer qu'il ait pu, nonobstant des traverses inouïes, animer ces germes
d'un tel souffle qu'ils se soient développés, après lui, en magnifiques
instituts. Et comment oublier qu'il est mort à quarante-trois ans? A cet âge,
Ignace de Loyola venait à peine de faire, avec ses six premiers compagnons,
acte de société religieuse.
Il va de soi que, dans ces conditions, il faut faire large part aux
inductions, déductions et hypothèses, si l'on veut aller au delà de ce qui est
essentiel et incontestable, à savoir que Montfort a fait l’école, notamment à
La Rochelle et que, comme il appert du testament, parmi les Frères qu'il a
groupés autour de lui, il y eut des Frères enseignants, ayant expressément reçu
de lui mission de faire l'école. Hors cela, l'étude des milieux qu'il a
traversés, nombre de recoupements intéressants, et certaines trouvailles
récentes de chercheurs infatigables et d’érudits locaux
[10]
enrichissent ce fonds primitif de
conclusions présentant le caractère le plus sérieux de vraisemblance, la
probabilité la plus voisine de la certitude, conclusions telles, à vrai dire, que
les rejeter reviendrait à récuser, au plus grand dam de l'histoire générale,
certaines des plus saines méthodes de la critique historique. La psychologie,
qui est une indispensable auxiliaire de l’histoire, surtout là où le document
direct défaille, va nous aider à frayer le chemin de l'apostolat scolaire dans
la forêt touffue de la biographie montfortaine.
Au
séminaire de Saint-Sulpice.
En 1696, quand
Louis-Marie Grignion entra dans la petite communauté de M. de la Barmondière,
la question de la rénovation des écoles populaires gratuites était en pleine
effervescence. Elle occupait nombre de bons esprits et de cœurs généreux. Cinq
ans auparavant, Jean-Baptiste de la Salle — que Louis-Marie dut croiser bien
souvent dans le quartier de Saint-Sulpice — s'était rendu à Paris, appelé
précisément par M. de la Barmondière, pour prendre en main l'école paroissiale.
Il commençait d'y établir et d'y perfectionner ses célèbres méthodes. Au juste,
de quoi s'agissait-il?
Depuis les temps les
plus lointains, l'Eglise donnait toute sa sollicitude à l'instruction des
pauvres. Elle l'avait inspirée, guidée, encadrée tout au long du moyen âge. Au
coure de la Renaissance, elle s'était appliquée à faire bénéficier les masses,
dans toute la mesure du possible, du puissant courant culturel de l'humanisme.
L'énorme événement que fut le concile de Trente eut sa répercussion sur l'école
populaire. Les Pères en proclamèrent le caractère d'urgence, la nécessité
sacrée ; ils insistèrent sur la gratuité. Les remous les plus b:enfaisants
s'ensuivirent, mais les écoles avaient sombré dans l'anarchie générale des
guerres religieuses. Les bonnes volontés demeurèrent impuissantes jusqu'en
cette première moitié du XVIIe siècle où, l'ordre public aidant, une
poignée d'hommes, dont la valeur égalait l'ardeur, et qui furent à la fois les
prophètes et les metteurs en œuvre de l'école populaire, primaire et moderne,
déclenchèrent le courant victorieux. Ce n'étaient d'ailleurs pas des isolés ;
ils puisaient une bonne part de leur force dans les confréries du temps dont
l'activité était grande ; ils rencontrèrent, dans les milieux ecclésiastiques,
un accueil très favorable, voire enthousiaste. La cause des « petites écoles »,
comme on disait alors, fut merveilleusement propulsée par le maître livre d'un
anonyme : « l'Eschole paroissiale » et par le manifeste d'un prêtre de Lyon,
pédagogue de premier ordre et âme de feu : Charles Démia. Ses Remontrances sur la nécessité et utilité
d'un établissement des écoles pour les pauvres furent un véritable coup de
clairon qui réveilla les plus endormis. En même temps que Démia, surgissaient
Nicolas Roland, le P. Barré, l'austère et percutant Adrien Bourdoise. Sous
leur impulsion ou leur initiative directe, les « petites écoles » charitables
allèrent se multipliant, d'abord à Lyon, à Rouen, à Paris.
Cela n'allait pas sans heurts
ni fracas, car elles bousculaient bien des intérêts en place, bien des puissances
solidement constituées en privilèges et considération. L'intérêt de
l'expérience nouvelle, les luttes épiques qu'elle suscita échauffaient les
conversations sur le territoire de Saint-Sulpice où œuvraient Jean-Baptiste de
la Salle et ses Frères. On pense bien qu'elles ne manquaient pas de pétiller
particulièrement au séminaire de Saint-Sulpice et dans ses communautés annexes.
Les séminaires sont un des milieux où les idées généreuses fermentent le plus
intensément, l'ardeur de la jeunesse s'y doublant des feux d'un zèle admirable
et ingénu, que parfois les directeurs sulpiciens doivent refouler, pour le plus
grand bien de la formation, dans les calmes régions de la vie intérieure.
Louis-Marie, s'il ne parlait guère, écoutait beaucoup, quand les choses de Dieu
se trouvaient en cause. Nul doute qu'il ne se soit enflammé, dès alors, pour
l'enseignement populaire chrétien. Autour de lui, la ferveur pour cette cause
était extrême et en quelque sorte consubstantielle à Saint-Sulpice depuis M.
Olier. Au reste, un instinct profond et des expériences précoces avaient déjà
orienté Louis Grignion vers l'apostolat scolaire. Au Bois-Marquer, son prosélytisme
auprès de ses frères et sœurs, ou de camarades plus jeunes était un des traits
majeurs de sa première enfance ; il les entraînait au catéchisme, à la
récitation du chapelet, à toutes pratiques religieuses. Etudiant au collège de
Rennes, ses parents, quand ils le rejoignirent, en avaient fait le précepteur
de ses deux frères cadets ; dans ses moments libres, il les formait aux études
latines. Nous avons déjà noté son action catholique de jeune homme à Rennes :
hôpital et congrégation de la Sainte Vierge. Ainsi, à Saint-Sulpice, Louis
Grignion, c'est déjà un jeune pédagogue, vers qui affluent torrentiellement les
échos de la grande réforme scolaire. Il était donc particulièrement disposé à
les entendre et à en bénéficier.
Comme tous les
séminaristes, ses condisciples, il était affilié à l'Association de prières,
fondée en 1649 par Bourdoise « afin d'obtenir des maîtres chrétiens pour
l'enfance ». Cela est capital, car, en un Montfort, nulle grande pensée ne se
réalise si elle n'est mûrie dans la prière. De ce jour, celle de l'enseignement
populaire s'est installée au cœur de sa vie intérieure et n'a pu qu'y pousser
de profondes racines. De plus, à Saint-Sulpice, Louis Grignion a déjà passé de
la prière à l'action. Pour former les jeunes clercs à l'apostolat et les
initier à la vie paroissiale, les maîtres de Saint-Sulpice tenaient à ce que
les plus anciens d'entre eux fissent le catéchisme aux enfants du peuple. Ils
étaient soixante-dix environ qui se livraient dans la paroisse à cet
enseignement, préparaient les enfants à la première communion, à la
confirmation ; ils continuaient à s'occuper d'eux par la suite. Les dimanches
et fêtes, ils faisaient le prône aux enfants des écoles et instruisaient les
écoliers des pensions. En carême, ils donnaient des conférences aux ouvriers,
aux laquais. Louis-Marie, tôt choisi pour cet apprentissage, y excella par un
don naturel de la parole comme par une grâce singulière pour convaincre
l'esprit et émouvoir le cœur, par une effusion de l'âme à quoi ses jeunes
auditeurs ne résistaient pas et qui les conduisait à un redressement sérieux,
et même à une vie pénitente. Ainsi se révélait le futur convertisseur aux
succès étonnamment durables. Pour les catéchismes de carême, il fut adjoint au
grand apôtre des ramoneurs, l'abbé de Flamanville, celui-là qui, devenu évêque
de Perpignan, devait l'ordonner prêtre. Au cours de plusieurs années, il
évangélisa ainsi ces petits êtres, couleur de ténèbres, qui, grâce à lui,
voyaient, au bout de leurs cheminées, un ciel d'où leur souriait l'ami divin des
enfants. Comme fit Jean-Baptiste de la Salle, Louis Grignion s'en allait par le
quartier, agitant une clochette qui faisait surgir, de toutes les rues et
venelles, des troupes de gamins qui l'escortaient jusqu'au lieu de
l'instruction. Il avait ainsi occasion de visiter les « petites écoles ». Ce
contact intime et fréquent avec les enfants du peuple, cette première
expérience pédagogique, cette fréquentation du monde scolaire, ce puissant
courant, où il baigne, de rénovation de l'enseignement populaire ont pris
nécessairement une valeur exceptionnelle dans une intelligence comme la sienne,
aussi personnelle et profonde qu'étendue et brillante. Le problème scolaire
qu'on agitait autour de lui, il n'a pu manquer d'en penser les données
générales et aussi les aspects techniques.
Le jeune prêtre qui, en
1700, quittait Paris pour rejoindre à Nantes la communauté de Saint-Clément,
était surtout habité par l'idée-force que propageait Adrien Bourdoise : « Pour
qu'une école devînt utile au christianisme, il faudrait des maîtres qui
travaillassent à cet emploi en apôtres, et non pas en mercenaires, comme si
c'était un chétif métier du commun, inventé afin d'avoir du pain. » Pourvoir
les écoles charitables de maîtres capables, mais qui surtout conçussent leur
fonction comme un apostolat, c'était la clef du problème; Jean-Baptiste de la
Salle l'avait génialement compris. Ces maîtres existaient, selon une formule
parfaite : ils s'appelaient les Frères des Ecoles Chrétiennes. Mais ils
n'étaient alors qu'une petite équipe, leur institut ne devait être approuvé
qu'en 1725; nul ne pouvait prévoir leur développement ultérieur, ni même s'ils
réussiraient à durer. Avant Nantes, Montfort pensait-il à tenter un effort
analogue ? Ce ne pouvait être, en toute hypothèse, sous le même angle. Montfort
part pour la conquête des âmes en missionnaire; la fondation d'écoles, le
recrutement de maîtres-apôtres ne peuvent se présenter à lui comme un programme
destiné à l'absorber tout entier, mais comme une initiative particulière
insérée dans le cadre des missions qu'il rêve et qui sont sa vocation propre.
Cela, il est possible,
et même, à mon sens, probable qu'il le portait en lui à son départ de Paris.
C'est le 6 novembre 1700 que, dans une lettre à M. Leschassier, il formule son
vœu d'une « petite et pauvre compagnie de bons prêtres qui... aillent de
paroisse en paroisse, faire le catéchisme aux pauvres paysans... ». Plus tard,
quand il ébauchera le règlement de la société religieuse qui sera la Compagnie de
Marie, il disposera que ladite Compagnie recevra des Frères laïques. Dès 1700,
ces deux perspectives, distinctes et complémentaires, étaient-elles associées
dans son esprit ? J'inclinerais à le croire, car, nous le verrons bientôt, — en
1705 — se saisir de la première occasion de recruter des Frères. Et comment
n'eût-il pas désiré, dès alors, qu'une des attributions de ces Frères fût
l'école, son âme étant toute vibrante de l'objurgation de Bourdoise ?
L'école
de l'hôpital de Poitiers.
Quoi qu'il en soit,
Poitiers le mit en plein exercice scolaire. L'hôpital, en effet, comportait,
comme la plupart des hôpitaux de l'époque, une école charitable où étaient
instruits, de sept à treize ans, les enfants hospitalisés, et quelques illettrés
adultes, soucieux d'apprendre à lire et à écrire. L'aumônier était de droit
maître d'école. « Il enseignera, disait le règlement, à chacun desdits pauvres
à lire et à écrire et les divertira chacun d'une heure de leur travail pour y
vaquer. » En fait, la plupart des aumôniers ne s'en souciaient guère et s'en
remettaient de ce soin à des personnes généralement peu qualifiées.
C'est ainsi que M. de
Montfort, quand il entra comme aumônier à l'hôpital, à la fin de novembre 1701,
y trouva un Jacques Tavernier qui cumulait les fonctions de maître d'école avec
celles d'économe et de directeur de la manufacture[11].
Quoi d'étonnant? Dans une lettre à M. Leschassier, Montfort écrivait lui-même
des aumôniers : « Il n'y en a point de fixe dans l'hôpital depuis un temps
considérable, tant il est pauvre et abandonné. »
Tavernier se posa très
vite en adversaire de Montfort. Celui-ci avait commencé par refuser tous
honoraires et choisir comme logement une misérable chambre réservée à
l'ordinaire aux contagieux. On devine l'effet que pouvait produire sur un
fonctionnaire des manières aussi « singulières ». Pour comble, Montfort ne
s'avisa-t-il pas de n'accepter de nourriture que celle des domestiques, ou même
de manger avec les pauvres et de leurs restes? Par son refus réitéré de prendre
ses repas à la table commune des officiers et officières, comme par les
réformes qu'il introduisait à l'hôpital, Montfort acheva de s'aliéner
Tavernier. Celui-ci fut le principal animateur du complot qui contraignit
Montfort à se réfugier chez les Jésuites. Quand il en sortit, Tavernier était
atteint de cette mystérieuse maladie qui décima les fauteurs de cabale et ne
décima qu'eux. Il ne tarda pas à mourir. Dès sa mort, survenue en mars 1702,
les fonctions d'économe et de directeur de la manufacture furent confiées à
Montfort en sus de celles d'aumônier. A ce dernier titre comme à celui de
successeur de Tavernier, il assuma obligatoirement la charge de l'école : deux
cents gamins et gamines environ, orphelins, bâtards, enfants abandonnés et
trouvés, fleurs de pavé, marmaille de misère, bien faits pour émouvoir les
entrailles de sa charité.
Mais il ne lui était pas possible d'assumer à la fois trois charges dont
une seule eût suffi à absorber «on activité. Il ne tarda pas à suggérer à
l'évêque de nommer un maître d'école qui n'aurait d'autre occupation que
d'enseigner, réforme dont l'hôpital bénéfi
cierait
grandement. Or, en ce même mois de mars, Mgr Girard mourait. Montfort dut
attendre que son successeur arrivât. Il eut ainsi à faire la classe cinq ou six
mois, jusqu'aux vacances scolaires qu'il passa, comme on sait, à Paris. Le 7
octobre 1702, Mgr de la Poype de Vertrieu était nommé au siège de Poitiers.
Grand prélat que
celui-là, de haute vertu et de ferme doctrine, produit authentique et
remarquable de cette réforme du clergé, entreprise par les Olier, les Bérulle,
les Condren, et les maîtres de Saint-Sulpice qui l'avaient formé et le tenaient
pour « un des plus parfaits modèles de l'ordre ecclésiastique ». Jeune homme,
son goût pour la vie pénitente était tel qu'il pensa se faire Chartreux. Il se
manifestait un excellent orateur, au verbe châtié, une belle intelligence, personnelle
et meublée de connaissances solides, surtout en matière théologique. Il devait
aussi se révéler bon organisateur, très appliqué aux devoirs de sa charge.
Durant les trente ans qu'il occupa le siège de Poitiers, il ne devait quitter
son diocèse que deux fois, exemple mémorable en un temps où certains évêques
passaient encore trop souvent à la Cour de Versailles le plus clair de leur
temps. La qualité et la ferveur de sa vie intérieure le disposaient à
comprendre un Montfort. De fait, il le soutint, sauf, nous l'avons vu, à deux
reprises, dont la dernière marqua l'élimination définitive du grand apôtre. Les
armes épiscopales de Mgr de la Poype portaient Nec temere, nec timere. Belle devise, mais il arrive parfois qu'à
vouloir se tenir toujours à égale distance de la pusillanimité et de la
témérité, on s'enfonce dans une prudence excessive, et que la volonté balance
entre des décisions contradictoires. Mgr de la Poype, il est vrai, pouvait
légitimement craindre que, du furieux bouillonnement des esprits, entretenu par
l'apostolat, superbement agressif, de Montfort ne sortît quelque dommage dans
son diocèse. L'administration épiscopale ne peut se donner le luxe de mépriser
toutes les contingences.
A peine le contact pris
avec son diocèse, Mgr de la Poype alertait les Sulpiciens de Paris pour qu'ils
découvrissent et lui envoyassent sur-le-champ Montfort, attardé dans la
capitale et que les pauvres de l'hôpital réclamaient à grands cris. Fin
octobre. Montfort est à Poitiers et entretient l'évêque de l'affaire de
l'école. Il rencontrait bonne oreille pour l'entendre. Mgr de la Poype mettait
l'éducation chrétienne au premier plan de ses devoirs épiscopaux. Lui aussi,
dans l'ambiance de Saint-Sulpice, avait saisi toute l'importance de la question
des écoles charitables ; il allait d'ailleurs, à cet égard, faire œuvre
admirable dans son diocèse. Les raisons de Montfort lui parurent excellentes
et, à sa demande, il interposa son autorité pour que l'hôpital fût pourvu d'un
maître d'école, dégagé de toutes autres occupations que l'enseignement. Le
bureau de l'hôpital renâcla, sans doute pour des raisons d'économie (à poste
nouveau, en effet, crédits nouveaux) et ne céda qu'à la condition formelle que
le titulaire fît l'école bénévolement et payât pension pour sa nourriture.
Cette chicane administrative n'est pas sans intérêt pour l'histoire de
Montfort. Le nouveau maître, Thomas Bastard, pour occuper un poste non
rétribué, ne pouvait être mû que par l'amour de Dieu et de ses pauvres. Il n'est
pas téméraire de penser qu'il venait de cette association de jeunes gens fondée
par Montfort et dont les meilleurs brûlaient de sa flamme. L'un d'eux, Alexis
Trichet, frère de Marie-Louise de Jésus, ne devait-il pas lui-même, en 1708,
lui succéder, après M. Lebrou ?
D'octobre 1702 à mars
1703, et, derechef, à partir d'avril 1704, pendant un temps indéterminable —
quelques semaines, peut-être quelques mois — Montfort a eu certainement à
connaître et même à s'occuper du fonctionnement de l'école. Directeur de la
manufacture, où les enfants se formaient à divers métiers, il avait à prendre
souci de l'instruction qu'ils recevaient et d'ailleurs, nous l'avons vu, son
zèle s'étendait à tout. Or une expérience intéressante se pratiquait à l'école.
Mgr de la Poype était
arrivé à Paris, enthousiaste de la méthode d'enseignement conçue et pratiquée
par M. Démia à Lyon, au point que, dans une requête adressée au roi en 1707, il
écrivait : « Comme j'ai été témoin longtemps à Lyon des fruits merveilleux
qu'ont produits ces écoles charitables des pauvres... j'ai cru ne pouvoir rien
faire de plus utile pour la ville de Poitiers et pour mon diocèse dès que j’y
ai été nommé... que de me servir de la même méthode qui se pratique à Lyon...
Je supplie Votre Majesté d'ordonner que les administrateurs de l'hôpital général
soient obligés de faire instruire les jeunes garçons reçus audit hôpital par un
maître d'école selon la méthode que j'ai établie et fait pratiquer. » Cette
méthode, Mgr de la Poype devait la codifier lui-même dans un opuscule destiné
aux écoles charitables du diocèse, qu'il fondera plus tard. A Poitiers,
Montfort a veillé à son application; elle lui deviendra familière et chère;
bien mieux : il l'appliquera lui-même à La Rochelle et il la fera appliquer par
les Frères du Saint-Esprit et les Filles de la Sagesse. Son brusque départ de
Poitiers en 1704 ne lui a cependant pas permis de bénéficier pleinement de
l'insigne exemple de Mgr de la Poype, un des évêques du temps qui ont le plus
fait, et avec le plus d'intelligence, d'esprit de suite et de succès, pour la
cause des écoles charitables. Celles-ci se multiplièrent dans son diocèse ;
chaque paroisse voulut avoir la sienne. Du moins, ce que Montfort en a vu s'est-il
imprimé profondément dans son esprit. Son séjour à Poitiers a été pour lui un
véritable stage pédagogique, surtout en l'initiant à une méthode, que Jean-Baptiste
de la Salle avait largement dépassée en excellence, mais qui reste d'une incontestable
valeur.
Les
premiers Frères.
En 1705, nouvelle étape.
Montfort découvre et entraîne celui qui sera son premier compagnon et le premier
des Frères. Se trouvant dans l'église des Pénitents de Poitiers, il y voit
entrer un jeune homme, de modeste accoutrement. Par une de ces divinations qui
lui sont familières et signalent en lui le passage en trombe de l'esprit de
Dieu, il fait signe à l'inconnu d'approcher. Il l'interroge, apprend que son
intention est d'entrer chez les capucins. Aussitôt, il l'en dissuade, et
l'invite à le suivre pour le servir dans ses missions, car, d'une prescience
irrésistible, il sait, qu'entre tous, c'est ce passant, non un autre, que Dieu
lui destine. Sans hésiter, le jeune homme le suit. Nous sommes ici dans la pure
atmosphère évangélique ; il semble d'ailleurs qu'entre autres providentiels
desseins, Montfort ait été suscité pour imposer la resplendissante image de
l'absolu évangélique aux yeux trop charnels, aux consciences perpétuellement
tentées par le compromis avec l'esprit du monde.
Mathurin Rangeard, — qui
vient de décider ainsi de son destin — est le fils d'un vigneron de
Bouillé-Loretz, dans les Deux-Sèvres. Né le 7 novembre 1687, il a donc dix-huit
ans, l'âge des folies avilissantes ou des générosités fastueuses. Sa force
d'âme, sa fidélité ne se démentiront pas. Après quelques mois de vie commune à
Poitiers, Montfort, ayant décidé d'aller à Rome, laissa Frère Mathurin au
prieuré de Ligugé, pour qu'il l'y attendît jusqu'à son retour. Ce ne fut point
pour légère raison; le prieuré, alors annexe du collège de Poitiers, était occupé
par les Jésuites, donc par des protecteurs et amis. Montfort les savait consommés
en formation ascétique; le séjour de Frère Mathurin à Ligugé, de février à fin
août 1706, fut l'équivalent d'un noviciat. Au reste, c'est la vie, non d'un
auxiliaire temporel quelconque, mais, bien qu'il n'ait jamais fait de vœux,
d'un véritable religieux très mortifié que va mener, Montfort revenu, Frère
Mathurin. Il partagera celle de son maître et ce sera en profondeur ; il
l'accompagnera dans nombre de ses rudes randonnées apostoliques, heurtant ses
pieds saignants aux cailloux des chemins ; ainsi on relève sa présence au mont
Saint-Michel en 1706, à Rennes, à Dinan, à Saint-Brieuc en 1707 ; il ralliera
les gens pour les missions, ordonnera les processions et notamment celle de La
Rochelle, le 16 août 1711, exercera les fidèles au chant des cantiques, leur
fera réciter le Rosaire, distribuera images et petites croix, fera le
catéchisme ou, nous le verrons, l'école ; cela, sans négliger la cuisine des
missionnaires, que les principes de Montfort rendaient, à vrai dire, fort peu
encombrante, et la bricole des missions. Les plus humbles tâches matérielles,
il les fait dans l'esprit religieux qui est d'obéissance, d'humilité, de
pauvreté. Montfort, d'ailleurs, l'associe de très près à sa vie pénitente. Il
l'entraîne, malgré son tempérament délicat, aux macérations qu'il varie avec
une effrayante et admirable ingéniosité. Il lui apprend à supporter, mieux : à
aimer les humiliations de toutes sortes, le dénuement absolu, les contradictions
incessantes qui le rejettent lui-même de ville à ville, comme la balle d'un mur
à l'autre.
Admirons Frère Mathurin
et les compagnons qui viendront. Ils témoignent magnifiquement que la mission
de Montfort est bien de Dieu. Ces humbles eussent dû, en simple logique
humaine, être troublés dans leur vocation, détournés de leur Père spirituel, à
voir tant de hauts personnages ecclésiastiques poursuivre ce dernier de leur
réprobation, et tant d'interdits pleuvoir sur lui. Cependant, Montfort n'a
jamais été chassé d'un diocèse sans que le suivît exactement son ombre, qui
était l'un ou l'autre de ses Frères. C'est qu'ils éprouvaient tous. Mathurin en
tête, que nul n'avait jamais ressemblé davantage que leur maître à notre Maître
à tous : Notre-Seigneur Jésus-Christ.
Frère Mathurin devait
avoir une certaine instruction puisqu'il fit l'école et reçut, en 1721, la
tonsure. La façon dont il faisait le catéchisme nous en assure aussi ; il y
excellait si bien que les plus bornés en accédaient à la connaissance des
vérités chrétiennes et il pénétrait ses commentaires de tant de foi et de piété
que les parents des enfants aimaient à y assister. Il était au surplus « bien
honnête », comme disent les bonnes gens, poli, prévenant, nuançant les marques
extérieures de respect. Sa charité, qui était grande, portait au comble cette
civilité naturelle.
Dans le cours de 1707,
Frère Jean s'était joint à M. de Montfort et au Frère Mathurin. Son état civil
nous est inconnu, de même que l'ordre précis de ses occupations. Il ne semble
avoir fait ni le catéchisme ni l'école ; il vaquait aux travaux matériels des
missions. Quand il fut décidé d'affecter sœur Marie-Louise de Jésus et sa
compagne aux écoles de filles de La Rochelle, c'est lui qui fut dépêché par
Montfort à Poitiers pour les conduire à La Rochelle.
En 1708, un troisième
Frère s'adjoignait à l'équipe : Jacques-Marie Burgard. Né en 1680 à
Saint-Pierre-du-Luc, en plein Bocage, il avait donc vingt-huit ans quand il
devint Frère Jacques. Avec le Frère Mathurin, il ouvre la série des Frères
enseignants. Il est aussi un de ceux qui ont le plus souvent accompagné
Montfort dans ses courses interminables. Il le fit du moins, nous le savons,
vingt-trois mois d'affilée. Il est mêlé à l'un des épisodes montfortains les
plus hauts en couleur et les plus émouvants : le transfert à Nantes des statues
du Calvaire de Pontchâteau ; la tâche de destruction, ordonnée par le roi,
n'ayant pas été terminée, elles se trouvaient abandonnées sur la lande de la
Madeleine. Or Montfort, qui mettait aux œuvres de Dieu une obstination sublime,
ne désespérait pas de rebâtir son Calvaire. Dans cette éventualité, il voulut
récupérer ses « figures », comme on disait alors. Et d'écrire à M. de la
Carrière, curé de Pontchâteau, le 29 janvier. 1711 : « Monsieur, le pur amour
de Dieu règne en nos cœurs. Je vous prie de livrer au porteur et à Nicolas, par
la voie qu'ils auront, mes figures. Ce transport est nécessaire pour ma
délivrance et pour l'obéissance pour l'amour de Dieu. S'il ne voulait, il
ferait plutôt un miracle pour empêcher qu'elles ne fussent transportées et
quoiqu'on les apporte ici, ce ne sera que pour retourner avec plus de gloire au
Calvaire, lorsque la chapelle sera bâtie. On a écrit à Paris pour cela et j'ai
plus d'espérance que jamais. Il faut d'autant plus de travaux, d'attente et de
prières et de croix que cette œuvre doit être grande. Tout vôtre en Jésus et
Marie. » Toutefois, ce fut seulement quatre ans après, en 1714, à son retour de
Rome, que Montfort put accomplir son pieux désir, aidé non par Frère Nicolas,
dont parle sa lettre, mais par Frère Jacques, qui, alors dans la plénitude
d'une force physique peu commune, était bien fait pour cette tâche. L'un et
l'autre eurent peine infinie à charger, sur deux charrettes, ces pesantes et
énormes statues. Cahotées par les légendaires ornières de Bretagne, elles
parvinrent au bord du fleuve. Là, nouvelle complication : un terrain marécageux
séparait les charrettes du bac qui attendait sur la Loire. De telles
difficultés, un Montfort se rit ; il s'engage dans la vase, où il enfonce
jusqu'aux genoux, tend le dos, y reçoit la pièce maîtresse, le grand Christ,
détaché de sa croix géante, parvient, à travers le clapotis gluant du marais,
jusqu'à la barque, et revient, tandis que, sur la rive, un groupe de bateliers,
loin de lui donner un coup de main, s'esclaffe. Par ce moyen, héroïquement
primitif, Frère Jacques et lui, se relayant, déchargent et rechargent toutes
leurs « figures », qui prennent le chemin de la cour Catuyt où elles attendront
trente-cinq ans la résurrection du Calvaire de Pontchâteau. Tels étaient les
travaux aux-quels Montfort associait les Frères ; il en faut avoir quelque
idée pour mesurer la grandeur d'âme de ces humbles compagnons.
C'est par Frère Jacques
— bienfait insigne — que nous ont été transmis plusieurs des écrits de Montfort
et notamment l'admirable « Secret de
Marie ». Et c'est lui encore qui est le héros très discret d'une conversion
retentissante, celle de M. le curé de Saint-Pompain en personne. Ce dernier suivait
en effet la mission, donnée par Montfort dans sa paroisse, du cœur le plus sec,
selon son propre témoignage, et à la façon d'un fonctionnaire ennuyé. Le démon
le tenait depuis longtemps par là, je veux dire par le dégoût des choses de
Dieu. Or voici qu'une voix s'élève du fond de l'église, une voix pure,
frémissante, et comme sanglotante : « J'ai perdu mon Dieu par mon péché. »
C'est Frère Jacques qui entonne un des plus beaux cantiques de Montfort. M. le
curé n'y tient plus. Le texte, chanté de si émouvante façon, le transporte en
des cieux oubliés. Ruisselant de larmes, il se jette aux pieds de Montfort, qui
souffle sur la flamme allumée par Frère Jacques. C'en est fait désormais ! Il
deviendra, sinon un curé d'Ars, du moins un pasteur très zélé.
Dans l'histoire
montfortaine, Frère Pierre glisse très discrètement. On sait seulement de lui
qu'il fut guéri par Montfort. Le fait s'étant passé à la mission de Vertou en
1708, il est avéré que Frère Pierre avait rejoint le bienheureux à peu près
dans le même temps que Frère Jacques, sinon avant. Il tomba malade comme la
mission battait son plein et même réussissait trop aisément au gré de Montfort,
pour qui l'épreuve était le signe divin : « Nous sommes ici trop aimés,
disait-il à M. des Bastières qui missionnait avec lui. Voilà ce qui me fait
souffrir. Pas de croix, quelle croix ! » Au bout de douze jours, la maladie du
Frère Pierre tournait si mal qu'on pressa Montfort de donner à son
collaborateur l'extrême-onction, mais lui : « Pierre, où est votre mal ? — Par
tout le corps. — Donnez-moi votre main. — Je ne puis. — Tournez-vous de mon
côté. — Cela m'est impossible. — Avez-vous la foi ? — Hélas ! mon cher Père, je
voudrais bien en avoir plus que je n'en ai. — Voulez-vous m'obéir ? — De tout
mon cœur. — Eh bien ! fait Montfort en posant sa main sur la tête du mourant,
je vous commande de vous lever dans une heure d'ici. » Une heure après, Frère
Pierre était sur pied, tout gaillard, et servait à table les missionnaires.
Frère Nicolas est le
dernier des compagnons identifiés de Montfort que d'authentiques anecdotes
fassent revivre à nos yeux avec quelque relief. Il est, aux termes du testament
du bienheureux, un des quatre frères qui firent des vœux de religion. Dans
l'été de 1714, il accompagna Montfort tout au long de son voyage à Rouen, l'un
des plus pittoresquement épiques qu'il ait faits. Sur le seuil de sa porte,
vers midi, le bon chanoine Blain vit arriver son ami « avec un jeune homme de
sa compagnie, après avoir fait six lieues le matin, à pied et à jeun, avec une
chaîne de fer autour du corps, et des bracelets de fer au bras ». Et, comme la
naturelle faculté d'observation de Blain est aiguisée par l'ébahissement où le
jette une mortification aussi frénétique, il a tôt fait de remarquer à quoi
occupait son temps Frère Nicolas, tandis que Montfort et lui causaient ou
visitaient les couvents. Il fabriquait, note-t-il, « des chaînettes et des
disciplines de fer », instruments familiers à la « boutique » des missions. Ces
précisions, et d'ailleurs tout ce qu'on sait de cette randonnée pédestre aller
et retour, — trois cents lieues en deux mois, — à travers la Bretagne et la
Normandie, explique qu'à l'arrivée Frère Nicolas, d'ailleurs tout jeune encore,
fût fatigué à en rendre l'âme. Montfort lui aussi était épuisé, mais il était
bâti comme un dolmen. Il s'offrit à porter Nicolas sur son dos, comme il avait
fait de la croix, là-bas, dans les marais de Loire. Mais quelque insistance
qu'il y mît, l'obéissance du disciple s'y refusa. Frère Nicolas n'accepta que
de s'appuyer à son bras mais sans doute y pesa-t-il de tout son corps. Les gens
s'apitoyaient et s'exclamaient au passage de ces voyageurs, poussiéreux, hâves
et vacillants : « Cher Père, s'inquiétait Nicolas, que va dire tout ce monde ?
» Il s'agissait bien de cela ! « Mon fils, répliqua Montfort, que dira notre
bon Jésus qui nous voit ? »
Les Frères Gabriel,
Philippe et Louis, tous trois profès, ferment la liste des Frères, compagnons
de Montfort, dont les noms nous soient connus. D'autres personnages, dont on ne
sait au juste s'ils étaient des Frères, apparaissent, anonymes et furtifs, dans
les anciennes biographies. Parmi ces derniers, il n'est pas fait de certains
mention bien honorable. L'un d'eux résista ouvertement à son maître. Un autre
subtilisa quarante écus destinés aux pauvres et s'enfuit, nuitamment. Frère
Jean, s'étant mis à sa poursuite, le rattrapa et le conduisit à Montfort qui
l'admonesta avec tant de douceur que le délinquant, tout contrit, sollicita son
pardon avec larmes. Le missionnaire lui donna de quoi retourner chez lui où il
se conduisit désormais en digne chrétien. Un autre Frère commit un acte
analogue. Ayant vendu, au cours d'une mission, toute la bricole de la «
boutique », il empocha le produit de la vente, sauta sur le mulet et s'en fut.
Cette fois, ce fut l'hôtelier, logeur des missionnaires, et son valet qui, à
cheval, coururent après le fugitif, et lui mirent la main au collet. La même
scène, ensuite, se reproduisit : larmes, pardon, plus une tendre accolade du Père
au coupable repentant. Montfort recommanda que le plus complet silence fût
gardé sur cette affaire et, avant de partir, confia aux paroissiens qu'il
venait d'évangéliser cet égaré d'un instant.
L'équipe paya donc son
tribut à la faiblesse humaine. Ainsi, sur la vie de Jésus, flotte l'ombre
triste du reniement de Pierre et de la fuite des Apôtres au Jardin des Olives.
Sur les Frères fidèles, cette garde magnifique, on souhaiterait plus de
détails. Mais quoi! Tant d'obscurité convient à leur humble tâche de
coadjuteurs et leur grandeur n'est-elle pas de s'être en quelque sorte fondus
dans l'auréole du saint ? Au reste, les quelques traits qui les font surgir de
l'anonymat suffisent à recomposer une atmosphère de Fioretti et nous savons sur
eux l'essentiel, à savoir qu'ils ont partagé d'une âme magnanime la vie de leur
fondateur, la plus âpre qui puisse être, la plus donnée, la plus transportée
d'amour pour Marie et son Fils crucifié, la plus consumée de tendre charité
pour tous les pauvres de Dieu, au vrai une des plus surhumaines de
l'hagiographie de tous les temps. Je ne voudrais pas diminuer les mérites de M.
Olivier et de cet excellent M. Ernand des Bastières, ces deux prêtres qui,
missionnaires avec lui, le premier dans la région de Nantes, jusqu'à 1711, le
second dans la même région d'abord, puis dans les diocèses de La Rochelle et de
Luçon, jusqu'à la mort du Bienheureux. Il faudra même réhabiliter quelque jour
le premier, dont trop de biographes ont fait un complice des jansénistes, un
ennemi sournois de Montfort alors qu'il fut pour lui un parfait ami, un
indéfectible collaborateur qui veilla, après le départ de Nantes de Louis
Grignion, sur les œuvres nantaises du grand apôtre[12].
Quant au second, témoin incomparable (n'a-t-il pas participé à une quarantaine
de missions, sur les deux cents environ que donna Montfort ?), témoin quotidien
dont les souvenirs écrits ont projeté sur le grand missionnaire
d'irremplaçables lumières, il a été un auxiliaire très dévoué; assez à la
manière de Sancho Pança, il a suivi, quelque peu ahanant, gémissant et
essoufflé, ce Fou de la Croix en qui il reconnaissait et vénérait le saint,
mais qui heurtait son goût marqué pour une vie paisible. Il n'avait pas, pour
sa part, choisi de vivre dangereusement et, en telles circonstances mémorables
et savoureuses qu'il a rapportées, se refusa tout net à faire le héros. Ses tremblements
ou dérobades, il les confesse avec tant de franchise et d'ingénuité qu'il nous
reste très sympathique, et il est même fort admirable pour avoir, ennemi
déclaré des mauvais pas et contrariétés excessives, suivi Montfort jusqu'au
bout. Cependant, à la manière du chanoine Blain, il continuait de se complaire
dans les zones modérées et la mortification moyenne ; aussi gardait-il son
indépendance vis-à-vis de Montfort, se réservant parfois de quitter la mission
sans l'en avertir. Cela est vrai aussi de M. Olivier, qui d'ailleurs, n'œuvra
avec Montfort que deux ans environ, et aussi de MM. Vatel et Mulot,
collaborateurs de la dernière heure, puisque le premier ne rallia Montfort
qu'un an, le second six mois avant sa mort... En durée comme en profondeur, ce
sont les Frères Mathurin et Jean, Jacques et Nicolas, Philippe et Louis et
Gabriel, et d'autres, hélas ! inconnus, qui ont été les associés complets de
l'épopée missionnaire de Montfort. Ils en ont porté les échardes dans leur
chair, les tribulations dans leur âme. Ils en ont partagé les dangers, voire
mortels[13].
Qu'ils aient cuisiné ou tenu la boutique, ordonné les processions ou chanté des
cantiques, abattu des lieues et des lieues avec leur maître ou fait, dans son
esprit, le catéchisme ou l'école, ils ont été les volontaires du grand combat
spirituel, les pauvres, les mortifiés, les humbles, sur qui pleuvaient les
brocards ou propos salaces, ne tenant leur subsistance et gîte que de la
Providence, souvent boutés avec leur maître hors les presbytères et, certaines
nuits, dormant à la belle étoile, au pied de quelque Calvaire, la tête appuyée
sur la dernière marche de granit, tels enfin que les voulait Montfort, soulevés
par ses enthousiasmes et ses espérances, épousant ses déceptions et ses échecs,
apprenant de lui à les bénir, enseignés par lui tout au long des jours,
découvrant par lui, chaque jour davantage, le message de Jésus ; avec lui, ils
ont connu les ferveurs des foules que soulevait sa parole et, avec lui, pleuré
sur les ruines de Pontchâteau. Ce sont eux qui ont renseigné M. Ernand des
Bastières sur tant de faits, petits et grands, qui forment le plus précieux de
ses souvenirs. Compagnons en vérité entre tous les compagnons, dans la bonne et
la mauvaise fortune, dans la tempête et les éclaircis de ce pauvre monde, compagnons
dans le temps et pour l'éternité.
Les
Frères et l’Ecole.
C'est comme tels, et
parce que tels, qu'ils ont fait l'école, inséparable de l'action missionnaire
de Montfort, prolongement durable de la mission ; c'est dans le creuset
apostolique qu'a été fondue l'œuvre scolaire de Montfort, et qu'elle prend tout
son sens. Grandet[14],
énumérant les onze « inventions et moyens » dont se servait M. de Montfort pour
perpétuer les fruits de ses missions, met en tête « l'établissement des écoles
chrétiennes ». Il dit expressément : « La principale occupation de M. Grignion
était d'établir dans le cours de ses Missions des Ecoles chrétiennes pour les
garçons et pour les filles. » Ailleurs, il précise que les résultats de ses
missions « persévéraient bien plus longtemps dans les lieux où il avait passé
que dans ceux où d'autres missionnaires avaient travaillé, parce qu'il se
servait de pratiques très saintes pour y perpétuer les fruits de ses missions
par les petites écoles ». Clorivière ne dit pas autre chose : « Partout où il
faisait la mission, un de ses principaux soins était de pourvoir les paroisses
de bons maîtres et de bonnes maîtresses d'écoles. » Celles-ci seront les Filles
de la Sagesse ; quant aux écoles pour les garçons, Montfort les a confiées à
ceux de ses Frères qui avaient une instruction et des dispositions suffisantes.
On sait, par son propre testament, qu'il en était qui faisaient l'école à
Nantes, et Grandet, d'autre part, précise, quant à Frère Mathurin, qu'il avait
fait pendant près de quinze ans[15]
« le catéchisme et l'école ».
C'est que Montfort avait
toute une doctrine de l'école, dont les éléments principaux lui venaient de ses
années de Saint-Sulpice. Il avait longuement débattu la question, l'avait pesée
et retournée sous toutes ses faces. A la source, comme en toute démarche de son
esprit, il y avait un grand amour. Au dire de Clorivière : « Plein de l'esprit
de son divin Maître, il avait toujours aimé tendrement les petits enfants et,
soit à la ville, soit à la campagne, il se plaisait à se voir entouré d'une
troupe d'enfants à qui il apprenait les éléments de la doctrine chrétienne. »
Son expérience de l'ignorance et de l'immoralité de tant de milieux où il
passa, en voyageur, en missionnaire, lui soulignait l'urgence de l'action
scolaire. Théologien, qui constatait les ravages du protestantisme, il
considérait que l'établissement des Ecoles « tant des garçons que des filles
serait le remède le plus sûr et le plus efficace à ce grand mal », et,
moraliste, « qu'en donnant aux enfants pauvres de l'un et l'autre sexe une
éducation conforme à leur état, il bannirait, par degrés, de la populace
l'oisiveté, l'inculture religieuse et tous les vices qui en sont la suite ».
Missionnaire apostolique qui eût voulu dilater à l'extrême le Royaume de Dieu, il
disait que les « écoles étaient les pépinières de l'Eglise ; que c'était là que
les enfants, comme de tendres arbrisseaux, ayant été taillés et cultivés avec
soin, devenaient dans la suite propres à porter de bons fruits et que, faute de
cette première culture, ils demeureraient toujours stériles et infructueux. »
Reconnaissons ici la pensée maîtresse, sinon les expressions mêmes, de
Bourdoise : « Les petites écoles sont le séminaire des séminaires... L'école
est le noviciat du christianisme... »
Ayant ajusté son sentiment
sur celui des grands rénovateurs de l'enseignement populaire du XVIIe
siècle, Montfort, « nuée tonnante et volante », mais aussi bâtisseur,
constructeur, soucieux de durée, de permanence, a pensé à constituer un corps
d'instituteurs pour les petites écoles. Vouloir celles-ci sans vouloir ceux-là,
eût été un non-sens. C'est à quoi répond le nombre relativement important de
Frères autour de lui. La grande période missionnaire de Montfort s'ouvre à son
retour de Rome, en mai 1706 ; or, deux ans après, il a déjà autour de lui
quatre Frères connus : Mathurin, Jean, Pierre et Jacques, et d'autres encore,
très probablement. A sa mort, on en connaît sept dont quatre profès ; au hasard
de deux ou trois anecdotes, on en voit passer d'autres qui ne sont pas nommés.
Clorivière parle même d'un « grand nombre ». Or, Montfort, dans ses voyages
comme dans ses missions proprement dites, était accompagné, le plus souvent,
d'un seul Frère, parfois de deux, jamais davantage. Les autres étaient
nécessairement occupés à des postes sédentaires ou mi-sédentaires. Que, si
vite, Montfort se soit entouré de tant de collaborateurs, cela dit bien haut
son intention de constituer une pieuse Compagnie de Frères laïcs attachés aux
missions ou voués à divers offices stables, dont, en première ligne, l'école
charitable. Plus tard, nous le verrons, certains d'entre eux prononceront les
vœux de religion.
Ils n'étaient que quatre
profès à la mort de Montfort, mais tous, avec ou sans vœux, vivaient, depuis
qu'ils suivaient Montfort, la vie religieuse, pratiquant, cela va de soi,
l'obéissance, la pauvreté, et la chasteté, munis aussi, non d'une règle
religieuse proprement dite, mais d'un règlement de vie, d'un coutumier. On n'en
connaît pas le texte, mais l'existence — qui d'ailleurs tombe sous le sens — en
est certifiée par certains traits de la vie de Montfort. Il advint, par exemple,
au Frère Nicolas de s'attarder un soir à causer avec une fille de service,
aiguillonnée par la curiosité naturelle à son sexe et à sa condition, et qui
s'informa de certaines particularités de la vie du missionnaire, avec
l'intention sans doute de les colporter d'une langue agile. « La chambre où se
tenait la conversation, raconte Clorivière, était fort éloignée de celle du
bienheureux. Le lendemain, lorsque le Frère se présenta pour recevoir la sainte
communion, il se la vit refuser, et ayant demandé après la messe pour quelle
faute on lui infligeait une telle peine, il reçut cette réponse : « Vous avez
violé la règle qui vous marque d'être retiré à neuf heures et vous avez tenu
avec la domestique de la maison des propos indiscrets à mon sujet. » C'est
assez dire qu'étaient assurés, sinon par un texte écrit, du moins par une
tradition orale, l'ordre et la régularité indispensables à une équipe d'apôtres,
qui avaient rejeté la loi du monde pour vivre pleinement celle de Dieu. Il en
alla ainsi jusqu'au moment où la question des vœux se posa.
C'est donc d'une âme
profondément religieuse que les Frères pénétraient un enseignement, évidemment
limité au rudiment. Toutes les écoles charitables de ce temps, d'ailleurs,
visaient surtout, au delà du modeste programme scolaire — lecture, écriture,
calcul — à l'éducation chrétienne de l'enfant. Le catéchiste consommé qu'était
Frère Mathurin apportait à l'école le même esprit qu'au catéchisme... Mais ces
écoles, comment étaient-elles fondées, organisées, perpétuées ? On en est
réduit aux conjectures. Les faits mieux connus nous mettraient sans doute en
présence d'une improvisation constante et d'une grande variété de solutions. La
souplesse extrême de l'apostolat de Montfort a dû lui permettre la création
d'un nombre appréciable de petites écoles rurales dans les diocèses de Nantes,
La Rochelle et Luçon.
Les
écoles de La Rochelle.
Si nous n'avons aucun
détail sur ces écoles — dont le texte de Grandet, très formel, nous assure
l'existence — nous sommes assez abondamment renseignés sur celles de La
Rochelle. Là, M. de Montfort, ayant enfin un centre d'opérations important et
stable, où il pouvait séjourner assez longuement, dans les intervalles de ses
missions, disposant de l'ermitage de saint Eloi pour s'y livrer en paix à ses
réflexions et élaborer ses plans, ayant d'autre part dans la personne de Mgr de
Champflour un protecteur et un ami, il put faire œuvre durable et donner la
mesure de sa valeur pédagogique.
Dès son arrivée à La
Rochelle, il avait été frappé des méfaits du protestantisme et cherchait les
moyens d'y remédier. Au retour de ce séjour à Paris, où il conclut ferme
alliance avec le séminaire du Saint-Esprit pour le recrutement de sa Compagnie
de Marie, donc en octobre 1713, il entra à ce sujet en une méditation active et
serrée : « Un jour, dit Clorivière, réfléchissant plus attentivement aux grands
maux que l'hérésie, quoique cachée, faisait encore à La Rochelle, surtout par
le moyen de l'instruction, que quelques personnes infestées de l'erreur
prétendaient donner à la jeunesse, il lui vint à l'esprit que l'établissement
des écoles chrétiennes, tant des garçons que des filles, serait le remède le
plus sûr et le plus efficace à ce grand mal » Cette pensée, s'étant emparée de
lui, il ne songea qu'à la réaliser, comme chaque fois qu'était en cause le
Royaume de Dieu.
Le problème, encore et
toujours, était des maîtres et des maîtresses. Pour les filles, la solution
s'offrait d'elle-même en la personne de Marie-Louise Trichet et de ses
compagnes qu'il avait précisément hâté d'utiliser. Pour les garçons « il
songea, dit encore Clorivière, qu'il ne lui serait pas impossible de trouver
parmi le grand nombre de ceux qu'il avait dans sa conduite, des personnes
capables de les instruire et assez zélées pour entreprendre de le faire ». Le
projet ayant mûri dans son esprit, il le soumit, au début de 1714, à Mgr de
Champflour ; ce faisant, il allait au-devant d'une des plus chères
préoccupations de l'évêque et le savait. L'approbation fut entière. Les écoles
ne manquaient pas à La Rochelle, mais elles étaient payantes et dirigées par
des maîtres qui sentaient le fagot ou constituées en dehors du contrôle
ecclésiastique. L'accord se fit sur la fondation d'écoles charitables
proprement dites, donc gratuites, soumises au contrôle de l'évêque, et où
l'instruction serait donnée par des maîtres et maîtresses offrant, du point de
vue doctrinal, toute garantie.
Montfort se mit aussitôt
à l'œuvre. Il commence par le commencement qui, à ses yeux, est de l'esprit.
Lui, qui semble passer, comme une flamme rapide, sur tout ce qu'il aborde,
s'affirme en fait, nous l'avons vu, l'homme des fondements ; il veut
d'agrippantes racines spirituelles à ce qu'il entreprend. Les futurs maîtres
des écoles de garçons, il les désire d'âme fortement préparée à leur tâche,
comme le sont, pour les écoles de filles, Marie-Louise Trichet et ses
compagnes, par leur longue pratique d'une vie religieuse très mortifiée. Il les
considère d'ores et déjà comme des religieux ; il faut qu'ils le deviennent ou
y tendent parce que, pour lui, nulle main n'est jamais trop pure pour toucher à
un haut service du Seigneur ; il le faut parce que seule la vie religieuse peut
en faire des éducateurs capables de contrebalancer, dans l'âme des enfants, les
effets subtils d'une doctrine et d'une morale hérétiques. Montfort exigera
d'eux, sous peine d'exclusion, qu'ils ne demandent jamais quoi que ce soit,
directement ou indirectement, aux enfants ou aux parents, en fait d'argent ou
présents quelconques. Ils ne devront strictement avoir en vue que la gloire de
Dieu, le salut des âmes, leur propre perfection. Dans cette double
prescription, on reconnaît d'une part l'esprit et la lettre du vœu de pauvreté,
et d'autre part la fin assignée à la vie religieuse proprement dite.
Que son intention la
plus expresse ait été telle, il en est un autre témoignage dans la règle donnée
aux Filles de la Sagesse : « Les maîtresses d'école doivent être du nombre de
celles qui sont capables de ce divin emploi et qui ont fait profession dans
leur communauté. » On peut déduire sans crainte de ce qui est prescrit aux
sœurs à ce qui est prescrit aux Frères. Si un tel principe est jugé nécessaire,
il vaut pour ceux-ci comme pour celles-là ; cette vue de bon sens se trouve
fortifiée par le parallélisme constant qui s'observe à cette époque dans la
conduite du P. de Montfort à l'égard de» Filles de la Sagesse et des Frères.
Clorivière l'observe à propos des écoles de filles: « L'ordre qu'il y fit
observer fut à peu près le même que dans les petites écoles de garçons, autant
que la diversité du sexe le pouvait permettre. » De même voulait-il, selon
Grandet, que « les maîtres d'école fussent vêtus d'une soutanelle pour leur
faire porter plus de respect », et, du même coup, que les maîtresses le fussent
« d'une grande coiffe qui les prît depuis la tête jusqu'aux pieds. »
Montfort soumit donc les
Frères, dès le printemps de 1714, à un véritable noviciat qui durera jusqu’en
février 1715, noviciat spirituel, noviciat pédagogique. Au cours de l'été,
Montfort fit son voyage de Rouen, mais, revenu en octobre, il s'occupait
activement des futurs maîtres, cherchait des fonds. A la fin de 1714, la maison
d'un marchand drapier, Michel Clemençon, qu'habitait Montfort avant Saint-Eloi,
fut louée pour l'école des garçons. Son état nécessitait de grosses
réparations. Ce n'était pas pour effrayer le constructeur de calvaires. Il
s'improvisa entrepreneur, traça le plan des travaux, en détermina les modalités
d'exécution. Il avait fait venir sur le chantier un grand nombre d'ouvriers
lui-même leur donnait ses ordres et, tantôt ici, tantôt là, les stimulait si
bien que, au grand ahurissement des techniciens du bâtiment, l'école était en
état parfait, après huit à dix jours de travaux.
En janvier 1715, l'école
était ouverte aux enfants. « Montfort, dit Clorivière, le plus explicite des anciens
biographes sur cette période, y établit trois maîtres (Grandet dit : quatre), à
la tête desquels il mit un prêtre, qui devait veiller sur leur conduite, dire
la messe aux enfants à la fin de la classe et les confesser au moins tous les
mois. » Ces maîtres, qui étaient-ils ? Des Frères assurément, mais dont un
seul, du vivant de Montfort, a pu être identifié, avec les meilleures garanties
de vraisemblance, Louis Danto, désigné, dans le testament de Montfort, sous le
nom de Frère Louis de la Rochelle[16].
Montfort, dont les plans prenaient un tour de plus en plus précis, à mesure
qu'il sentait céder son organisme miné par l'épuisement et par le poison
calviniste, avait hâte d'en faire accéder les meilleurs aux grands vœux, sceau
de la vie religieuse. Après une mission qu'il donna à Saint-Amand, il les
appela à la Séguinière, dans l'habitation des demoiselles de Beauvau et leur
fit faire retraite pendant huit à dix jours, vers mai ou juin 1715. Les plus
sérieuses présomptions sont pour qu'il leur ait fait prononcer leurs vœux à
l'occasion de cette retraite, située entre l'Ascension et la Pentecôte. La grande
dévotion de Montfort pour le Saint-Esprit incline à croire que le jour de la
Pentecôte fut aussi celui de la profession. Celle-ci engagea à coup sûr un des
maîtres d'école de La Rochelle, le Frère Louis. Il est plus que probable qu'il
en fut ainsi de ses deux ou trois autres adjoints. Ainsi étaient-ils éducateurs
chrétiens de pied en cap, par la plénitude même de leur entrée dans le service
de Dieu.
Le soin que Montfort
porta personnellement aux écoles nous est attesté par Clorivière ; il se
chargea personnellement d'établir les conditions d'admission, l'horaire des
classes, le programme des exercices d'études et de piété, la liste des
récompenses et punitions. « Le prudent missionnaire, ajoute Clorivière, entra
dans les plus petits détails, comme si, toute sa vie, il eût été employé à
gouverner des enfants. Il voulut que la longueur de la classe surpassât un peu
la largeur, que la chaire du maître fût placée dans le fond, que, vis-à-vis, il
y eut un banc plus élevé que les autres, qu'il nomma le banc des séraphins : là
devaient être les enfants qui auraient fait leur première communion, ou qui
seraient plus avancés que les autres. De chaque côté, il devait y avoir quatre
autres bancs, à qui il donna le nom des autres chœurs angéliques, sur lesquels
les enfants seraient placés, chacun à gon rang selon son âge et sa capacité.
Les bancs étaient en amphithéâtre, afin que le maître pût voir d'un coup d'œil
toute la petite troupe et que rien ne se passât sans qu'il en eût
connaissance... Il (Montfort) venait tous les jours aux petites écoles, pour
styler les maîtres et les disciples à la méthode d'enseigner... Toute la ville
fut surprise du prompt changement qui se fit par ce moyen dans le peuple. Les
enfants, constamment occupés et retenus étaient devenus l'édification de ceux
dont ils étaient auparavant le fléau. »
On ne disait pas autre
chose, à Paris, des résultats obtenus par Jean-Baptiste de la Salle. Montfort
ne fut pas, toutefois, comme celui-ci, un précurseur, un initiateur en matière
scolaire. Mais il avait tiré le meilleur parti tant de ce qu'il avait vu et
entendu à Saint-Sulpice que de son expérience pédagogique à l'hôpital de
Poitiers. Il s'était remarquablement assimilé la méthode de Mgr de la Poype,
inspirée elle-même de Démia. Quand il est question de sa méthode d'enseigner,
c'est de celle-là qu'il s'agit. Grandet précise un point intéressant : « Tous
ceux d'un même banc avaient le même livre, et disaient la même leçon tous à la
fois, parce que le premier était obligé de reprendre le second et le second le
troisième, quand il manquait, etc... Par cette méthode, souvent un ma
î
tre avait cent cinquante élèves dont il n'était pas plus embarrassé que
s'il n'en avait eu qu'une douzaine. » Par là, il apparaît que Montfort mit en
action certaines pratiques de ce que l'on a appelé plus tard l'enseignement
mutuel, en quoi d'ailleurs il ne faisait qu'appliquer un point particulier de la
méthode de Mgr de la Poype. Il n'en serait pas moins, à mon sens, erroné de
voir dans Mgr de la Poype et dans le Père de Montfort des partisans et des
praticiens de l'enseignement mutuel proprement dit qui, importé d'Angleterre en
France, sous la Restauration, par un nommé Lancaster, connut, sous le nom de
méthode lancastérienne, la consécration officielle et un succès aussi éphémère
que tapageur. Elle consistait, comme on le sait, en ceci que la leçon était
donnée par le maître à des élèves-moniteurs qui, transformés ainsi en
sous-maîtres, la donnaient à leurs autres camarades.
Les inconvénients d'une
telle formule, tant pédagogiques — suppression de l'influence personnelle du
maître — que moraux — arbitraire de l'élève-moniteur — sautent aux yeux et font
comprendre pourquoi les Frères des écoles chrétiennes, fort sagement, n'en
voulurent jamais. La conception éducative de Montfort va à pousser au maximum
l'influence du maître chrétien, et c'est bien pourquoi il veut que ses Frères
enseignants reçoivent, par la profession, la plénitude de la vie religieuse. Il
se borne, comme son, maître en pédagogie, Mgr de la Poype, à utiliser, avec la
modération qui s'impose, l'âme de vérité que contient l'enseignement mutuel, à
savoir l'utilisation des meilleurs élèves, pour soulager le maître, et
l'émulation qui en résulte chez les autres. M. de la Salle lui-même a disposé
que, en cas de besoin, les élèves classés premiers feraient fonction de
répétiteurs.
Il est fort heureux que
le cas des écoles de La Rochelle éclaire si bien l'étendue et la nature de l'effort
pédagogique de Montfort, car, sur ses autres fondations, telles qu'elles fonctionnèrent
de son vivant, nous n'avons que de brèves références. Ainsi de Nantes ; le
testament est formel : des Frères montfortains faisaient l'école à Nantes. Mais
où ? On ne le sait pas avec certitude. Il y a cependant les plus fortes présomptions
pour que ce soit à l'hôpital du Sanitat. La prédilection de Montfort pour les
hôpitaux où si nombreux étaient ses chers pauvres, l'entraîna certainement dès
1700, où il entra dans la communauté Saint-Clément, à visiter longuement le
Sanitat qui comprenait une école. Dans cette école, comme on sait, enseignait
depuis 1696 Louis Danto qu'il y a tout lieu d'identifier, comme nou6 l'avons
vu, avec le Frère Louis du testament et qui, appelé à La Rochelle par Montfort,
aura été provisoirement remplacé à Nantes, de 1714 à 1716, par le Frère
Philippe.
Hors La Rochelle et
Nantes, il n'est que l'école de Saint-Laurent-sur-Sèvre que l'on puisse repérer
avec quelque sûreté, comme dirigée par un Frère montfortain, du vivant de
Montfort. Il y a de sérieux arguments, que rien, jusqu'ici ne contredit, pour
que ce Frère soit le Frère Mathurin lui-même[17].
Les
Frères enseignants et les projets de M. de Montfort.
Le testament de Montfort
qui est, encore un coup, la pièce maîtresse en cette affaire, contient un texte
du plus haut intérêt quant aux intentions du fondateur sur ses Frères
enseignants. Il y est dit : « Comme la maison de La Rochelle retournera à ses
héritiers naturels, il ne restera plus pour la communauté du Saint-Esprit que
la maison de Vouvant donnée par un contrat par Mme de la Brûlerie, dont M.
Mulot accomplira les conditions, et les deux boisselées de terre données par
Mme la lieutenante de Vouvant et une petite maison donnée par une bonne femme à
condition. S'il n'y a pas moyen d'y bâtir, on y entretiendra les Frères de la
communauté du Saint-Esprit pour faire les écoles charitables. » Sous la
sécheresse obligée des termes d'un acte officiel, il y a là un fait émouvant :
l'effort suprême de Montfort pour asseoir les deux fondations qui lui sont si
chères : la Compagnie de Marie et les Frères enseignants.
La maison de Mme de la
Brulerie, située dans la ville même de Vouvant, près de l'église, était en
effet destinée, selon l'acte même de donation, à abriter Montfort et les autres
prêtres missionnaires de la
Compagnie de Marie. Or
cette Compagnie, appelée de vœux si ardents depuis 1700, n'existait toujours
pas. Ces prêtres, qui devaient terrasser tous les ennemis de Dieu « comme
autant de nouveaux Davids, le bâton de la Croix et la fronde du saint rosaire
dans les mains », n'étaient pas encore venus. Ni M. Vatel, ni M. Mulot, ces
deux prêtres qui, sur le tard, avaient rejoint Montfort, n'avaient encore
accepté de constituer avec lui la Compagnie de Marie. Il était seul avec son
violent désir. Maie son imagination, appuyée sur l'espérance en Dieu,
l'emportait d'un vol puissant vers un avenir dont il ne voulait pas douter. Sa
signature, au bas de l'acte de donation de Vouvant, c'est une hypothèque qu'il
prend sur la volonté divine. Cependant il signe : « Louis-Marie de Montfort
Grignion, prestre missionnaire de la Compagnie du Saint-Esprit. » La Compagnie
du Saint-Esprit, qu'est-ce à dire ? Eprouvant que ses forces physiques
l'abandonnent, renonce-t-il à une compagnie autonome à laquelle il eût insufflé
l'esprit qu'il a reçu de Dieu, et s'agrège-t-il lui-même, en désespoir de
cause, à la société avec laquelle il a, en 1713, passé contrat d'alliance,
celle de son ami Poullard des Places ? Ne le pensons pas; très visiblement, il
a voulu donner force légale à une signature qui ne l'engage pas seul, mais
aussi les prêtres missionnaires qui viendront éventuellement avec lui. Ceux
qu'il entend fonder n'existant pas encore, il se sert, comme d'un truchement et
d'une couverture, de ceux qui existent et dont l'amitié indéfectible et clairvoyante
l'autorise de soi à agir de la sorte si même (car nous ne savons tout ce qui
s'est dit à Paris en 1713) ils n'en ont pas convenu ainsi avec lui, de manière
expresse.
Deux mois s'écoulent.
Montfort n'est plus qu'une âme, toujours impétueuse, qui fustige un corps
épuisé et l'oblige de marcher. De missionnaires décidés à le suivre en corps
organisé, toujours point. C'est alors, se trouvant en mission à Saint-Pompain,
que, pour forcer l'intervention décisive de la Mère auprès de son Fils, il
envoie, en croisade de prières, à Notre-Dame des Ardillers, près Saumur,
trente-trois pénitents blancs. De Saint-Pompain encore, il écrit, nous dit
Clorivière, « d'une manière très pressante à M. Caris, son digne ami à la
communauté du Saint-Esprit, pour le prier de lui envoyer quelques bons
ecclésiastiques, qui voulussent s'associer à ses travaux et venir prendre part
aux bénédictions que Dieu répandait sur eux en abondance. Un des motifs dont il
se servait pour l'engager à faire là-dessus toutes les diligences était que,
s'il venait à mourir avant que cela fût effectué, les donations faites à lui et
à ses successeurs demeureraient nulles et sans effet ». Mais l'épreuve suprême
devait être ménagée au grand amoureux des croix. La Compagnie de Marie ne se
constituera que sur son tombeau.
Quand M. Mulot la
réalisera enfin, dans l'esprit et selon les volontés de Montfort, il avait
renoncé, en qualité d'exécuteur testamentaire, au bénéfice de la donation La
Brûlerie. Mais l'autre donation ? Elle était destinée, nous dit le testament,
aux « Frères de la communauté du Saint-Esprit pour faire les écoles charitables
», expression qui ne signifie pas que les Frères devaient y faire l'école, mais
qui, d'usage courant à cette époque, constitue, dans son intégralité,
l'appellation même de la communauté, appellation rigoureusement parallèle à
celle qu'imposa Montfort à Marie-Louise Trichet et à ses compagnes, en avril
1715 : « Communauté de la Sagesse pour l'instruction des enfant» et le soin des
pauvres. » La petite maison en question ne pouvait d'ailleurs pas servir
d'école ; située en dehors des murs de la ville fortifiée de Vouvant, elle
n'appartenait pas à la même juridiction civile. Le lieutenant de Vouvant n'eût
pas admis que les petits garçons de la ville allassent à l'école sur un
territoire soustrait à sa juridiction. Cette remarque, apparemment accessoire,
est d'importance capitale pour fixer les intentions de Montfort sur ses Frère»
enseignants. De même que la maison de Mme de la Brûlerie devait être la
résidence principale des missionnaires, prêtres de la Compagnie de Marie, la
petite maison de la bonne femme Goudeau devait être celle des Frères
enseignants.
Ainsi ces derniers
sont-ile constitués comme tels en leur habitat ; ils le sont aussi en leur
personnalité religieuse propre, à la fois distincte de celle des missionnaires
et alliée à celle-ci par l'appellation « Communauté des Frères du Saint-Esprit
pour faire l'école charitable ». Il y avait aussi des Frères du Saint-Esprit,
prévus pour le service temporel des missionnaires, quand ceux-ci existeraient.
Ils auraient, cela va de soi, cohabité avec les missionnaires. Telle ressort du
texte l'économie de la pensée de Montfort, fondateur des Frères enseignants. La
règle qu'il a ébauchée en 1713 et terminée en 1715 pour les prêtres
missionnaires contient l'article suivant : « On reçoit, dans la Compagnie, des
Frères laïques pour avoir soin du temporel, mais qui soient détachés, vigoureux
et obéissante, prêts à faire tout ce qu'on leur ordonnera. » Faut-il entendre :
« tout ce qu'on leur ordonnera, y compris et notamment l'enseignement » et les
Frères enseignants sont-ils en conséquence englobés dans cet article ou bien
Montfort a-t-il voulu que les Frères enseignants formassent un institut à part
? En l'état actuel des documents, la chose est, à mon sens, impossible à
trancher. U est probable, d'ailleurs, que Montfort n'a pu fixer sa pensée sur
ce point. L'inexistence de la Compagnie de Marie le laissait dans une
indécision forcée. Et il ne faut jamais oublier sa vie heurtée, traversée,
bousculée, «a mort à un âge qui ouvre généralement l'époque des réalisations
définitives.
Ce qui est acquis, c'est
que Montfort a créé des Frères dont la fin intérieure — Clorivière dixit — est
« la gloire de Dieu, le salut des âmes et leur propre perfection », et dont la
fin extérieure est quadruple : soin du temporel dans les deux communautés
(Missionnaires et Frères enseignants) ; soin des malade» dans les hôpitaux
d'hommes et dans les paroisses ; aide matérielle et catéchistique apportée aux
missionnaires au cours des missions ; enfin instruction des enfants des villes
et des campagnes dans les écoles charitables ; ce qui est encore acquis, c'est
que, en raison du caractère éminent de leur fonction, de la vie religieuse très
entraînée qu'elle requiert, des aptitudes et de l'instruction qu'elle
nécessite, les Frères enseignants doivent être groupés en une communauté
spéciale dite « des Frères du Saint-Esprit pour faire les écoles charitables ».
Les mots « du Saint-Esprit » étant là parce que Montfort, pour les raisons
d'ordre pratique que nous avons dites, ne disposait d'aucun autre vocable pour exprimer
cette communauté d'origine spirituelle entre Frères et Pères et, des uns aux
autres, cette fraternité dans l'action apostolique à quoi tout indique qu'il
tenait profondément.
Il serait
invraisemblable que, dans ces conditions, Montfort n'eût pas donné une règle à
ses Frères enseignants. On ne l'a pas retrouvée, mais il est à présumer qu'elle
était le pendant, à l'usage des hommes, de la règle des Filles de la Sagesse ;
tout ce qui, dans celle-ci, a trait à la fonction scolaire concorde absolument
avec les règlements des écoles de garçons de La Rochelle. Et, de même que
Montfort a donné leur règle aux Filles de la Sagesse, au moment qu'il fondait à
La Rochelle leurs écoles pour les filles, il a dû rédiger celle des Frères
enseignants en 1714-1715, immédiatement avant l'ouverture des écoles de
garçons, qui coïncide à peu près avec la date présumée de la profession de
plusieurs d'entre eux. Ainsi, en cette mission de Saint-Pompain de mars 1716,
d'où il jetait au séminaire du Saint-Esprit son cri d'alarme, pouvait-il se
dire que, si les missionnaires lui manquaient encore, il n'en avait pas moins
constitué, défini et formé les deux humbles groupes qui, par des voies
différentes, deviendront deux des plus belles congrégations enseignantes de la
France chrétienne.
Mort de
M. de Montfort. Ses suprêmes volontés
Et maintenant, M. de
Montfort va mourir.
Il a accepté de donner,
au mois d'avril 1716, une mission à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Il ne l'achèvera
pas. Arrivé dans le bourg, exténué, il se montrera pareil à lui-même, accablant
de macérations redoublées un corps qui défaille. Il ne loge pas au presbytère,
mais comme il l'a expressément voulu, dans un réduit, le plus misérable et
obscur, d'une pauvre maison qui est aujourd'hui la porterie de la Maison-Mère
de la Sagesse.
La mission, à peine
ouverte, connaît ce grand ébranlement des âmes que Montfort excelle à
déchaîner. Au reste, l'imminence de la mort l'environne d'une surnaturelle
lumière. On dirait de l'irruption soudaine de l'éternité dans son être consumé.
Les gens, au sortir des exercices, vont se contant des choses prodigieuses. Ils
affirment qu'à la sacristie Montfort a été vu, causant avec une dame
resplendissante de rayons et qui n'était autre que la Vierge Marie. Sur ces
entrefaites, on apprend l'arrivée, dont personne n'était prévenu, de Mgr de
Champflour, l'évêque de La Rochelle : il faut en toute hâte sortir, de
l'arsenal des cantiques, des textes appropriés, organiser une procession qui
accueillera triomphalement l'évêque, décorer l'église à profusion des fleurs du
jeune printemps. Assisté de M. Mulot et du Frère Gabriel, Montfort se prodigue.
Or il ruisselle de sueur et le vent est aigre qui s'engouffre dans la trouée de
la Sèvre. Le missionnaire éprouve au côté une douleur lancinante comme d'une
lance qui le percerait à chaque mouvement. Il respire à peine. Une pleurésie
s'est déclarée. Cependant Montfort assiste à l'office pontifical. L'après-midi,
malgré tous les conseils, il veut prêcher, il prêche et son thème est le doux
amour de Jésus. L'assistance en pleurs éprouve que c'est un mourant qui lui
parle. Chacune de ses paroles a la résonance d'un suprême adieu.
27 avril 1716. M. Mulot,
le Frère Gabriel sont auprès du grabat où l'apôtre se meurt. Et celui-ci de
faire part à M. Mulot du désir où il est de faire son testament. Sur une page
arrachée incontinent à l'opuscule de Montfort : Pour bien mourir, M. Mulot se dispose à écrire ses dernières
volontés et Montfort dicte[18]
:
Je, soussigné, le plus grand des pécheurs, je veux que mon corps soit mis
dans le cimetière et mon cœur sous le marchepied de l’autel de la Sainte
Vierge. Je mets entre les mains de Mgr l’évêque de La Rochelle et de M. Mulot
mes petits meubles et livres de mission, afin qu'ils les conservent pour
l'usage de mes quatre Frères, unis avec moi dans l’obéissance et la pauvreté, à
savoir Frère Nicolas de Poitiers. Philippe de Nantes, Frère Louis de La
Rochelle, et Frère Gabriel qui est avec moi, tandis qu'ils persévéreront à
renouveler leurs vœux tous les ans, et pour l’usage aussi de ceux que la divine
Providence appellera à la même communauté du Saint-Esprit.
Je donne toutes mes figures du Calvaire, avec la Croix, à la maison des
sœurs des incurables de Nantes. Je n'ai point d'argent à moi, en particulier,
mais il y a cent trente-cinq livres qui appartiennent à Nicolas de Poitiers
pour payer la pension quand il aura fini son temps. M. Mulot donnera (de)
l'argent de la boutique, dix écus à Jacques, s'il veut s’en aller, dix autres à
Jean, s'il veut aussi s'en aller, et dix écus à Mathurin s'il s'en veut aller
et ne pas faire (les) vœux de pauvreté et d'obéissance. S'il y a quelque chose
de reste dans la boutique, M. Mulot en usera en bon père à l’usage des Frères
et à son propre usage.
Comme la maison de La Rochelle retournera à ses héritiers naturels, il ne
restera plus pour la communauté du Saint-Esprit que la maison de Vouvant,
donnée par un contrat par Mme de la Brûlerie, dont M. Mulot accomplira les
conditions, et les deux boisselées de terre données par Mme la lieutenante de
Vouvant et une petite maison donnée par une bonne femme à condition. S'il n'y a
pas moyen d'y bâtir, on y entretiendra les Frères de la communauté du Saint-Esprit
pour faire les écoles charitables.
Je donne trois de mes étendards à Notre-Dame de Toute Patience à la
Séguinière, et les quatre autres à Notre-Dame de la Victoire à la Garnache ; et
à chaque paroisse de l’Aunis, où le rosaire persévérera, une des bannières du
saint rosaire. Donner à M. Bouvy les six tomes de sermons de la Volpilière, et
à M. Clisson les quatre tomes des Catéchismes des peuples de la campagne.
S'il est dû quelque chose à l'imprimeur, on le donnera de la boutique. S'il
y a du reste, il faudra rendre à M. Vatel ce qui lui appartient, si Monseigneur
juge à propos.
Voilà mes dernières volontés que M. Mulot fera exécuter avec un entier
pouvoir que je lui donne de disposer comme bon lui semblera en faveur de la
communauté du Saint-Esprit, des chasubles, calice, et autres ornements d'église
et de mission.
Fait à la mission de Saint-Laurent-sur-Sèvre, ce 27 du mois d'avril mil
sept cent seize.
Tous les meubles qui sont à Nantes seront pour l'usage des Frères qui
tiennent l'école, tant qu'elle subsistera. — Louis-Marie de Montfort Grignion.
N.F. Rougeon, doyen de Saint-Laurent. — Triault, prestre vicaire[19].
Ce 27 avril, où Montfort
fait son testament, est le cinquième de sa maladie ; le lendemain, à jamais, il
s'en ira. Cette dernière journée est tout obsédée par la pensée de ces
missionnaires de Marie, tant désirés, jamais venue, toujours enveloppés dans le
grand silence de Dieu. Toute espérance qu'ils surgissent un jour semble abolie.
A qui Montfort lègue-t-il les « figures » de son Calvaire de Pontchâteau ? A la
maison des incurables; ses étendards et ses bannières ? A des paroisses
ferventes. Ces précieux instruments des missions, s'il ne les lègue pas à MM.
Vatel et Mulot, c'est que, pense-t-il assurément, ils n'en ont plus que faire.
Il ne leur laisse même pas ses quelques recueils de sermons, ses catéchismes.
Cependant, avec le Frère
Alexis, ils sont près de lui, ces prêtres, ces compagnons de mission, M. Mulot
surtout, en qui il a mis, pour l'avenir, le meilleur de sa confiance. Tout de
même, si, en ces heures dernières, où il le voit si près du tombeau, il se
ravisait et lui donnait l'assurance si longtemps attendue ? Ce que, bien
vivant, il n'a pu obtenir, mourant l'obtiendra-t-il ? Justement, M. Mulot lui
fournit l'occasion d'une suprême démarche. Il lui exprime en effet sa grande
peine de la perte que vont faire les missions, personne ne pouvant remplacer
Montfort ; alors celui-ci de prendre la main de son ami, de le supplier de
continuer ses travaux, de prendre sur lui son œuvre. Il semblerait qu'à une
adjuration aussi émouvante, M. Mulot ne puisse résister et que, penché sur le
visage émacié du grand apôtre, il va dire les mots tant attendus... Mais non ! Instrument
inconscient de la suprême épreuve que Dieu entend infliger à son serviteur, M.
Mulot allègue son état de santé précaire, ses faibles capacités ; il se récuse.
Alors Montfort : « Ayez confiance, mon fils, je prierai Dieu pour vous. »
Maintenant que tout est
dit, qu'il a fait pour ses fondations, tout ce que, humainement, il pouvait
faire, il appartient à ce bon peuple, à ces pauvres gens, pareils à tous ceux
qu'il a évangélisés en deux cents missions successives et qui se pressent à sa
porte, réclamant sa bénédiction. Sur sa demande, on les fait entrer par petits
paquets. Il se défend de les bénir, alléguant la grande misère de sa condition
de pécheur, mais M. Mulot l'en presse : « Bénissez-les, monsieur, avec votre
crucifix ; ce sera Jésus-Christ qui leur donnera sa bénédiction et non pas
vous. » Ainsi fait-il, puis il entonne un de ces cantiques par quoi une correspondance
active s'établissait aussitôt de son âme au cœur populaire :
Allons, mes chers amis,
Allons en Paradis ;
Quoi qu'on gagne en ces lieux,
Le Paradis vaut mieux.
Peu après — c'était au
soir du 28 avril, — il tomba dans une sorte d'assoupissement, dont il sortit
tout tremblant. Visiblement, les puissances des ténèbres lui livraient un
ultime assaut : « C'est en vain que tu m'attaques, dit-il à haute voix ; je
suis entre Jésus et Marie. Deo gratias et
Mariæ. Je suis au bout de ma carrière. C'en est fait, je ne pécherai plus.
» Ainsi mourut-il, sous le sourire de Marie, entre les mains conjointes de la
Foi, de l'Espérance et de la Charité.
La gloire du prédicateur
au verbe de feu, aux conversions innombrables, recouvrit, dès sa mort, à
Saint-Laurent, à La Rochelle, dans tous les pays d'Ouest, ses autres titres
missionnaires à la reconnaissance universelle. Il faudra le recul du temps, les
documents mieux connus, pour saluer et vénérer en lui, comme on peut faire aujourd'hui,
un des rénovateurs, dans le cadre des missions, de l'école primaire, de la même
lignée, de la même coulée que les Bourdoise, les Démia, les Roland, les Barré,
les Jean-Baptiste de la Salle, les de la Poype qui ont aligné, dans les XVIIe
et XVIIIe siècles, la réforme de l'enseignement populaire sur la
réforme du clergé. Il reste à mieux connaître sa postérité spirituelle, celle
qui, sur le plan de son œuvre scolaire, témoigne pour lui.
DEUXIÈME PARTIE
HISTOIRE DES FRÈRES DE L'INSTRUCTION CHRÉTIENNE
DU SAINT-ESPRIT
DITS AUJOURD'HUI DE SAINT-GABRIEL
I - DE LA MORT DU P. DE MONTFORT
A LA MORT DU P. DESHAYES (1716-1841)
La situation, à la mort
de Montfort, des trois familles religieuses, aujourd'hui magnifiquement
épanouies, dont il est le fondateur, est peut-être unique dans l'histoire des
congrégations — comme le sera, au moins pour deux d'entre elles, le processus
de leur développement. Cinq sœurs composent celle des Filles de la Sagesse.
Quant aux Frères, le testament, qui ne les nomme peut-être pas tous, en énumère
sept, dont quatre profès, et ils sont sans supérieur. La Compagnie des
missionnaires de Marie, elle, n'existe pas.
Après les obsèques du
grand missionnaire, que la ferveur populaire rend triomphales, que fait M. Mulot
? Il s'acquitte, d'ailleurs sans hâte, de sa tâche d'exécuteur testamentaire à
Nantes, puis s'en retourne auprès de son frère, le recteur de Saint-Pompain. «
Chers habitants de Saint-Pompain. Levez-vous donc de grand matin. Cherchez la
grâce... » Mais M. Mulot s'enfonce dans sa retraite, et c'est la grâce qui
l'ira chercher. Il ne faut point l'en accabler. C'est un prêtre profondément
pieux, mais de santé chétive, de caractère timide, démuni de dons et
d'expérience oratoires au point de n'avoir secondé Montfort que dans la
confession, jamais dans la prédication. On comprend que, de l'idéal montfortain
du missionnaire à ses possibilités personnelles, il ait vu un abîme infranchissable
; son humilité, d'ailleurs, qui était grande, le confirmait dans cette vue.
Avec M. Vatel, lui aussi fixé à Saint-Pompain, il se livre à la lecture pieuse
et à la prière, donnant de temps en temps un coup de main au curé de la
paroisse. On les pourvut l'un et l'autre d'un bénéfice auquel ils renoncèrent bientôt,
se rappelant sans doute la pauvreté de M. Grignion. Bref, deux excellents
ecclésiastiques, appliqués aux choses de Dieu, parlant sans doute, à la
veillée, des extraordinaires aventures du Père de Montfort, comme on remue
pensivement les cendres chaudes du foyer.
Cela dura deux ans ;
cela eût duré jusqu'à leur mort, si l'Esprit Saint ne s'en fût mêlé. Il passa,
comme il fait aux tournants mémorables de l'histoire de l'Eglise, provoqué par
l'intercession véhémente de Montfort. Le curé des Loges, à la fin du carême de
1718, pria MM. Mulot et Vatel de le venir seconder. Ils pensèrent qu'il était
question de confesser et se rendirent à l'appel. Or il s'agissait de prêcher.
Le curé le leur fit entendre seulement quand ils furent rendus. Ils levèrent
les bras au ciel et se défendirent d'un ministère auquel ils n'avaient aucune
accoutumance. Mais leur hôte insista tant qu'ils cédèrent. Avec des transes de
débutants, ils compulsèrent des livres d'instructions aux gens de la campagne,
résolus d'ailleurs à parler simplement, de la façon qu'ils aimaient Dieu, sans
tenter d'atteindre au talent. Et voilà ces messieurs en chaire. Un témoin de
marque, M. le chanoine de Hillerin, parlant de M. Mulot, assure qu'il ne mit de
pathétique ni dans le ton, ni dans les gestes ; que les thèmes traités par lui
n'offraient rien de frappant ; que tous traits d'éloquence étaient absents de
sa prédication, et même un certain ordre dans la composition. Cependant — et
nous touchons ici au miracle — : « l'effet que ses paroles faisaient sur son
auditoire était des plus prodigieux ; ce n'étaient pas de simples soupirs et
des larmes. Un éclat terrible, des cris et des sanglots, qui s'élevaient de
tous côtés, dans l'auditoire, témoignaient la douleur vive dont il était
pénétré et combien était forte l'impression que le missionnaire faisait
indifféremment sur tous ceux qui l'écoutaient ». Quand on sait à quel point les
gens du pays des Loges sont peu enclins à l'expansion, cela revêt tout son
sens.
M. Mulot comprend. C'est
l'esprit de Montfort qui, par son verbe médiocre, a tout fait. La grande objection
qu'il se posait étant tombée, il se rend, car c'est une âme d'une belle
droiture et qui veut la volonté de Dieu. Aussitôt les événements de se précipiter.
MM. Mulot et Vatel donnent dans la région des missions, toujours avec ce
surnaturel succès. Deux prêtres se joignent à eux, MM. Toutan et Aumon. Ils se
groupent en communauté et, appuyés par les évêques de La Rochelle et de Luçon,
font présenter au Souverain Pontife une demande d'approbation de leur société
oui est accordée. Le titre de cette société ? « Nouveaux missionnaires apostoliques
de la communauté du Saint-Esprit[20].
» Peu après, un autre ecclésiastique s'agrège à eux, M. Guillemat. Et
maintenant, les circonstances vont providentiellement souder les missionnaires
nouveau-nés aux deux autres familles religieuses de Montfort. Aux Filles de la
Sagesse d'abord. La marquise de Bouillé, qui vouait à la personne et aux œuvres
de Montfort une admiration enthousiaste, bienfaitrice intelligente et décidée
au surplus, avait acheté aux Filles de la Sagesse une maison, à vrai dire fort
humble, à Saint-Laurent-sur-Sèvre, afin qu'elles résidassent auprès du tombeau
de leur fondateur. Quittant Poitiers[21],
elles s'y étaient installées au mois de juin 1720. Or, à la fin d'août de cette
même année, M. Mulot se rendait à Saint-Laurent pour leur prêcher une retraite.
Ainsi se nouaient des liens spirituels sur lesquels l'évêque de La Rochelle ne
tarda pas à mettre le sceau de son autorité ; en effet, le 22 septembre, Mgr de
Champflour confiait à M. Mulot le soin de diriger les Filles de la Sagesse.
Pendant ce temps, que
devenaient les Frères ? On ne le sait que pour quatre d'entre eux. Le Frère
Mathurin, depuis ce carême de 1718 où la grande pensée de son maître avait
enfin pris corps, pérégrinait avec MM. Mulot et Vatel. Admirable fidélité qui
le rejetait sur les routes, dès que s'y allongeait l'ombre sainte de Montfort.
Le Frère Louis avait
repris, à la mort du Fondateur, la direction de l'école de Nantes que le Frère
Philippe avait quittée pour le remplacer à La Rochelle, comme il l'avait
lui-même, pendant deux ans, remplacé à Nantes. Un Frère Dominique, nouvelle
recrue sans doute[22],
faisait l'école à La Rochelle, aux côtés du Frère Philippe. Enfin le Frère
Jacques enseignait à Saint-Laurent, depuis 1717 ou 1718, succédant vraisemblablement
à Frère Mathurin... Les autres étaient, comme eux, restés à leur poste.
Du point de vue humain,
rien de plus précaire que leur situation. L'ensemble des Frères dispersés n'a
pas de supérieur direct ; depuis qu'il a réglé les affaires du testament, M.
Mulot ne s'est plus soucié d'eux et rien n'indique qu'il leur ait prêté quelque
attention depuis qu'il a résolu de constituer la société des missionnaires,
rêvée par Montfort. Et il faudra le hasard d'une retraite pour qu'il pense à
s'occuper des Filles de la Sagesse. Cependant, pas une défection parmi les
Frères. Heureusement, appuis, amitiés ne leur ont pas manqué. Et d'abord
l'évêque, qui est leur tuteur, désigné par Montfort, a une trop haute idée des
devoirs de sa charge, il fut trop grand ami de leur fondateur, pour n'avoir pas
veillé sur eux. A La Rochelle, l'abbé de Tello, directeur ecclésiastique des
Frères des écoles, était à ceux-ci un soutien. A Nantes, les amis et disciples
de Montfort étaient nombreux : Barin, Olivier, les demoiselles Dauvaise, pour
ne citer qu'eux, les réconfortaient certainement et les aidaient dans les
difficultés, remédiant ainsi de leur mieux à la carence de M. Mulot.
Mais voici, dans leur
histoire, un événement mémorable : en 1721, le marquis de Magnagne[23]
achetala maison d'un René Pabaut, au nom des Frères qui devaient faire la classe
aux petits garçons de la paroisse. Ainsi, comme il était juste, raisonnable et
salutaire, les premiers compagnons de Montfort devenaient les premiers gardiens
du tombeau. Quand, le 29 juin 1722, les missionnaires vinrent habiter à leur
tour la maison Pabaut, le Frère Jacques s'y trouvait pour les recevoir. Un des leurs,
une nouvelle recrue venue du séminaire de Saint-Esprit, M. Le Vallois [24]
était nommé confesseur de la petite communauté de la Sagesse. Cette fois, les
trois germes des familles religieuses montfortaines se trouvent rassemblés dans
le même sillon.
A une date que l'on a
les plus sérieuses raisons de fixer aux vacances de 1723, nouvel événement plus
sensationnel encore et
de portée plus
profonde. Sitôt installé à Saint-Laurent, M. Mulot se préoccupa des deux
questions majeures : élection du supérieur général des missionnaires, émission
des vœux. En l'été 1723, au terme d'une retraite de huit jours, les missionnaires
élirent à l'unanimité M. Mulot supérieur général. A cette même occasion, M.
Mulot avait convoqué tous les Frères dispersés, pour recevoir, conjointement
avec les vœux des missionnaires, leurs vœux, du moins ceux des Frères qui, déjà
profès, les renouvelleraient, ceux, peut-être aussi, de nouveaux Frères admis à
la profession. Chose admirable : pas un des anciens ne manqua à l'appel. Des
divers postes, où, isolés, ils maintenaient vivante une des grandes pensées de
leur fondateur, ils accoururent. Il y a vraiment, dans la conduite de cette
poignée de compagnons de l'épopée montfortaine, une ferveur, une continuité
émouvantes.
Après ce grand jour, les
Frères enseignants — les quatre profès du testament — rejoignirent leurs
postes. Les autres restèrent auprès des missionnaires. Ceux-ci, comme ceux-là,
avaient maintenant un même supérieur général qui était celui des missionnaires.
En gros, cela représentait bien la conception de Montfort, telle qu'on la peut
dégager de trop rares documents. Contrairement à la formule lasallienne[25],
Montfort semble bien avoir expressément voulu un prêtre à la tête de sa
communauté de Frères. A La Rochelle, où le soutien déclaré de l'évêque le
permettait, l'abbé le Tello était délégué par Mgr de Champflour à la direction
spirituelle des maîtres de La Rochelle. Et j'incline même à croire que Montfort
mourant a laissé les Frères sans supérieur, parce que le prêtre manquait à ses
côtés qui eût pu ou voulu s'en charger. Bien montfortaine
aussi, cette inclusion des Frères dans l'action missionnaire et
leur répartition dans les divers emplois qu'ils remplissaient du vivant du
fondateur : quelques Frères continuent à faire la classe, d'autres sont voués
aux travaux manuels dans les communautés des Pères et des Filles de la Sagesse,
d'autres accompagnent les Pères dans leurs missions, certains enfin soignent
les malades. Ils avaient, cela va de soi, une règle adaptée à leurs diverses
fonctions ; les Frères pour faire les écoles charitables observaient sans doute
les règlements particuliers qu'ils reçurent à La Rochelle, plus ou moins
adaptés aux circonstances nouvelles. Les Pères, eux, observaient la règle de
1713. Donc, au sommet, unité de gouvernement, et, au-dessous, deux communautés
distinctes et complémentaires, munies chacune de leur règle et alliées, en vue
d'un même but missionnaire, dans un même esprit et une même spiritualité qui
leur venaient de leur fondateur commun : Grignion de Montfort.
M. Mulot décéda en 1749,
en pleine mission, comme Montfort. Son gouvernement fut tout pénétré de piété,
de sagesse, d'humilité. D'un grand zèle apostolique aussi : durant ses
vingt-cinq ans de supériorité, il ne fut pas donné moins de deux cent vingt
missions et retraites. M. Audubon ne lui succéda que pendant cinq ans, brève
période couronnée cependant de quatre-vingts missions. Lui aussi mourut en
plein combat, Ainsi allaient-ils, dignes fils de l'Apôtre, jusqu'au jour où,
brusquement, leur zèle même les brisait. De 1755 à 1788, le P. Besnard gouverna
la Compagnie dont il fut une des personnalités les plus marquantes. Lucide et
diligent, administrateur excellent et doué du sens du gouvernement, il mit la
main à des réalisations fort heureuses, dans l'ordre tant spirituel que
temporel. Il compléta la règle, trop sommaire, de Montfort, à l'usage des
Filles de la Sagesse et ainsi se trouvèrent établies leurs constitutions
définitives qu'entérina le premier chapitre général en 1768. La règle pour les
Pères, présentée par le P. Mulot au Saint-Siège, n'ayant pas obtenu
l'approbation pontificale, le
P. Besnard en rédigea
une nouvelle[26].
Par ailleurs, il stabilisait la société des missionnaires par l'obtention des
lettres patentes qui lui donnaient la personnalité civile. Comme Missionnaires
et Frères, devenus plus nombreux, étouffaient dans la vieille « maison longue
», donnée par la marquise de Bouillé, et qui servait aussi d'école et d'hospice
pour les indigents, il fit construire, pour les Pères, dans l'enclos, une assez
vaste demeure. M. Mulot avait déjà fait construire en 1744 le bâtiment qui
longe la rue du couvent. Du même coup, il agrandissait de constructions neuves
la résidence des Filles de la Sagesse. Il multiplia les recherches sur la vie
du fondateur, recueillit à temps les souvenirs de la Mère Marie-Louise de
Jésus, et put ainsi composer une biographie de Montfort, restée manuscrite,
mais où quelques historiens, notamment Clorivière, ont pu puiser. Pendant ce
temps, cent vingt missions jetaient, leurs filets sur les âmes. Le successeur,
en 1788, du P. Besnard, le P. Micquignon, connut les premières coulées de lave
du volcan révolutionnaire. Des gardes nationaux de Cholet firent irruption dans
la maison des missionnaires et emmenèrent comme otages les PP. Dauche et
Duguet. Le P. Supiot, lui, ayant accédé au généralat en 1792, déboucha en
pleine tourmente.
Jusque-là, tassés dans
l'obscurité de leur humble et fécond labeur, les Frères ne nous apparaissent
que par fugitives éclaircies. Le bon Mathurin reste le Frère-type, le Frère
complet de cette époque ; depuis 1718 — il avait à peine alors passé la
trentaine — son expérience des missions continua de faire merveille ; comme
ordonnateur de processions, il n'avait pas son pareil et nul ne savait, comme
lui, d'un cantique chanté à pleine voix, secouer un village endormi. Tous les
témoignages assurent qu'il poussait à la perfection l'enseignement du
catéchisme ; c'est dire qu'on l'employa largement à catéchiser. Il remplissait
d'ailleurs officiellement la fonction de « clerc catéchiste ». Il était clerc,
en effet, clerc tonsuré, et c'est sous l'habit ecclésiastique qu'il écoula,
dans la communauté de Saint-Laurent, une vie de plus en plus sédentaire à
mesure que l'âge venait. Tandis que disparaissaient les contemporains de Montfort,
dépositaires de premier rang du souvenir, il faisait, avec l'âge, figure de
relique. Il mangeait à la table des missionnaires, entouré d'une vénération
croissante. On s'étonnerait qu'il eût vécu cinquante-cinq années de vie
religieuse sans prononcer de vœux, si on ne savait quels scrupules taraudaient
son âme délicate. Il en était encore tout bourrelé quand il mourut, à l'âge de
73 ans, le 22 juillet 1750, ayant été, aux côtés de Montfort, un héros qui
s'ignorait et peut-être, jusqu'à sa mort, un de ces saints qu'on oublie de
canoniser.
Le Frère Jacques, lui,
fit l'école à Saint-Laurent-sur-Sèvre de 1717 ou 1718 à 1723 ; il enseigna à
l'hôpital du Sanitat de Nantes, comme adjoint du Frère Louis, jusqu'à sa mort,
survenue le 11 août 1727. Il ne fit point de vœux. Ce dut être pour les mêmes
raisons que Frère Mathurin, car il était lui-même fort scrupuleux. Il paraît
avoir été un des plus ardents, entre tous les Frères, à féconder le souvenir du
fondateur, à assurer la transmission de son message. N'est-ce pas lui qui sauva
les plus précieux manuscrits de Montfort ? La communauté lui doit aussi une de
ses plus notables recrues : le Frère Joseau, premier Frère admis (en 1723) à la
profession après la mort du fondateur. Ce Frère Joseau était, de longue date,
un ami de Frère Jacques, qui le gagna à l'idéal montfortain. Sa formation
intérieure fut complétée par la Mère Marie-Louise de Jésus, qui lui fut, au
plein sens du mot, une Mère spirituelle. Comment l'admirable fille de Montfort
n'e
û
t-elle pas aimé cette âme candide et fraîche
comme une source, qui sut si bien défendre sa pureté contre les troubles de
l'adolescence et les perverses suggestions de mauvais amis, ce cœur si généreux
qui ne se satisfaisait que dans un don de soi-même intarissable ! Il avait
quelque bien, mais son argent, comme le travail de ses mains, il les prodiguait
à la communauté des Filles de la Sagesse, alors dans un dénuement extrême.
Quand les missionnaires s'établirent à Saint-Laurent, il pensa aussitôt les rallier,
mais voulut auparavant s'éclairer par une retraite qu'il fit chez les jésuites
de Nantes. Il y alla sans souliers, par pénitence. Il se blessa au pied au
point de ne pouvoir continuer sa marche. Il s'assit alors au bord d'une
fontaine, pria la Vierge, lava sa plaie, fit sur elle le signe de la croix avec
une statuette de Marie que, à l'instar de Montfort, il portait toujours sur
lui. Guéri sur l'heure et si bien que de la plaie il ne restait même pas une
cicatrice, il reprit son chemin, en bénissant la Mère des humains. Au cours de
sa retraite, son confesseur lui demanda quelle raison l'attirait vers ce
précaire établissement de Saint-Laurent, alors que tant d'ordres religieux bien
assis pouvaient solliciter son pieux désir : « C'est, répondit-il, parce que
ceux de Saint-Laurent sont bien pauvres et que je voudrais moi-même vivre en
pauvre, en rendant mes petits services à des pauvres qui travaillent à la
gloire de Dieu et au salut des âmes. — Allez, mon cher enfant, lui dit le Père,
car votre attrait est bien de Dieu. » Entré dans la communauté de
Saint-Laurent, il lui donna tous ses meubles et le restant, de sa fortune. Il
avait pour l'art des dispositions. Dorure, peinture, sculpture l'enchantaient,
et on avait souvent recours à lui pour la décoration des églises. Mais aux
travaux les plus humbles, il se donnait du même cœur et on le voyait souvent
jardiner. Comme Montfort, il fut tenté par l'apostolat en terres lointaines :
il rêva d'évangéliser les sauvages au Canada. Sous cette impulsion, il pensa à
la cléricature, commença même d'apprendre le latin avec un curé des environs,
qui l'en avait pressé. Mais il comprit vite que le regard de Jésus se poserait
plus amoureusement sur lui, s'il restait dans son humble condition, fleur des
champs au revers d'un talus.
Frère Joseau, on dirait
d'un modèle pour une fresque de l'Angelico. Avec cela, fort intelligent, et
sachant observer. Il rédigea des mémoires, hélas ! disparus, maie qui servirent
au P. Besnard et aux chroniques d'une Fille de la Sagesse, la sœur Florence. Sa
principale occupation, avec le soin des pauvres malades, fut de faire l'école.
Il y vaqua à Saint-Laurent-sur-Sèvre du départ de Frère Jacques, en 1723, à sa
mort en 1752. Après lui, ce furent des Frères qui, sans interruption, firent la
classe aux petits garçons de Saint-Laurent.
Frère Louis continua de
diriger l'école à Nantes jusqu'en 1730, où il mourut. Sept Frères, dont le
Frère Jacques, lui furent successivement adjoints de 1720 à
1736. Le dernier étant
mort dans la même année que Frère Louis, celui-ci n'eut pas de remplaçant. M.
Mulot, en effet, ne s'était pas soucié d'en nommer. Aussi, avec Frère Louis,
l'école du Sanitat de Nantes cessa-t-elle d'exister.
L'école de La Rochelle,
par contre, a subsisté, avec des Frères montfortains comme régents, jusqu'à la
Révolution selon toute vraisemblance. L'abbé de Tello continua d'en être le
supérieur ecclésiastique jusqu'en 1731. L'école comptait alors trois maîtres
dont deux furent envoyés par le P. Mulot en 1724. Mgr de Champflour subvenait à
tous les frais. A sa mort, en 1724, les embarras financiers commencèrent. Pour
en sortir, il fallut recourir à la municipalité qui, le 12 janvier 1728, adopta
les écoles chrétiennes et s'engagea à subvenir à tous leurs frais. Les
successeurs de l'abbé de Tello furent, de 1731 à 1754, l'abbé Jean du Camp
Labadie ; de 1754 à 1789, le Père Servais Balch de la Société du Saint-Esprit ;
enfin l'abbé Drapron, de 1789 au 24 août 1791, date à laquelle les écoles
chrétiennes furent officiellement supprimées[27].
Ainsi œuvraient missionnaires
et Frères, quand survint le raz de marée de la Révolution. Comment les eût-il
épargnés ? Fils de Montfort, ils symbolisaient dans les régions de l'Ouest
l'action conquérante de la foi. Par leurs missions multipliées, les Pères de
Saint-Laurent entretenaient dans les âmes cette fidélité à Dieu et à son
Eglise, cette vitalité religieuse qui, en un soulèvement glorieux dont
l'origine est religieuse, non politique, feront se dresser des rives de Loire à
celles de Sèvre Niortaise les pays de la Vendée militaire. Par là, ils étaient
désignés aux coups les plus durs. Le Père Supiot, supérieur général, en cette
époque tragique, s'affirma de même lignée que les prêtres insermentés qui
prodiguaient en tous lieux leur ministère au péril de leur vie. Deux missionnaires,
les PP. Dauche et Verger, au moment où ils allaient s'embarquer pour l'Espagne,
furent massacrés. Le plus lourd tribut à l'orgie révolutionnaire fut payé par
les Frères : six d'entre eux — les Frères Boucher, Jean, Olivier, Antoine,
Yvon, Joseph — périrent sous les coups des sans-culottes. Les quatre premiers
furent arrêtés à Saint-Laurent ; les Frères Boucher et Jean furent tués sur
place, le Frère Olivier fut empalé et le Frère Antoine fusillé à Cholet. On ne
sait dans quelles circonstances les Frères Yvon et Joseph subirent un sort
analogue. Par eux, tous les humbles Frères, que Montfort institua, étaient
entrés dans la gloire la plus haute qui soit réservée au nom chrétien, celle du
martyre.
La tourmente passée,
tandis que les Filles de la Sagesse regagnaient leurs maisons, abandonnées
pendant la Révolution, sept missionnaires survivants se retrouvaient à
Saint-Laurent. Des deux Frères qui échappèrent au massacre, seul le Frère
Hilaire revint. Deux nouvelles recrues, les Frères Jacques et Joseph, le
rejoignirent bientôt, puis le Frère Elie. Frère convers avant la Révolution
dans un couvent de Carmes, le Frère Elie, son couvent ayant été, comme tous les
autres, détruit ou vendu nationalement et les religieux dispersés, entre au
noviciat des Frères du Saint-Esprit en 1805. Les écoles ayant rouvert en 1806,
il fut désigné pour tenir l'école de garçons. En 1810, le P. Supiot mourait, et
le P. Duchesne prenait sa succession.
Le groupe, déjà si
anémique, des Pères et des Frères, allait s'effilocher de plus en plus entre
ses mains impuissantes. Jamais les deux communautés n'avaient été nombreuses :
aux meilleures périodes, les missionnaires ne furent guère plus de douze[28],
les Frères une dizaine. Sur la fin du généralat du P. Duchesne, les Frères n'étaient
plus que quatre, dont un Frère enseignant ; quant aux missionnaires, ils
étaient trois, sans vœux, et dont aucun, d'ailleurs, ne devait persévérer ; peu
après la mort du P. Duchesne, ils quittèrent la Société du Saint-Esprit. Il
s'agissait donc, en 1820, de deux communautés exsangues — celle des
missionnaires surtout — et qui semblaient vouées, à bref délai, à l'extinction
totale. Mais l'esprit de Montfort fécondait secrètement ces ruines. Plus que
les survivants vivait le tombeau. Pour sauver ces deux fondations, il fallait un
prêtre, qui fût un homme d'action, énergique, entreprenant, bon entraîneur et
doué du sens de l'organisation. Providentiellement, il existait et, dans une
inspiration suprême, le P. Duchesne mourant l'appela. C'était Gabriel Deshayes.
Breton du Morbihan,
Gabriel Deshayes était né, le 6 décembre 1767, d'une famille paysanne très chrétienne.
Entré jeune au séminaire, il était diacre en 1792. La Révolution ayant dispersé
les séminaristes et obligé l'évêque de Vannes à se réfugier dans l'île de
Jersey, c'est là que Gabriel put recevoir la prêtrise. Pendant treize ans, sous
des déguisements divers, il exerce un périlleux ministère où il risque chaque
jour la mort. Cette période le révèle de trempe héroïque : à la fois ingénieux
et audacieux, mettant au service d'un zèle apostolique admirable, un entrain et
un sang-froid dont rien n'a raison. Visiblement, il se plaît dans les
circonstances difficiles comme dans son élément naturel. Le calme revenu, il
est nommé vicaire en plusieurs paroisses dont Beignon, puis, à la suite d'un
carême prêché à la cathédrale de Vannes où il affirme ses dons d'orateur,
recteur de Saint-Gildas-d'Auray, pôle de la piété bretonne ; il y développe une
éblouissante activité créatrice qui suscite et fait joyeusement fermenter
œuvres sur œuvres dans la paroisse, puis la déborde largement. Il ouvre le
couvent de Sainte-Anne au petit séminaire du diocèse. Du couvent déserté des
Chartreux, il fait une institution capitale, celle des sourdes-muettes ; il
obtient de faire transporter à la chartreuse d'Auray les ossements des neuf
cents victimes de Quiberon, en attendant qu'un mausolée perpétuât leur souvenir
; préoccupé de la baisse de la foi dans la région, l'attribuant à juste titre à
l'insuffisance des écoles chrétiennes, il a fait appel aux fils de saint
Jean-Baptiste de la Salle ; pour les petites filles, il crée l'Institut des
sœurs de l'Instruction chrétienne de Saint-Gildas. Puis, comme son regard
dépasse toujours l'horizon immédiat, il s'aperçoit que, si Auray a son école de
garçons, les campagnes voisines en manquent. Il prie alors les Frères de son
école de former des jeunes gens aux fonctions d'instituteurs pour les campagnes
et c'est l'origine d'un institut nouveau de Frères enseignants qu'il dirige en
même temps que l'institut féminin. Or, dans le même esprit, par les mêmes
méthodes, Jean-Marie de Lamennais, frère du célèbre écrivain, avait fondé les
Frères de l'Instruction chrétienne de Ploërmel. Gabriel Deshayes et Jean-Marie
de Lamennais se rencontrèrent, décidèrent de joindre leurs efforts et, en 1819,
date importante, la fusion était un fait accompli. Les deux fondateurs
devinrent conjointement supérieurs de la société nouvelle qui progressa
rapidement.
On pouvait penser que M.
Deshayes allait s'en tenir à ces fondations dont chacune suffirait à dévorer
une vie d'homme. Mais non ! En septembre 1820, il reçoit la lettre du P.
Duchesne, supérieur général des communautés de Saint-Laurent, le pressant de le
venir voir. Ainsi fait-il et c'est pour s'entendre supplier de prendre en main
les communautés moribondes. Peu après, une même demande lui venait des Filles
de la Sagesse. Après hésitations, réflexion et consultation, il accepte et
quitte Auray pour Saint-Laurent[29].
Le P. Duchesne venait de mourir. Le 17 janvier 1821, à l'issue d'une retraite
de trois jours, il est élu supérieur général des Pères, des Frères et des
Sœurs.
Sa constitution
vigoureuse le maintient, à cinquante-quatre ans, en pleine force. Sa paroisse
était florissante ; ses deux fondations en progrès incessants ; Auray était
devenu la capitale de son apostolat multiforme ; un halo d'admiration et de
vénération l'entourait. Pourquoi abandonne-t-il tout cela pour diriger, en un
pays qui lui est étranger, trois familles religieuses en difficulté, dont deux
exsangues ? D'abord parce qu'il a confiance en Dieu, et que la volonté divine
est visiblement qu'il s'attache à sauver une œuvre auréolée par le nom de
Montfort. Ensuite, parce qu'il a, humblement mais inébranlablement, confiance
en ses propres dons. C'est un homme d'action, dans la plénitude du terme, à qui
créer, susciter, organiser et réorganiser sont aussi essentiels que la
respiration ; un homme d'action, au regard lucide, au jugement sûr et pondéré, à l'imagination
audacieuse, à la décision ferme, à la volonté tendue, qui ne vit que s'il remue
et ne se repose que dans le mouvement. L'action le met en état d'euphorie et,
comme il agit tout le temps, il est toujours gai. Il sait nuancer son
tempérament de chef d'une bonhomie et d'une finesse qui le font habile autant
que décidé. Il se manifeste fort autoritaire mais, sauf exception, à sa manière
ronde et cordiale qui fait tout passer. Avec cela, beaucoup d'entregent. De
telles qualités l'équipent fort bien et il le sait. S'il a quelque travers de
l'homme d'action, ce serait de dépérir, s'il ne fabriquait pas du nouveau. Son
zèle apostolique, qui est magnifique, renforce ce besoin de nature et quand il
est, de ceci et de cela, possédé à un certain degré, il emploie parfois, pour briser
l'obstacle, des méthodes qui en laissent les témoins pantois[30].
Homme d'action, encore
un coup, qui aime à se mesurer avec la difficulté, mais aussi cœur généreux qui
ne recule ni devant le sacrifice ni devant la peine, cœur pitoyable à la
misère, à la déchéance, à la pauvreté, et qui ne reculera, pour adoucir la
détresse humaine, devant aucune initiative bienfaisante. Pénétrant et sublimant
tout cela, une piété solide, une vertu robuste (il faut toujours avec lui
choisir les épithètes qui expriment la force). Nulle gloriole : il s'affirmait
jaloux de son autorité, mais non par orgueil ; c'était effet du primat, chez
lui, de l'action ; nul ne contestait son humilité. Un total abandon à la
Providence était le surnaturel secret de ses audaces. La vertu de pauvreté se
développa chez lui d'autant plus aisément qu'il n'aimait ni le confort, ni le
superflu qui font perdre du temps[31].
Indulgent parce qu'il connaît les hommes et les aime, sa charité a les bras
ouverts. Il n'a rien d'un mystique, il ne se consume pas en oraisons, mais il
suit très strictement les exercices de la communauté, dit la messe et récite le
bréviaire avec un soin parfait. L'être religieux était chez lui sans complexité
et ne s'est jamais exprimé en une spiritualité quelconque qui lui fût propre.
On ne sache pas qu'il ait particulièrement pratiqué les macérations corporelles.
Sa mortification à lui consistait à accepter d'un cœur serein les inconvénients
et déboires d'une action intensive au service de Dieu et des âmes. Son grand
mérite est sans doute d'avoir entièrement subordonné à ce service un véritable
génie de restaurateur et d'organisateur. Ce génie fut secondé par le succès
immédiat ; comme il était heureux dans ses entreprises, et réputé tel, ses
réussites faisaient boule de neige.
Tout de même, quand on
le voit devant ses deux communautés d'hommes de Saint-Laurent, réduites au
point que l'on sait, comment ne pas penser au fameux texte d'Ezéchiel : «
Prophétise, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit : voici le mandat du
Seigneur : Que l'esprit surgisse des quatre vents et souffle sur ces défunts et
ils revivront. » Mais, en fait, il y avait, malgré les apparences, dans ces
communautés saint-laurentaises, des éléments de reviviscence, des ressources,
des possibilités bien vivantes qui n'échappèrent certainement pas au regard
exercé du P. Deshayes. Les Filles de la Sagesse, favorisées par le régime
napoléonien, étaient devenues un important institut qui groupait 778
religieuses et de nombreuses maisons. Le supérieur général des Pères étant aussi
le leur, une organisation avisée devait pouvoir faire bénéficier la communauté
des missionnaires d'un tel rayonnement spirituel et d'assises temporelles aussi
appréciables. Quant aux missionnaires, si, au témoignage du Frère Augustin, il
en restait seulement trois, en qui le P. Deshayes dut percevoir aussitôt l'affaissement
de leur vocation montfortaine, la pensée sublime dent ils étaient issus
conservait toute sa force ; les murs étaient encore chauds d'une tradition
familiale fidèlement observée ; le souvenir des missions montfortaines était
bien susceptible de susciter des vocations nouvelles... Et les Frères ? Sur
quatre présents, trois étaient voués aux travaux domestiques, un seul était
enseignant. Des fondations scolaires de Montfort, il ne restait qu'une école,
celle de Saint-Laurent-sur-Sèvre, mais du Frère Mathurin, ou du Frère Jacques,
au Frère Elie qui la tenait en 1821, la filière, si elle apparaissait mince,
était continue. Elle témoignait, avec une humble obstination, de la survivance
des « Frères de la communauté du Saint-Esprit pour faire les écoles charitables
».
M. Deshayes se mit à
l'œuvre, avec la promptitude, la décision, la maîtrise d'un bon artisan. Il
visita, dans le centre et le midi, les établissements des Filles de la Sagesse,
procéda à de nombreux et vastes agrandissements de la Maison-Mère, mit en
vigueur le second noviciat, institué sous le P. Besnard, vaqua à l'organisation
du chapitre général, s'occupa activement de la formation spirituelle des
religieuses, toujours à sa manière, faite de bon sens et de mesure, de rondeur
et d'esprit pratique.
Quant aux missionnaires,
la tâche était plus rude ; il s'agissait d'abord de fournir des membres à une
compagnie qui n'en avait plus. Le P. Deshayes fut servi par sa notoriété. Une
recrue de qualité se présenta : M. Ponsard. Aussitôt il ouvrit à Saint-Laurent
une retraite ecclésiastique ; il y fit, au clergé accouru en nombre, une
proposition qui témoigne de son ingéniosité. Il promit des instituteurs pour
les paroisses de campagne, si les prêtres en retour lui envoyaient des sujets.
Heureuse idée : de jeunes paysans lui furent adressés de partout pour les
former, il constitua un collège ecclésiastique qui s'abrita dans la maison dite
Supiot, du nom du supérieur général qui
l'avait achetée. En attendant que ces jeunes gens pussent
faire des novices, puis des missionnaires, il se fût trouvé fort embarrassé, si
l'évêque de Luçon, Mgr Soyer, ne lui eût donné quatre prêtres de grand mérite.
Avec eux il reprit les missions, avec un succès où son prestige personnel, ses
dons d'orateur simple, limpide, convaincu, entraînant, eurent la plus grande
part. Alors, il entra au cœur de la question. Qu'est une congrégation sans vœux
? Il décida de les introduire dans une règle qu'il élabora en 1832 ; après deux
ans d'expérience, elle fut adoptée et signée par lui et neuf de ses confrères.
Par là, il rejoignait la saine tradition montfortaine. Cinq missionnaires
s'étaient abstenus. Le 5 février 1835, les vœux étaient prononcés par les
signataires.
En promettant des
instituteurs au clergé vendéen, le P. Deshayes voulait bien plus que s'associer
en retour des missionnaires. Il entendait ranimer une des fondations majeures
de Montfort, dont la présence unique, mais hautement significative, du Frère Elie
était l'affirmation persistante. Plus tard il dira qu'en s'occupant des Frères
enseignants, il ne faisait qu'entrer dans les vues du Père de Montfort et
développer son œuvre. S'il s'y est voué avec prédilection, c'est que nul plus
que lui n'était préparé à les comprendre. Fondateur d'un institut de sœurs
enseignantes, co-fondateur, avec Lamennais, des Frères de Ploërmel, il en
savait l'importance vitale. Dans son apostolat si divers, l'école avait toujours
tenu, et de loin, la première place.
Là encore, problème urgent
de recrutement, mais la solution était à portée de la main. M. Deshayes n'avait
pas à se livrer de paroisse en paroisse à un embauchage laborieux, mais
simplement à puiser dans le réservoir des Frères de Ploërmel. C'est bien pourquoi
il prenait, dès son arrivée, vis-à-vis des prêtres du diocèse, l'engagement
formel de leur fournir des maîtres. Il savait où les trouver et, à son
accoutumée, agit promptement. Dès le 17 mars 1821, débouchaient à Saint-Laurent
deux novices : le Frère Augustin et le
Frère Pierre-Marie. Au mois de mai, un Frère Pierre amenait avec lui cinq
postulants et deux novices. Ce Frère n'était détaché d'Auray que
provisoirement, pour des raisons particulières. Le P. Deshayes n'avait donc
fait appel qu'à des novices et postulants. Sage décision : ces jeunes gens qui
avaient à peine fait leurs premiers pas dans la vie religieuse, n'arrivaient
pas à ce point imprégnés de l'esprit d'une fondation différente qu'ils ne
pussent s'adapter aux traditions montfortaines. Ils en étaient à l'état de cire
molle où marquerait sans peine l'empreinte nouvelle. A propos de certains
exercices religieux qui se pratiquaient différemment dans l'une et l'autre
équipe, il y eut bien quelques tiraillements. Mais en faisant jouer des
concessions réciproques, le P. Deshayes établit un règlement uniforme qui satisfit
tout le monde.
Gouverner trois familles
religieuses, dont deux cohabitantes, se prêtant mutuel concours, poursuivant
même but spirituel et cependant distinctes, éviter toute exploitation de l'une
par l'autre et aussi toute friction dangereuse, assurer leur administration
temporelle et leur formation religieuse, veiller à leur recrutement, à leur
développement, n'est pas un jeu. Il y fallait un véritable génie organisateur ;
celui du P. Deshayes était nettement empirique ; il procédait par étapes selon
les indications quotidiennes de l'expérience, avec quelques vues directrices
générales, mais sans plan préconçu. Une fois la vie commune des Frères à peu
près équilibrée, il s'occupa de pousser l'instruction des mieux doués et, cela
fait, créa la distinction nécessaire : Frères de classe, Frères de travail.
Distinction qui séparait les fonctions mais sauvegardait l'unité de la vie
religieuse, la communauté de la règle et des exercices. Au reste, elle n'avait
rien d'absolu et nombre de Frères passaient d'une catégorie à l'autre si, à
l'usage, il apparaissait que leurs aptitudes mieux reconnues, leurs goûts mieux
éprouvés demandaient ce changement.
Par ailleurs, les
novices affluant — ils étaient déjà quarante à la fin de 1822 — le P. Deshayes
put bientôt en envoyer dans les paroisses, pour y fonder et diriger l'école.
Ils y devaient vivre, comme dans la communauté de Saint-Laurent, en véritables
religieux[32].
Les règlements particuliers, adaptés à leur vie nouvelle, n'étaient que le
complément obligé des règles générales qu'il rédigea, l'une en 1823, l'autre en
1830. La première était fort embryonnaire[33].
Elle ne parlait ni du mode de gouvernement, ni des vœux, ces deux chapitres
majeurs de toute règle religieuse. A ce moment, où nulle opposition intérieure
ne se manifestait là-dessus, il allait de soi que les trois familles
montfortaines dussent avoir le même supérieur et que celui-ci fût un
missionnaire du Saint-Esprit. Quant aux vœux, ils continuaient dans la pratique
d'être prononcés. Dès 1824, quarante-deux Frères furent admis à la profession.
Pour des raisons que je dirai, la règle de 1830 fut plus explicite. Elle imposa
les trois vœux et détermina que le supérieur des missionnaires du Saint-Esprit
serait toujours supérieur des Frères[34].
Remarquons la stricte
fidélité du P. Deshayes aux principes essentiels de Montfort, touchant les
Frères en général, et particulièrement les Frères enseignants. On sait combien
Montfort tenait à ce qu'un Frère n'abordât l'école que fortifié de la plénitude
de la vie religieuse, donc de la profession. A sa suite, tout Frère étant
susceptible d'être enseignant, le P. Deshayes imposa les trois vœux à tous les
Frères. L'importance capitale donnée par Montfort à l'œuvre scolaire, le P.
Deshayes la souligne, par l'appellation qu'il adopte : Frères de l'Instruction
chrétienne du Saint-Esprit, ce qui est l'exacte traduction, en vocabulaire
moderne, des Frères de la communauté du Saint-Esprit pour faire les écoles
charitables. Enfin l'article I des statuts de 1830 est ainsi libellé : « Les
Frères de l'Instruction chrétienne enseignent la lecture, l'écriture, le
catéchisme, les premiers éléments de la grammaire française. Ils se chargent
aussi de l'instruction des sourds-muets[35].
Ils pourront être employés à des travaux manuels, au soin des malades et au
service de MM. les missionnaires, tant dans les maisons que dans les missions.
» N'était-ce point perpétuer la diversité des emplois assignés aux Frères de
l'époque héroïque : missions, assistance aux malades et infirmes, offices
domestiques, enseignement catéchistique et scolaire ? N'était-ce point vouloir
les Frères tels que les voulait Montfort « prêts à faire tout ce qu'on leur
ordonnera » ? En désignant comme supérieur général tant des Frères que des
Sœurs, le supérieur général des missionnaires,
le P. Deshayes
cimentait fortement l'unité des trois familles montfortaines. Il faisait
également écho à la pensée profonde du fondateur qui voulait à ses Frères un
supérieur prêtre et eût assurément pris son successeur dans la compagnie de
Marie, si elle eût existé de son vivant. En définitive, le P. Deshayes a suivi
très exactement les principes et la pratique de Montfort à l'égard des Frères.
Sauf adaptations de détail inévitables, et d'ailleurs rares, aux circonstances,
aux temps nouveaux, le P. Deshayes n'a rien innové quant au fond. Il s'en est
tenu inébranlablement à sa ligne de conduite : entrer dans les vues du P. de
Montfort.
Jusqu'en 1828, il avait
gardé l'entière direction du noviciat, se bornant à y préposer un directeur des
études qui fut d'abord le Frère Pierre, arrivé avec lui d'Auray, puis un Frère
René. Intenable formule ! Le P. Deshayes devait une bonne part de ses succès à
son entregent, mais pour mettre en action cette qualité qu'il portait au génie,
pour multiplier les protections ou relations utiles, susciter des bienfaiteurs,
obtenir toutes approbations civiles ou ecclésiastiques, apaiser les orages
officiels, il multipliait des voyages que l'emploi fréquent de la vieille
guimbarde de la communauté n'abrégeait pas. Le noviciat souffrait de son
absence, dans sa formation tant pédagogique que morale. Au retour d'un voyage à
Rome, en 1825, le P. Deshayes perçut dans la communauté un malaise profond. Une
réforme s'imposait, d'autant plus que le nombre de novices s'accroissait sans
cesse. Il était de quarante cette année-là, et avait déjà fourni vingt-neuf
Frères à dix-neuf établissements. Le P. Deshayes décida de nommer un Frère
directeur du noviciat, avec charge de le suppléer pendant son absence et de
visiter les établissements. Il désigna aussi un Frère maître des novices. Celui-ci
fut le Frère Siméon, celui-là le Frère Augustin.
Ce dernier nom fait
surgir, dans l'histoire des Frères montfortains, une de ses plus curieuses et
déconcertantes figures. La nomination du Frère Augustin à la direction du
noviciat fait entrer cette histoire dans une période nouvelle, en attendant de
lui donner uns orientation bien imprévue. C'est que le Frère Augustin n'était
pas le premier venu. Ce rural breton, de la plus profonde Bretagne, entré comme
postulant chez les Frères de Ploërmel, à la Chartreuse d'Auray, le 1er
janvier 1820, parlait fort mal le français. A première vue, il ne semblait
capable que de jardiner, à quoi d'ailleurs il excellait. Mais, quoique d'esprit
court, il était intelligent, d'une intelligence paysanne, tenace, sournoise et
butée, avec, dans la poursuite de ses desseins, un singulier mélange
d'ingénuité et de ruse. Et surtout, sa personnalité était forte et dominatrice.
Il avait du caractère, et même du plus mauvais. Par là-dessus, une ambition
qui, soit par éclats, soit par manœuvres, selon son humeur ou l'opportunité,
allait, d'étape en étape, se frayer un chemin. Sans doute n'en avait-il pas
conscience, identifiant, du plus naturel mouvement, la primauté de sa personne
et le plus grand bien de la communauté. Trois convictions maîtresses le
possédaient : la Bretagne est le seul pays qui compte, le P. Deshayes, Breton,
le seul supérieur qui vaille, et le Breton-bretonnant Augustin, son seul
auxiliaire, voire suppléant, possible. De quoi rien ne l'eût fait démordre,
j'en prends à témoin son portrait où les dures inflexions de l'arcade
sourcilière, la sévérité du regard, le pli des lèvres fermées, la tête carrée
disent à l'envi que tout argument là contre est inutile. Avec cela, religieux
d'une extrême ponctualité dans l'accomplissement de la règle, aussi austère
pour lui que pour les autres. Homme de grande volonté, il sut l'appliquer à se
mortifier, à se mettre à la hauteur de ses devoirs ; lui qui semblait voué à
rester un illettré, il réussit à faire un bon instructeur. Par ailleurs, nombre
de Frères ont témoigné de la bonté que dissimulait un abord fort rocailleux.
Enfin le Frère Augustin était un excellent administrateur et un travailleur
acharné. Quand un homme unit de telles qualités à une personnalité aussi forte
qu'ombrageuse et à un caractère difficile, il devient inévitable, et c'est tout
le secret de l'histoire qui va suivre.
Avec lui, le noviciat
avait un chef jeune — vingt-huit ans — vertueux et ferme ; avec le Frère
Siméon, qui n'avait que dix-neuf ans[36],
un maître des novices d'une piété profonde et rayonnante, bien fait pour sa
tâche de formateur. Mais une question se posa bientôt, qui changea l'atmosphère.
Le développement du noviciat nécessitait son isolement. Vers 1830, une
combinaison fut élaborée qui tendait à bâtir un établissement pour le noviciat,
dans l'enclos même du Saint-Esprit. Or, selon le Frère Augustin, il fallait
quitter à tout prix le domaine des missionnaires. Il mit à défendre son point
de vue une âpreté, une véhémence et une amertume dont, témoignent ses propres
Mémoires. Il se répandit en plaintes autour de lui, suscitant ainsi trouble et
division. Il harcela le P. Deshayes par écrit s'il était absent, par
interminables, adjurations s'il était présent, au point que le supérieur
général en eut les nerfs excédés. Le P. Deshayes ne cédant point, le Frère
Augustin versa dans un état hypocondriaque où les « peines et dégoûts » de ce
Breton déraciné et inconsolable tournèrent au vinaigre. Toute contrariété lui
était désagréable. Celle-là le brisait.
Ce n'était point là,
malgré les apparences, simple incident de la vie de communauté. Le P. Deshayes
lui-même discernait la grave nature de cette affaire, en avertissant le Frère
Augustin « qu'il y avait au fond beaucoup de présomption de vouloir ainsi se
séparer de l'autorité ». Là était bien le fond du débat. Le Frère Augustin,
dont l'élévation au poste de directeur du noviciat et de visiteur renforçait le
goût du commandement, en était arrivé à vouloir exercer une direction de moins
en moins partagée. Par ailleurs, d'esprit et de cœur, il était resté en
Bretagne et, en toutes choses de la vie religieuse, se référait, comme au
modèle parfait, à l'exemple d'Auray, au point d'en agacer son entourage. Sa
conviction était même que tout le développement du noviciat venait du seul
noyau de Frères et novices, postulants transplantés, en 1821, d'Auray è
Saint-Laurent, en sorte que les Frères de l'Instruction chrétienne du
Saint-Esprit n'étaient à ses yeux qu'une filiale de l'institut de Ploërmel, et
le P. Deshayes leur unique fondateur et Père. Tout ce qui était de Montfort lui
était indifférent et étranger. Cette hallucination armoricaine, passant de
l'état de rêve délicieux à celui de cauchemar torturant, suivant que les
circonstance la servaient ou la desservaient, allait lui faire préméditer une
séparation radicale.
Or, sous sa pression
acharnée et continue, le P. Deshayes en vint peu à peu à fléchir. Comment en
put-il être ainsi de ce chef-né qui avait accoutumé d'écarter vivement tout
obstacle à ses desseins ? Il lui eût été aisé de rendre le Frère Augustin à son
cher Ploërmel et à ses genêts bretons. Seulement, le Frère avait tout, à ses yeux,
de ces vieux serviteurs bougons, insupportables, mais fidèles que l'on voudrait
vingt fois par jour mettre à la porte, que l'on garde toute leur vie et que
l'on pleure quand ils sont morts. Il était pour lui l'image du dévouement
aveugle, le rappel constant de ses origines spirituelles, la voix du pays
natal. Le Frère Augustin ne cessait, par ailleurs, de protester que « en quelque
lieu qu'il plaçât la congrégation, il ne voudrait jamais d'autre supérieur que
le P. Deshayes » et cette affirmation, que renforçaient des flatteries plus ou
moins conscientes, satisfaisait fort non le religieux qui était humble, mais
l'homme de gouvernement. Le Frère Augustin fit tant et si bien qu'en 1834, le
P. Deshayes installa les Frères, novices et profès, en la maison Supiot, toute
proche de celle des missionnaires.
Ce bâtiment avait été
successivement, de 1825 à 1829, l’alumnat créé par le P. Deshayes et, de 1831 à
1832, un hôpital militaire. De nouveau disponible, il fut cédé, pour un prix
modique, par ses propriétaires, les Filles de la Sagesse, aux Frères. Elles le
firent de grand cœur, car une fraternité spirituelle, touchante de générosité
et de délicatesse, unissait les Filles de la Sagesse aux Frères du
Saint-Esprit. Cela encore était de tradition montfortaine. Depuis la mort du
fondateur, les Sœurs rivalisaient de charité ingénieuse, d'attentions, allant,
dans les temps de pauvreté, jusqu'à se gêner à l'extrême et se priver pour
remédier à l'excessif inconfort dont pâtissaient les Frères, dans la « maison,
longue » des débuts. L'Institut de la Sagesse s'étant remarquablement
développé, leurs dons furent à la mesure de leur prospérité grandissante[37].
Dans le cas présent, elles voulurent fournir la maison Supiot du mobilier, de
la lingerie, de la batterie de cuisine et accessoires de ménage indispensables.
Les Frères avaient été
laissé libres de choisir entre la maison-mère et la maison Supiot. A peu près
tous les Frères de classe s'en furent, à la suite des Frères Augustin et
Siméon, habiter la maison Supiot. Plusieurs Frères de travail en firent autant.
Les uns et les autres étaient au nombre de trente-trois. Par la suite, le P.
Deshayes envoya d'autres Frères de travail. Des résidents du Saint-Esprit aux nouveaux hôtes de la maison Supiot, des Filles de la Sagesse
aux Frères, de ceux-ci aux Pères, le lien restait aussi solide que devant ;
l'unité des trois familles montfortaines demeurait entière. Le va-et-vient
était continu d'une maison à l'autre. Les missionnaires disaient la messe à la
maison Supiot, y confessaient les Frères. La communauté de la Sagesse
continuait de fournir son plus actif concours au groupe essaimé, par des dons
en nature ou en argent, et de cent manières encore. D'une maison à l'autre, les
Frères se déplaçaient parfois, selon les besoins. Entrées et décès étaient
portés sur un même registre à la maison-mère, sans que le moindre signe
différenciât les inscrits. Un cimetière commun rassemblait tous les
Montfortains. Rien en somme ne séparait les deux groupes que la largeur d'une
rue.
La plus stricte pauvreté
régnait dans la nouvelle demeure. Elle était portée par tous avec bonne humeur.
L'austérité du Frère Augustin s'en accommodait fort bien. Au surplus,
n'était-il pas comblé? Le P. Deshayes l'avait chargé, ainsi que le Frère
Siméon, de la plus grande part de la correspondance et même des relations avec
les ministères et autres autorités officielles. Le tout sous son contrôle et il
n'y voyait que mesure d'ordre pratique. Le Frère Augustin, lui, considérait
cela comme un pas de plus vers la maîtrise totale. Il ne négligeait aucun acte
qui pût donner à sa communauté l'apparence de l'autonomie. Ainsi souhaitait-il
à la maison même un nom qui la distinguât davantage encore de celle du Saint-Esprit.
Un jour qu'il en parlait en réunion, un missionnaire suggéra que lui fût donné
le prénom du Père Deshayes : Gabriel. Pressenti, le Père évita de répondre,
mais, un jour, se levant de table, il dit en souriant : « Allons à
Saint-Gabriel. » L'habitude se prit vite de désigner les habitants du nom de
leur maison ; ils furent désormais appelés les Frères de Saint-Gabriel. Nul n'y
vit d'importance, mais, en son for intérieur, le Frère Augustin marqua un
point.
Malgré l'âge, et les
travaux dont furent surchargées ses années, le P. Deshayes restait droit et
robuste. Cependant, en juillet 1841 — il avait soixante-quatorze ans — une
première attaque de congestion cérébrale secoua rudement le vieux chêne. Ainsi
averti de la mort imminente, il s'y prépara avec une parfaite dignité. Il avait
voulu, sitôt hors de danger immédiat, reprendre ses occupations, mais une vive
douleur l'avait immobilisé aussitôt. Alors il se recueillit en Dieu, empli
d'une confiance et d'une joie inaltérables. L'été et l'automne passèrent ainsi.
Son épuisement allait croissant. Il ne quittait presque plus sa couche. Le 5
décembre, il faisait appeler le Frère Siméon et dictait son testament. Le 29,
il expirait. Ses dernières paroles avaient dit son magnifique abandon à Dieu et
son désintéressement. « Quelle est maintenant, lui demandait-on, la principale
pensée qui vous occupe ? — La volonté de Dieu. — Quelle est celle qui vous
console le plus ? — La volonté de Dieu. » Et puis : « Mes Frères, dans ce que
j'ai fait, je ne me suis proposé que la plus grande gloire de Dieu. »
Depuis 1821, donc
pendant vingt ans, il avait tout donné de son âme généreuse et de sa
prodigieuse activité aux fondations du P. de Montfort. Une de ses plus chères
pensées fut la béatification du grand apôtre des pays d'Ouest. Il avait fait un
voyage à Rome pour y travailler. Le tribunal diocésain, chargé d'instruire le
procès de béatification, siégeait à Saint-Laurent dans la maison même de la
communauté. Il voulut encore que, de son vivant, parût une vie autorisée et
approuvée par lui, du P. de Montfort, suivie d'une histoire abrégée de la
congrégation du Saint-Esprit[38]
et de la congrégation de la Sagesse. Dans son testament, s'adressant à ses
familles religieuses, il dit : « Je recommande à tous, d'une manière
particulière, l'affaire de la béatification de notre saint fondateur et, si je
n'ai pas la consolation d'assister à la belle fête qu'on célébrera sur terre à
cette occasion, je le prie de demander pour moi la grâce de la célébrer avec
lui dans le ciel. » Ainsi entendait-il disparaître dans la gloire du fondateur
et du père des trois congrégations que, restaurateur génial, il avait
développées ou ranimées, sinon sauvées.
Voilà qui rend le P.
Deshayes profondément sympathique. La caractéristique d'un fondateur d'ordre
religieux, ce qui le situe comme tel, c'est d'infuser à son ordre une
spiritualité — ascèse et mystique — qui, dans le cadre de la doctrine
catholique, porte sa note propre. De spiritualité particulière, le P. Deshayes
n'en avait pas et il ne cherchait pas à en avoir. Organisateur de premier
ordre, animateur prestigieux, grand homme d'action et qui avait mis ces hautes
qualités au service exclusif de Dieu, il n'a jamais voulu excéder ses
capacités. Il a sagement laissé les trois familles religieuses de Montfort se
nourrir des thèmes de la sublime spiritualité montfortaine : l'Esprit Saint, la
Sagesse du Verbe incarné, l'esclavage de Jésus par Marie. Dans cette attitude,
il y a beaucoup de grandeur. Rappelons-le : il avait trouvé à son arrivée à
Saint-Laurent trois Pères, quatre Frères, et une seule école. Quand il mourut,
la Compagnie de Marie comp tait dix-huit membres; les Frères étaient au nombre
de 135[39].
Des résultats aussi saisissants auraient pu l'entraîner à s'attribuer un titre
auquel il n'avait pas droit, les siens d'ailleurs suffisant à sa gloire et à
l'universelle vénération. Or, si, parfois, par le jeu d'un autocentrisme
inconscient, familier aux tempéraments autoritaires, il a pu employer, sur son
rôle, des formules excessives[40],
il n'a jamais posé au fondateur. Au fondement montfortain, il n'a jamais
touché.
L'organisation dont, avec
tant de bonheur, il équilibra les lignes essentielles, allait cependant
connaître une modification profonde et soudaine. La chose avait été décidée,
dans le secret, par le P. Deshayes lui-même, sous la pression obstinée du Frère
Augustin. La révélation en éclata, comme un coup de tonnerre, sur sa tombe à
peine scellée.
II - LA CRISE INTÉRIEURE
(1841-1875)
« Notre digne
supérieur... le dirai-je, mes très chers Frères ? Oui, il faut le dire ! notre
illustre fondateur n'est plus de ce monde ! » Ainsi s'exprimait le Frère
Augustin dans une circulaire datée du 29 décembre 1841, donc du lendemain de la
mort du P. Deshayes. « Notre fondateur » ? Mais alors, Montfort ?... Et les
Frères de s'interroger, d'autant plus perplexes et troublés que ces mots : le
dirai-je ? Oui, il faut le dire ! non seulement bouleversaient la conviction
sereine dans laquelle le P. Deshayes lui-même les avait toujours entretenus,
mais encore les invitait à couronner le restaurateur de leur société de cette paternité
spirituelle, que l'histoire et la tradition confèrent au seul Montfort. «
Continuez vos exercices comme auparavant, ajoutait le Frère Augustin, et soyez
sans inquiétude sur le sort de la congrégation. Nous sommes les enfants de la
Providence, elle aura soin de nous. De plus, notre tendre Père a arrangé les
choses de manière à lever toutes les difficultés. » Nouvelle énigme qui
accroissait le malaise. De quelles difficultés pouvait-il bien s'agir ? L'installation
à la maison Supiot avait eu lieu dans les meilleures conditions ; les Frères
étaient en plein accroissement ; une belle fraternité, s'épanchant en mille
services réciproques, les unissaient aux missionnaires et aux Filles de la
Sagesse. Où donc le Frère Augustin les voulait-il mener ?
La face, plus que jamais
sévère et fermée, de leur directeur général ne les inclinait assurément pas à
lui demander quelque explication. Mais, bien vite, on sut, en gros, à quoi s'en
tenir. Au hasard des conversations, par phrases non équivoques, le Frère Augustin
levait le voile. Un prêtre, de passage à Saint-Laurent, lui ayant demandé si un
missionnaire n'allait point succéder au P. Deshayes, comme supérieur général
des Frères : « Non, s'entendit-il répondre, l'intention de notre P. Deshayes
était tout autre et c'est un Frère qui sera désormais à la tête de l'Institut.
» Puis le Frère Augustin de déclarer sèchement, la main sur un cahier posé
devant lui : « Voilà ce qui est réglé, monsieur, et cela s'observera. Si la
Congrégation doit périr, elle périra entre les mains d'un Frère. » Ainsi
l'arrière-pensée du Frère Augustin se faisait-elle jour, appuyée sur un
document encore inconnu. Un propos de telle importance ne manqua évidemment pas
de s'ébruiter, tant chez les Pères que chez les Frères. Par ailleurs, une semaine
après cet entretien mémorable, le 14 janvier 1842, le P. Dalin était élu
supérieur général, en remplacement du P. Deshayes. Or les Frères s'aperçurent
qu'il ne les gouvernait pas.
Les missionnaires n'en
étaient pas moins stupéfaits que les Frères. Le P. Deshayes n'avait laissé
entrevoir à aucun d'entre eux semblable révolution. Quand le Père mourut, ils
ne doutaient pas qu'un des leurs ne fût appelé à lui succéder comme supérieur
général, non seulement des Pères et des Filles de la Sagesse mais des Frères.
Averti des conversations de Saint-Gabriel, le P. Dalin se tenait dans une digne
réserve. Quant au Frère Augustin, le bref intérim — quinze jours — du
généralat, l'avait servi, en créant une situation de fait propice à ses
desseins. Il s'agissait maintenant pour lui d'aller vite, d'enfoncer, dans tous
les milieux, à coups redoublés, l'étrange conviction dont il était possédé.
A une demande de
subsides qu'il adressa à quelques évêques de la région, il joignit une notice
sur les Frères. Il y disait : « La Congrégation des Frères de l'Instruction
chrétienne, établie à Saint-Laurent-sur-Sèvre (Vendée) est une branche de celle
de Bretagne, dont le chef-lieu est à Ploërmel (Morbihan) et qui est dirigée par
M. l'abbé Jean-Marie de la Mennais. Les deux congrégations ont eu pour
fondateur M. l'abbé Deshayes et elles ont pris naissance dans la maison curiale
d'Auray, dans l'année 1815.
»
Volatilisée, ces mots « du Saint-Esprit » par quoi s'affirmait la continuité
montfortaine ! Exorcisé, le fantôme de Montfort ! Les cinq postulants et les
quatre novices amenés d'Auray, de cette Bretagne bretonnante d'où procède tout
bien, ces quelques jeunes gens, prenant racine dans le tuf saint-laurentais,
annihilaient plus d'un siècle de tradition et d'histoire. Le Frère Augustin s'offrait
même le luxe de déposséder Jean-Marie de la Mennais de son titre de
co-fondateur des Frères de Ploërmel[41].
Chez les Frères, la
surprise fut extrême : il y eut de nombreux remous, des protestations.
S'étonnera-t-on que la réaction n'ait pas été plus vive et soit restée
inefficace ? Cela s'explique en premier lieu par la puissante et dominatrice
personnalité du Frère Augustin, dont l'autorité se renforçait d'ailleurs de
certaines vertus religieuses, notoires et éprouvées. D'autre part, les Frères,
ayant pleinement atteint l'âge d'homme, étaient au loin, retenus dans les
diverses fondations (quatre-vingt-huit à cette époque), ceux qui entouraient le
Frère Augustin de tout jeunes gens, presque des enfants, engoncés dans leur
timidité de novices, et qui n'étaient ni en mesure, ni en capacité de réagir.
Le Frère Siméon, entre tous désigné par son passé et ses fonctions, pour
rétablir, avec le poids suffisant, les droits de l'hÏ6toire, le caractère sacré
de la paternité montfortaine, le respect de la tradition, se montrait
malheureusement d'une bonté qui versait aisément dans la faiblesse. Il n'était
que l'ombre tremblante de la silhouette carrée et péremptoire du Frère
Augustin. Seules, quelques observations, en marge des chroniques du supérieur
général, marquent discrètement son désaccord. Tels Frères de valeur, le Frère
Abel, par exemple, d'ailleurs fort conciliant lui aussi, se trouvaient ainsi
isolés. Leur protestation devait être précieuse pour l'avenir. Elle se
manifestait, pour l'immédiat, impuissante. Enfin le Frère Augustin n'avait-il
pas été le compagnon de la première heure du P. Deshayes et, malgré
résistances, bougonneries, excédante obstination, son homme de confiance, son
confident, et cela jusqu'au dernier moment ? Ainsi bénéficiait-il du halo de
reconnaissante vénération dont le vieux chef disparu restait entouré. Enfin, il
était, — et ce par la volonté du P. Deshayes — directeur général des Frères. A
son égard, jouait l'obéissance religieuse. Les oppositions qu'il rencontra
s'arrêtaient à la limite où pouvait paraître compromise son autorité
statutaire. Ainsi s'explique une passivité relative qui ne fera, pendant de
longues années, que s'accroître, du chef de l'action redoutable de la routine
et de la tyrannie du fait accompli. Encore toutes ces considérations ne
valent-elles que pour les opposants et les mécontents ; or, s'ils
représentaient la valeur, il n'est pas sûr qu'ils fussent la majorité.
L'influence personnelle du Frère Augustin s'était exercée, aux postes
névralgiques, et avec quelle persévérante âpreté ! pendant vingt années. C'est
dire qu'il avait gagné à ses vues nombre de Frères, que leur jeune âge et leur
formation première, très rudimentaire, rendaient singulièrement perméables. Il
n'en était guère qui se préoccupassent de prendre à leur compte les divagations
du Frère Augustin sur l'origine historique des Frères ni même d'en étudier le
bien fondé. Mais un bon nombre envisageait à sa suite un Institut séparé, avec
les mesures que cette séparation comportait. Cela seul était retenu d'eux, mais
avec faveur.
Et les coups de théâtre
de se multiplier. Une circulaire du 10 mars 1842, signée du Frère Augustin, annonçait
officiellement, sans plus de détails, que les Frères seraient désormais
gouvernés par un des leurs, désigné par voie de scrutin. Une nouvelle
circulaire, le 6 juillet, convoquait tous les Frères pour le 10 septembre.
C'est alors qu'ils eurent, pour la première fois, connaissance du document
mystérieux auquel le Frère Augustin avait plusieurs fois fait allusion. Ils se
trouvèrent ainsi devant une règle élaborée par le P. Deshayes, signée par lui
le 8 janvier 1837, approuvée par Mgr Soyer le 9 avril 1838, et qui, de par la
volonté du P. Deshayes, devait être tenue secrète de son vivant pour n'être
promulguée qu'après sa mort.
L'article capital, le
seul qui doive nous retenir ici, en était le suivant : « Les Frères choisiront
parmi eux un supérieur qui sera chargé du gouvernement de la Congrégation. Il
aura un ou deux assistants, selon l'accroissement que prendra la Congrégation.
Il y aura aussi deux conseillers et un procureur. Tous seront choisis, comme le
supérieur, par la voie du scrutin, et pour le même temps, selon le besoin.
» Par un tel article, la séparation des Frères habitant
la mais
on Supiot d'avec les missionnaires et les Frères résidant dans la maison
primitive se trouvait consommée. Cela signifiait pratiquement que la catégorie
enseignante des Frères formait désormais un Institut pleinement autonome, ayant
son propre supérieur général et son administration particulière. Dans
l'imagination du Frère Augustin, ce n'était autre chose que la consécration du
primat d'Auray ; en fait, le nouvel état entraînait automatiquement une
scission dans la communauté des Frères montfortains et une totale indépendance
administrative à l'égard des missionnaires. Les enseignants continuaient
cependant d'être des Frères de l'Instruction chrétienne du Saint-Esprit, l'appellation
de « Saint-Gabriel » étant simplement une référence, d'usage populaire, à leur
habitat.
La règle avait été communiquée
aux Frères à l'issue d'une retraite. Aussitôt après, eut lieu l'élection. Les
soixante-quinze Frères électeurs désignèrent à la majorité des voix le Frère
Augustin comme supérieur général, pour cinq ans, le Frère Siméon comme premier
assistant, le Frère Abel comme second assistant. Ce scrutin soulignait non
seulement l'influence du Frère Augustin, mais aussi l'estime où étaient tenues ses
incontestables qualités de gouvernement. Cependant, une significative réserve
était faite sur sa thèse touchant la filiation des Frères. Les deux assistants
généraux élus se trouvaient être partisans très fermes de l'authentique origine
historique de l'Institut. C'est tout ce qui put être fait pour marquer la
protestation du bon sens, à la fois trop peu et beaucoup.
De cette règle de 1837,
nul n'avait jamais eu connaissance jusqu'à septembre 1842, hormis les Frères
Augustin et Siméon. Les missionnaires eux-mêmes ignoraient des dispositions
qui, pourtant, détachaient de la triple communauté la part la plus importante
d'une de ses familles religieuses et privaient brusquement les missionnaires
d'une juridiction spirituelle nécessaire. On est réduit aux conjectures sur les
raisons du silence du P. Deshayes. Le plus probable est qu'il n'aura pas voulu,
si tôt après la règle de 1830, qui donnait aux Frères un supérieur général
missionnaire, paraître, en se déjugeant, manquer d'esprit de suite. C'eût été
risquer la perte, en cette affaire, d'une bonne part de son autorité, de son
prestige, de son crédit. Sans doute a-t-il craint aussi de susciter, parmi les
Pères notamment, des remous, des protestations, une atmosphère de trouble et de
division dont son action, sur tous les plans où elle s'exerçait, se fût trouvée
affaiblie. Il semble également certain qu'il ne c'est résolu à cet article de
la règle de 1837 qu'à contre-cœur. Il est à cet égard un témoignage
impressionnant, celui du Frère Siméon : « La pensée de choisir un supérieur
parmi les missionnaires le suivit jusqu'au tombeau et il s'en exprima plus que
jamais dans les dernières années de sa vie. » Voilà qui dénote la part
prépondérante du Frère Augustin dans cette décision. La formule de la
publication posthume servait son dessein : consommer la séparation sans
qu'aucune réclamation fût possible, arguer d'une détermination écrite et
signée, sur laquelle la mort aurait mis le sceau définitif. Tout appel, tout
recours serait impossible, le P. Deshayes seul pouvant défaire ce qu'il avait
fait. C'est sous cette pression acharnée que le P. Deshayes, du reste encombré
de tant d'autres affaires, dut céder. Et s'il alla de la sorte contre son sentiment
profond, c'est que, prévoyant la séparation inévitable, par le fait tant du
Frère Augustin que des Frères, assez nombreux, ralliés à ses vues, il voulut du
moins que la chose se fît régulièrement, par son autorité reconnue de tous,
afin d'éviter à une part capitale de son œuvre de graves dommages, sinon
l'effondrement. De cette menace de schisme, le Frère Augustin jouera
continuellement.
Homme d'une idée, le
Frère Augustin s'acharna à en assurer le triomphe complet. Sa finesse et sa
méfiance paysannes, son expérience du milieu, l'avertissaient que la partie
n'était pas encore gagnée ; il se savait des opposants de qualité, notamment
dans la personne de ses deux assistants; il y avait aussi, dans les trois communautés
de Saint-Laurent, des témoins bien gênants : il s'agissait de neutraliser les
uns et les autres. Il fallait encore introduire dans la circulation générale la
contre-vérité dont il s'enchantait, gagner à sa thèse l'opinion publique, non
par des arguments et dissertations — le Frère Augustin affirmait toujours, ne
prouvait jamais — mais par le moyen plus efficace d'une répétition obsédante. Il
fit jouer à fond dans ce sens les pouvoirs dont l'investissait le généralat. Sa
correspondance, ses circulaires, ses entretiens avec les Frères ou les
personnes du dehors, allaient systématiquement et continuellement à éliminer
jusqu'au souvenir de Montfort et à imposer son idée-force : le P. Deshayes seul
et unique fondateur des Frères de l'Instruction chrétienne de Saint-Gabriel,
religieusement consanguins des Frères de Ploërmel. En tête du manuel de piété
qu'il composa pour l'Institut, s'étalait l'unique image du P. Deshayes, avec le
titre de fondateur
[42]
. La région
fut inondée des portraits du même, portant texte analogue. Cette publicité
finit par agir. Le gros du public alla à la thèse du Frère Augustin comme il va
au savon Cadum. Quant aux élites ecclésiastiques et laïques, faute de connaître
les éléments de la question, elles s'en rapportèrent aux affirmations d'un
supérieur général régulièrement désigné, religieux austère et qu'au surplus,
nul, parmi les siens, ne contredisait publiquement. Quant à l'évêque de Luçon,
Mgr Soyer, il n'avait aucune raison, en l'absence de tout appel à son
arbitrage, de s'immiscer dans une affaire touchant l'origine spirituelle d'une
Congrégation.
Le 3 septembre 1847,
deuxième assemblée générale, nouvelle élection. Le Frère Augustin est réélu
supérieur général, mais cette fois il ne l'est plus que par quarante voix sur
cinquante-cinq votants. D'autre part, le Frère Siméon, opposant timide, mais
convaincu, est réélu premier assistant à la presque unanimité. Le second
assistant est le Frère André, partisan de l'origine montfortaine et du retour
des missionnaires à la supériorité générale. Son sentiment est manifestement
partagé par tous les membres du Conseil. Tel est le résultat d'une expérience
de cinq années sous la férule du Frère Augustin. De prime abord, celui-ci
paraît tout enivré de sa réélection. Dans ses Mémoires (avertissons qu'il parle
toujours de lui à la troisième personne) il épanouit ses sentiments avec une
ingénuité stupéfiante : « C'est à cette deuxième élection que le très cher
Frère Augustin a touché ou plus haut point de gloire où il lui a été permis de
monter en ce monde. » Mais, en fait, sur ces sommets où il se complaît si
visiblement, le Frère Augustin ne doit pas manquer d'éprouver, signe
avant-coureur de la bourrasque, la désagréable fraîcheur d'un vent coulis.
Il est bien trop sensible
à tout ce qui le contrarie et menace sa chère obsession, pour n'avoir pas tiré
du scrutin la leçon qu'il comporte. Les conséquences ne vont pas tarder à s'en
développer. Un sérieux mouvement s'esquisse pour renouer la tradition montfortaine.
Le Frère André, dont le caractère est autrement décidé que celui du Frère
Siméon, sonde les Frères, évitant, bien entendu, les partisans notoirement irréductibles
du Frère Augustin. Il s'aperçoit qu'ils sont nombreux à désirer que la
supériorité retournât aux missionnaires. Ayant à faire la visite des
établissements de l'Institut en 1851, il y poursuit ses sondages et parvient
aux mêmes conclusions. Le Frère Siméon, de son côté, rencontrant Mgr Baillés,
le nouvel évêque de Luçon, s'ouvre à lui de la question et, peu après, se
décide à soumettre au propre successeur du P. Deshayes, le P. Dalin, un Mémoire
qui tend aux mêmes fins. Au vrai, ce Mémoire était primitivement destiné au
Frère Augustin, mais le courage d'affronter ses foudres et leurs conséquences,
au vrai redoutables, avait manqué au trop débonnaire Frère Siméon. Tout cela se
passe à l'insu du Frère Augustin, mais celui-ci finit par en avoir vent. Il
morigène vertement le premier assistant d'abord, puis son conseil réuni. Il se
heurte à un silence respectueux mais désapprobateur. L'affaire cependant reste
sans suite. Le Frère Augustin a pour lui les statuts signés du P. Deshayes.
Comment élire un missionnaire contre un article formel et fondamental de la
règle? C'est ce qui, sans doute, autant qu'une discrétion méritoire, gardait le
P. Dalin d'entrer en lice.
Seulement, à l'assemblée
générale du 8 septembre 1852, le Frère Siméon fut élu supérieur général au
premier tour de scrutin, en remplacement du Frère Augustin
[43]
. Celui-ci,
ayant par dépit refusé tout mandat d'assistant, voyait le poste de premier
assistant attribué au plus entreprenant des adversaires de sa thèse : le Frère
André, tandis que le Frère Abel, autre opposant, de tempérament modéré mais
ferme, était élu comme second assistant.
Aussitôt, les gémissements
inénarrables, dont parle l'Ecriture, de déborder de l'âme très amère du Frère
Augustin. « Voilà, écrit-il de lui-même dans ses Mémoires, voilà cette première
pierre de l'édifice de Saint-Gabriel brisée, voilà cette maîtresse colonne
renversée et, qui, probablement, ne sera plus relevée. » Phrase curieusement
parallèle, dans son âpre mélancolie, à celle, si candidement triomphante, qui
saluait son élévation au généralat. Elle témoigne du même état d'âme : le Frère
Augustin ne se satisfait qu'au pouvoir, que dis-je ? que muni des pleins
pouvoirs. Hors quoi il n'est pour lui que désolation et que cendres. Il crie
qu'il est victime d'une conjuration, sans se demander si son caractère n'en est
point cause qui ne supporte pas une observation et oblige son entourage à agir
à son insu. Pas davantage, il ne se pose la question de rester au sein du
Conseil, comme il y est invité, pour assister son compagnon des premières
heures, le Frère Siméon, et ses autres confrères, de sa vieille expérience et
de son sens, universellement reconnu, de l'administration. La première place
est la seule qui lui convienne et qu'il puisse décemment accepter. D'autre
part, il incarne le mythe de l'origine bretonne de l'Institut et du primat de
Deshayes sur Montfort, à tel point que, à ses yeux, s'en prendre à lui, Frère
Augustin, c'est s'en prendre au P. Deshayes, c'est torpiller la thèse :
Deshayes-fondateur. Voilà ce qu'il voit aussi et ce qui le déchire, dans la
nuit soudaine de son isolement. En soi, la déposition d'un supérieur par la
voie normale de l'élection n'a rien d'une catastrophe. Mais, en de telles
circonstances, le romantisme de la terre ancestrale grossit toutes choses et
drape la sombre irritation du religieux breton d'un pathétique insolite.
De tout cela, dont ils
ont d'abondants échos, que pensent les missionnaires ? Et quelle est, à l'égard
des Frères, leur attitude ? Nul doute que, l'existence des statuts de 1838
révélée, ils n'aient été, le P. Dalin en tête, douloureusement affectés. Ainsi,
pendant sept années, le P. Deshayes leur avait caché une règle, destinée aux
Frères sans doute, mais dont une des dispositions essentielles modifiait
profondément l'économie générale des communautés montfortaines ! Par surcroît,
le Frère Augustin, agissant avec la désinvolture d'un dictateur qu'il était en
effet, négligeait même de les avertir, de prendre avec eux le contact de pure
forme et de simple courtoisie qui se fût pour le moins imposé. Son propre
témoignage est explicite à cet égard : « Ils (les Frères) se mettent à l'œuvre
sans en parler aux missionnaires du Saint-Esprit, ni à M. Dalin qu'ils viennent
d'élire leur supérieur... Le Cher Frère Augustin... n'ayant pas assez
d'intimité avec le nouveau supérieur du Saint-Esprit, il est resté sans prendre
d'autre conseiller que son bras droit, le Cher Frère Siméon. » Soit dit en
passant, les conseils du Cher Frère Siméon ne pesaient pas lourd dans les
décisions du Frère Augustin. Mais il y a beaucoup d'inconscience dans le cas de
celui-ci : à peine a-t-il écrit ce qui précède, qu'il parle comme « d'une croix
» de l'attitude du P. Dalin : « Le nouveau supérieur du Saint-Esprit paraît
froid à notre égard. » Comment le P. Dalin ne se fût-il par tenu dans la
réserve ? Il ne pouvait paraître imposer un conseil qu'on s'abstenait de lui
demander ? Par ailleurs, comment lui, qui avait affirmé si fortement l'origine
montfortaine des Frères, n'eût-il pas vu avec peine le Frère Augustin proclamer
avec éclat le P. Deshayes leur unique fondateur ? Enfin, il ne pouvait, par une
présence personnelle fréquente à Saint-Gabriel, paraître encourager une
opposition à des statuts signés de son prédécesseur.
En définitive, son
attitude fut d'une parfaite dignité. S'il se borna, quant à lui, à se rendre à
Saint-Gabriel, en quelques occasions solennelles, il fut bien loin de négliger
les Frères enseignants ; il leur rendit nombre de services, s'attachant à diminuer
leurs dépenses (notamment dans la construction de leur chapelle, en février
1842) et engageant ses missionnaires à leur porter gratuitement la plus active
assistance spirituelle. En 1852, au cours de l'assemblée générale qui devait le
déposer, le Frère Augustin pouvait dire aux Frères présents : « Je dois
rendre... et je rends en effet, le même hommage de reconnaissance aux dignes
missionnaires du Saint-Esprit, car eux aussi ne nous ont jamais manqué depuis notre
séparation. Vous êtes tous témoins avec quel zèle ils s'emploient tous les ans
à nous donner une retraite ; ce zèle est le même en tout autre temps de
l'année. A peine sont-ils arrivés de mission, fatigués et pour ainsi dire hors
d'état de travailler qu'ils viennent nous dire une seconde messe les dimanches
et jours de fête, et ils nous donnent des instructions quand nous les en prions
ou ils ne peuvent absolument. De plus, ils n'oublient pas nos pensionnaires
[44]
et tous les
ans aussi ils se plaisent à leur donner une retraite à l'époque de la première
communion. Cette année que nous avons eu le malheur de perdre M. Bourgeois,
notre digne aumônier, ces messieurs du Saint-Esprit nous ont été encore plus
fidèles et, au lieu d'un aumônier que nous avons perdu, nous en avons trouvé en
eux jusqu'à trois à la fois. » C'est que, convaincus, comme leur supérieur
général, d'une communauté d'origine qu'ils n'avaient jamais pensé à mettre en
question, les missionnaires répondaient tout naturellement, en multipliant
leurs services, à un profond sentiment fraternel. Fils de Montfort ils venaient
en aide aux fils de Montfort. Cette consciente union dans le culte du même Père
devait durer de nombreuses années, se manifestant parfois d'une façon
singulièrement frappante, comme en 1857, quand s'ouvrit le premier chapitre
général de Saint-Gabriel. Il fut en effet conjointement présidé par le vicaire
général de Luçon et le R. P. Denis, supérieur général de la Compagnie de Marie[45]
successeur, depuis 1856, du P. Dalin. Ainsi retentissait toujours le chant
commun du Berceau.
Les Filles de la Sagesse
ne pensaient, ni n'agissaient autrement que les Pères. En pleine offensive
augustinienne, les Annales de la Sagesse, organe officiel de leur congrégation,
par la plume d'une des Sœurs les plus éminentes, titulaire de hautes charges,
reconnaissaient aux Frères enseignants, comme à ceux demeurés au Saint-Esprit
un même fondateur : Louis-Marie Grignion de Montfort. Quant à leur
collaboration avec eux, elle s'affirmait et allait se développer de plus en
plus, dans les institutions de sourds-muets où Sœurs et Frères rivalisaient
d'intelligente activité pédagogique et d'émulation fraternelle.
En de tels témoignages,
le Frère Augustin se refusait à voir, malgré l'évidence, la robuste continuité
du courant historique, la vigueur d'un flot spirituel jailli du tombeau même de
Montfort. Son échec à la troisième assemblée générale l'avait laissé aigri,
comme racorni et pelotonné sur lui-même, ne se détendant que pour des coups de
boutoir aux adversaires de sa thèse, aux instigateurs du complot qui l'avait
détrôné. Cela faisait dire à un bon Frère, pourtant Breton lui aussi : « Le
Frère Augustin est bien trop Breton tout de même, dame ! » De fait, le Frère
Augustin s'arcboutait de plus en plus sur le granit natal. Moins que jamais, il
ne renonçait, même rentré dans le rang, à s'attaquer à l'origine montfortaine
et à y substituer sa légende. « Quand le Frère Augustin épouse une cause,
disent ses Mémoires, il faut qu'il emporte la pièce. » Il s'y acharnera en
effet jusqu'à son dernier soupir. Peu après sa chute, après avoir tracé de
lui-même un portrait, d'ailleurs peu flatté, il écrivait : « Voilà une idée de
ce supérieur qui, hier encore, nous dictait des lois à tous et aujourd'hui il
est déjà un sujet d'embarras dans la congrégation ; il est surtout un sujet
d'embarras pour son successeur. » C'est ce qu'en effet le Frère Siméon allait
vérifier.
Tout homme est un complexe,
le Frère Augustin, si simpliste qu'il fut, comme les autres. Les passages de
ses Mémoires, relatifs à cette époque, contiennent des réflexions impressionnantes
d'humanité sans fard, d'affection blessée, de respect pour la volonté divine,
mêlées à des propos qui, comme ceux déjà cités, révèlent l'amour-propre ulcéré
et une volonté de domination déçue. « Il était humilié en pensant que sa chute
annonçait qu'il n'avait pas su satisfaire tous ses Frères. D'un autre côté, il
les aimait tous tellement que la pensée qu'il ne pourrait plus avoir cette
communication journalière et directe avec eux lui perçait le cœur. Et puis...
habitué à vivre à Saint-Gabriel, où il avait tout créé, pour ainsi dire, la
pensée d'en sortir et de tout laisser à un autre ne lui était pas insensible...
Il n'écrit point ceci en forme de plainte ; mais si jamais la volonté divine
honore de la croix de notre bon Maître les futurs supérieurs, qu'ils sachent
que leurs devanciers l'ont aussi portée. » Il semblerait, après cela, qu'il va
porter sa croix sans mot dire et, de fait, quand le Frère Siméon lui demandera,
par déférence, quel poste il veut occuper, le Frère Augustin répondra : «
Choisir ne serait point assez religieux : je ne veux qu'obéir. » Seulement, à
peine nommé directeur de l'école de Lille, son humeur reprend du mordant, et
quel mordant ! Il n'accepte qu'à deux conditions : « La première qu'il irait à
Lille avec les pouvoirs de supérieur général, pour l'établissement, bien
entendu... la deuxième condition qu'il n'y serait visité que par son supérieur
général... dans le but d'empêcher d'être visité par le Frère André que lui
avait été si opposé avant les élections. »
Le Frère Siméon concède
ceci et cela pour maintenir la paix. Il s'éprouve en situation bien pénible.
Déjà gêné, comme le serait tout autre à sa place, d'avoir à commander à celui
qui fut son chef pendant vingt-sept ans, il lui faut, nature paisible,
conciliante et douce, plutôt timorée, maintenir dans la bonne règle le plus
dominateur et rétif des subordonnés. A peine arrivé à Lille, le Frère Augustin
envoie à Paimbœuf un Frère qu'il devait envoyer à Saint-Laurent. « Flagrant
abus de pouvoir », écrit-il lui-même dans se Chroniques. Le Frère Siméon, bien
entendu, ne ratifia pas ce déplacement, mais la situation de l'un à l'autre demeura
tendue. D'où, pendant près de deux ans, une correspondance de ton fort sec.
Cette correspondance
toucha, en 1853, au point névralgique. Depuis 1849, une demande d'approbation
légale de l'Institut pour toute la France était en instance à Paris[46].
Cette année-là, et à ce propos, les points de vue du Frère Augustin, alors
supérieur général, d'une part, du Frère Siméon et des membres du Conseil
d'autre part, s'étaient vivement heurtés. Le Frère Augustin voulait que la
Congrégation fût approuvée sous le nom de Congrégation de Frères de
Saint-Gabriel et, passant outre à l'opposition de son Conseil, fit rédiger dans
ce sens la demande d'approbation. En supprimant les mots : du Saint-Esprit, le
Frère Augustin rompait le dernier lien officiel qui rattachât l'Institut à sa
souche montfortaine, ce que s'était bien gardé de faire, dans ses statuts de
1838, le P. Deshayes[47].
Sitôt élu supérieur général, le Frère Siméon, répondant au vœu unanime du
Conseil, comme à son plus vif désir personnel, s'était préoccupé de faire
revenir l'Institut sous la juridiction du supérieur des missionnaires. Pour y
arriver, il importait, avant tout, de garder la dénomination traditionnelle.
Mis au courant : « Je vois bien, écrivit au Frère Siméon le Frère Augustin, que
vous voulez vous faire remplacer par un prêtre. Eh bien! Essayez!... » C'était
dire en clair, comme il le reconnaît lui-même dans ses Chroniques, qu'il
quitterait, dans ce cas, l'Institut. Le Frère Siméon tint bon, mais
condescendant à l'excès, il chargea le Frère Augustin, pensant ainsi le
contenter, de faire une démarche à Paris pour hâter l'approbation. Il y mit
cependant une condition expresse : pas de changement dans la dénomination. «
Pendant que vous étiez au pouvoir, rappela-t-il au Frère Augustin, vous m'avez
forcé la main d'écrire au ministre pour que le titre de Saint-Gabriel fût
substitué à celui du Saint-Esprit sous lequel nous sommes reconnus par
l'ordonnance royale de 1823 ; depuis, les affaires ont changé ; je ne
consentirai jamais à ce changement ; nous sommes connus sous le titre de Frères
de l'Instruction chrétienne du Saint-Esprit ; c'est là notre vrai nom, je ne
dois et ne puis consentir qu'on le remplace par un autre. » Or, le Frère Augustin,
s'étant rendu à Paris, pressa M. de Ségur, maître des requêtes au Conseil
d'Etat, d'agir en faveur du changement. Le 3 mars 1853, l'approbation impériale
était accordée aux Frères de l’Instruction chrétienne de Saint-Gabriel, Le
Frère Siméon et son Conseil étaient mis en présence du fait accompli.
Il y avait là un cas de
désobéissance fort grave, qui ne contribua pas à lénifier la correspondance de
Saint-Laurent à Lille et vice versa. Cependant, en mai 1854, le Frère Siméon,
ayant autorisé le Frère Augustin à se rendre à Saint-Laurent, son extrême bonté
rendit la rencontre si cordiale que l'ancien supérieur et le nouveau convinrent
de détruire les lettres échangées depuis 1852, pour qu'aucune trace ne restât
de leur différend[48].
Puis, le Frère Augustin revint à Lille. Sur ces entrefaites, le 26 novembre 1855,
le P. Dalin remettait définitivement au Souverain Pontife sa démission de
supérieur général. C'était un nouveau coup, fort dur, porté aux espérances,
d'ailleurs fléchissantes, du Frère Siméon et de son Conseil. Homme bien fait
pour faciliter avec conviction, autorité et tact, le retour des Frères à la
juridiction du supérieur des missionnaires, fort désireux au surplus de s'y
employer, le P. Dalin, malgré certaines sérieuses lacunes, devait manquer
irrémédiablement à un projet déjà déchiqueté par les rudes mâchoires du Frère
Augustin.
En 1868, celui-ci revenait
définitivement à Saint-Laurent et, désormais sur place, monta une garde de plus
en plus vigilante et efficace. Le paradoxe continua d'un supérieur général et
de son conseil, opposés à la formule du gouvernement par un Frère et s'y tenant
cependant, faute de pouvoir briser l'opposition de l'ancien supérieur général.
Las de cette contradiction interne, le Frère Siméon, au bout de dix ans,
demanda à n'être pas réélu. Il fallut s'incliner devant son désir formel. Le 17
août 1862, le deuxième chapitre général désignait, pour son successeur, le
Frère Eugène-Marie.
Aussitôt, le Frère Augustin
fit front. Dans le nouveau supérieur, il flairait depuis longtemps un adversaire
de sa thèse, et aussi une personnalité forte et décidée, peut-être capable de
quelque vigoureuse incursion sur ses chasses gardées. Aussi, usant, comme il
fait souvent, de cette manière feutrée et indirecte qui provient de ses
origines paysannes et contraste curieusement avec ses coups de boutoir, il note
dans ses Chroniques : « L'élection du Frère Eugène-Marie a jeté une sorte de
stupeur parmi les Frères, et même en dehors de la congrégation. J'ai entendu
plusieurs dire que désormais c'en était fait du P. Deshayes et peut-être de ses
règles... » On dit... on dit... Voilà plutôt ce que dit le Frère Augustin. De
fait, en 1871, le Frère Eugène-Marie soumettait, au quatrième chapitre général,
un certain Manuel des Constitutions où
il parlait de « Notre Vénérable Père de Montfort ». C'était descendre dans
l'arène et le taureau fonça. Dans quel sens? Les Chroniques nous le disent : «
Certainement, le vénérable Père de Montfort fut réellement un homme de bien...
mais cela ne l'établit point le fondateur de notre congrégation. Au chapitre
général de 1871, un des capitulants dit qu'il n'y avait pas longtemps qu'il
avait lu la vie du P. de Montfort et que réellement il avait cru y remarquer
que ce bon Père était véritablement notre fondateur ; je combattis cela de
toutes mes forces et je dis à ce Frère que, s'il croyait le P. de Montfort
notre fondateur, sa place était au Saint-Esprit et non à Saint-Gabriel... »
Ne faisant pas partie de
l'administration générale, le Frère Augustin ne disposait que des chapitres
généraux pour déverser son amertume sur le supérieur général, mais il en
profitait bien. Les initiatives du Frère Eugène-Marie soulevaient, presque
toutes, sa critique acerbe. Que le nouveau supérieur général encourageât les
études, notamment des langues étrangères, qu'il procédât à l'achat de bons
livres, ou instituât pour les Frères des retraites de trente jours, ce lui
était l'occasion d'interventions si véhémentes que l'atmosphère des Chapitres
en devenait explosive, an grand dam de la sérénité nécessaire. C'est du moins
ce qui ressort des textes mêmes du Frère Augustin : « Ces représentations de
l'ancien supérieur paraissaient fort sensibiliser le supérieur actuel, on
voyait qu'il se contraignait pour ne point interrompre son accusation ; enfin
il rompt le silence que jusque-là il avait gardé et il dit à son ancien
supérieur que, s'il voulait continuer, il serait obligé de lui interdire la
parole ; le vieux supérieur répond que, tandis qu'il ne dirait point la vérité,
il ne pensait pas qu'on pût l'empêcher de parler... Le C. Frère Siméon avait prié
son ancien de s'arrêter, plusieurs autres membres donnaient des marques
d'improbation ; on entendait dans la salle des remuements et des soupirs ;
le très cher Frère Augustin, s'apercevant de tout cela, dit qu'il lui semblait
que dans la circonstance, non seulement on pouvait dire la vérité, mais qu'à
son avis on devait la dire tout entière... » Les Mémoires volumineux du Frère Augustin
fourmillent de tableaux analogues, dont la répétition est même fort
fastidieuse. Celui-ci suffit à caractériser la situation. Le Frère Augustin
lui-même se charge de le commenter, en l'une de ses confessions, d'une impavide
objectivité, dont il a le secret : « Ces dernières pensées, dit-il d'une de ses
interventions, ont été repoussées par plusieurs membres du chapitre avec
frémissement, et on pourrait dire avec une sorte d'indignation ; le Frère
Augustin lui-même a dit qu'il ne les a point approuvées ; cependant il ne les a
point rétractées publiquement. En cet endroit notre vieux Père (c'est ainsi
qu'on l'appelait dans le cercle de sa famille religieuse) est réellement allé
trop loin ; par ailleurs il n'est point sorti de la vérité dans tout ce qu'il a
dit, mais en général, il y avait trop d'animation, trop d'humeur et par suite
trop d'aigreur dans son accusation ; d'ailleurs on a vu qu'il a souvent manqué
de modération quand il a trouvé de trop fortes oppositions à la chose qu'il
défendait. C'est dans son caractère qui paraît fait pour dominer. »
Pour tout dire, le «
Vieux Père » était excédant. Jusqu'à sa mort, il ne désarma pas. Son offensive
tatillonne brisait les nerfs du Frère Eugène-Marie, au point d'en affecter sa
santé. Aucun échange de vues raisonnable n'était possible avec le rude Breton,
et il fallait se borner à subir ses coups de bélier. Il n'admettait aucune
innovation, aucun progrès. Il n'était pour lui de fidélité religieuse et
intellectuelle que dans la fixité absolue. De cet état d'esprit, voici un exemple
lapidaire. Dans une lettre qu'à son déclin il adressait au Conseil
administratif, il s'écrie : « J'ai appris que... non seulement on enseigne
l'anglais chez nous, mais encore l'allemand, l'italien, etc... Si cela est, je
dis tout haut que c'est le comble de la démence et la ruine de notre
congrégation n'en est pas éloignée. De nouveau je proteste de tout mon pouvoir
contre cet état de choses, car c'est rendre méconnaissable notre congrégation.
» Encore, sur ce plan, passait-on outre à son obstruction. Mais celle-ci fut
toujours redoutablement efficace sur le point capital de l'origine
montfortaine. Tant que le Frère Augustin vécut, on n'osa rien officiellement —
ou si peu ! — contre le mythe qu'il imposait.
Certes, il peut
paraître, à première vue, surprenant que deux supérieurs généraux successifs,
appuyés l'un et l'autre de l'unanimité de leurs conseils, n'aient pu, pendant
plus de vingt ans, faire prévaloir, comme il était d'intérêt capital pour leur
Institut, le droit sacré de celui-ci à la filiation montfortaine. Mais, à voir
les choses de près, on n'en peut incriminer uniquement la faiblesse du Frère
Siméon, puisque, personnalité ardente et forte, le Frère Eugène-Marie n'a pas
agi autrement. L'un et l'autre étaient mus par des vues de prudence et de
sagesse. Le Frère Augustin n'aurait pas hésité à aller jusqu'au schisme ; son
caractère eût suffi à en assurer, si ses menaces ne l'avaient fort clairement
laissé entendre. Or, il ne fût pas parti seul ; un groupe important l'eût
suivi, dont certaines personnalités éminentes, tel le Frère Louis[49].
Par ailleurs, qu'en eût dit l'opinion, ecclésiastique ou civile? En bon
manœuvrier, le Frère Augustin l'avait saturée de sa légende. Dans ces
conditions, les conséquences d'une scission eussent pu être mortelles pour les
Frères enseignants qui venaient à peine de renaître ; elles eussent compromis
une œuvre scolaire qui, nonobstant cette crise intérieure, se développait
remarquablement. Les Frères Siméon et Eugène-Marie ne pouvaient faire que ce
qu'ils ont fait : souffrir et attendre. Toutefois, il semble que cette attitude
de passivité forcée, à force de se prolonger, ait engendré en eux de la
lassitude, voire du découragement, peut-être un certain sentiment qu'il fallait
prendre son parti de l'inévitable. Comment expliquer autrement que par cet
affaissement, non de leur conviction, mais de leur volonté, qu'ils aient parlé,
dans leurs circulaires générales, du P. Deshayes en le qualifiant de fondateur,
ainsi qu'ils l'ont fait ? La crainte d'un schisme, si fondée fût-elle, ne
suffit pas à légitimer un tel comportement. Sans doute, dans l'espoir d'apaiser
l'inapaisable Frère Augustin, ont-ils joué de l'ambiguïté du vocable en matière
de fondation religieuse. Quand un groupe est séparé d'une congrégation pour
être établi et développé à part, celui qui en a pris l'initiative est
couramment qualifié de fondateur de cette branche, mais dans le sens de second
fondateur qui laisse intacts et imprescriptibles les droits du premier, celui
des origines. Mais ici, à quoi pouvait servir d'enchérir sur le propre P.
Deshayes qui n'a ni voulu, ni assurément pensé prendre le titre de fondateur,
même dans ces statuts qui consacraient solennellement la séparation ? Au
surplus, l'emploi de ce terme était d'une imprudence dont les effets allaient
longtemps se faire sentir. Il n'eut même pas l'utilité de ramener à une humeur
plus paisible le Frère Augustin qui, ses Mémoires en témoignent d'un bout à
l'autre, connaissait si bien la conviction des deux supérieurs, quant à
l'origine montfortaine des Frères, qu'il n'a cessé de les attaquer sur ce
point. Il ne s'est point réjoui de cette formule parce que, il le savait bien,
elle n'aurait eu le sens qu'il désirait que si elle eût comporté l'exclusion de
Montfort, ce à quoi ne se sont jamais prêtés ni le Frère Eugène-Marie, ni le
Frère Siméon.
Vingt-sept ans
d'autorité, dont dix dictatoriales, n'avaient pas affaibli l'appétit de
commandement dont le Frère Augustin était possédé. Les vingt-trois ans de lutte
continuelle qui suivirent n'avaient pas davantage émoussé sa combativité. En
1875, qui fut l'année de ses 78 ans et de sa mort, il fulminait encore une
lettre au conseil administratif : « Je proteste contre toute pratique, contre
tout enseignement contraire aux statuts et aux règles que nous tenons de notre
fondateur... Qu'est-ce qui occasionna la grande division, les grandes
discussions, et je pourrais dire le grand scandale en 1852 (année de sa
non-réélection) ? C'est qu'on voulut briser l'article fondamental des statuts
dressés par notre Père. Qu'est-ce qui occasionna tant de divisions, tant de
disputes scandaleuses, tant de mécontentements dans notre regrettable chapitre
de 1871 ? C'est que là on voulut faire disparaître jusqu'au nom du P. Deshayes,
avec les règles et statuts qu'il nous avait dressés... » Tout est de ce ton.
Ayant poussé ce dernier rugissement, le vieux Frère s'endormit dans le
Seigneur, assisté des Frères Siméon et Eugène-Marie qu'il avait tant tourmentés
mais qui, à cette heure dernière, ne voyaient plus en lui que le religieux
austère et ponctuel, le compagnon fidèle du P. Deshayes, le premier supérieur
général sorti d'entre les Frères du Saint-Esprit. La paix qu'il laissa derrière
lui devait peu à peu estomper les aspérités du souvenir.
Mais, si la mort du
Frère Augustin mettait le point final à la crise intérieure de l'Institut, sa
tenace action d'un demi-siècle contre l'origine montfortaine des Frères allait
bientôt développer à l'extérieur ses méfaits. C'est bien pourquoi sa
personnalité prend en cette affaire une importance de premier plan. L'historien
aimerait tourner la page sur les manifestations — fatigantes, au surplus, par
leur monotonie — de l'entêtement du Frère Augustin et les laisser au compte
secret des affaires de famille. Mais comment les faire ? Elles paraissent se
rattacher à la petite, à la toute petite histoire. Mais la petite histoire ici
va très loin. C'est le mot de Pascal : « Le nez de Cléopâtre, s'il eût été plus
court... » Le caractère du Frère Augustin, s'il eût été meilleur, n'eût pas
accrédité une légende, douloureusement exploitée plus tard. Il n'eût pas troublé,
comme il a fait, le clair courant de l'histoire. Il n'eût pas créé de toutes
pièces un imbroglio, unique, je crois bien, dans l'histoire des Congrégations
et qui tiendrait de l'invraisemblable, si la psychologie du Frère Augustin n'en
rendait compte en tous ses entrelace.
Cette psychologie est
aisément saisissable dans les Chroniques du premier supérieur général des
Frères : treize cents pages, où une mauvaise cause est torpillée par son propre
défenseur, et telles, en vérité, qu'un historien, si indulgent qu'il soit et
soucieux de ne pas accabler leur auteur, n'y peut trouver qu'armes contre lui.
Ce qui veut être plaidoirie tourne à la confession générale ; la sincérité s'y présente
sous forme d'objectivité glaciale ; les torts y sont reconnus. Si l'on n'a pas
le droit d'affirmer que, de cet aveu, la contrition soit absente, force est
bien de dire que le frémissement n'y apparaît point. Elle n'affecte en tout cas
que le comportement du Frère Augustin quant à la discipline ou aux excès de son
caractère. De sa ligne de conduite essentielle qui consiste à éliminer Montfort
des origines de l'Institut et de sa vie spirituelle de règle, à présenter ledit
Institut comme une filiale des Frères de Ploërmel, dont le seul fondateur est
le P. Deshayes et, en conséquence, à couper tout lien avec la communauté du
Saint-Esprit comme à s'opposer à tout retour à la supériorité d'un missionnaire
ou d'un prêtre, de cette ligne-là il ne déviera jamais. Il mettra à l'imposer
l'obstination et l'habileté de manœuvre que nous avons vues ; il ne reculera
même pas devant des manquements graves à la discipline pour la garder de tout
fléchissement ; il la borde, comme de barbelés, du hérissement de son caractère
épineux. Absolument dépourvu de nuances, intelligent, mais d'une intelligence à
œillères, il ne voit rien de ce qui le contredit à tout coup.
Ce qui allège son cas,
c'est qu'il croit, à coup sûr, remplir, par des moyens dont il reconnaît
parfois le caractère contestable ou même blâmable, un devoir sacré. Il n'est pas
douteux, d'autre part, que, fils spirituel du P. Deshayes à qui il doit tout,
il lui a voué une fidélité peu commune. On serait tout à fait à l'aise pour la
trouver émouvante, si elle n'avait donné une issue à son appétit de domination.
Il faut enfin reconnaître qu'il y avait dans sa thèse une âme de vérité.
L'expérience a montré qu'il était bon, en définitive, que les Frères enseignants
fussent gouvernés par un Frère. Ils ont connu et connaissent sous ce régime
accroissement et prospérité spirituelle. Le Frère Augustin défendait généralement
ce point de vue raisonnable avec de mauvaises raisons. Il serait cependant
injuste de contester qu'il en ait entrevu les bonnes. « Un supérieur missionnaire,
disait-il par exemple, serait trop pris par les devoirs de sa charge » pour s'occuper,
comme il conviendrait, des Frères enseignants. Au point d'extension où ceux-ci
en étaient parvenus, de par l'entrain apostolique du P. Deshayes, a fortiori au
point où ils en sont arrivés, au cours des XIXe et XXe
siècles, on voit mal, en effet, un supérieur général, déjà chargé des
missionnaires du Saint-Esprit et des Filles de la Sagesse, faire face aux
problèmes d'envergure et de détail qu'un tel Institut, par ailleurs spécialisé,
pose à chaque instant. Il est même possible qu'un jour, dans l'apaisement
général revenu, le cas du Frère Augustin bénéficie totalement du Félix culpa.
III - DÉVELOPPEMENT DE L'INSTITUT
(1842 à 1935)
La crise intérieure,
dont la discipline des communautés ne fut d'ailleurs jamais affectée, ne porta
aucune atteinte au développement de l'Institut, devenu autonome. Le P.
Deshayes, en mourant, avait laissé cent trente-cinq Frères et quatre-vingt-huit
établissements. Ce beau legs, les Frères allaient le faire fructifier, avec ce
dévouement allègre qui caractérisera de plus en plus leur Congrégation rénovée.
De l'étape Deshayes à
l'étape Augustin, le passage était délicat. Un maître organisateur comme le P.
Deshayes ne se remplace pas facilement. Il fallait aussi compter avec les aléas
de la séparation, la nouveauté de l'expérience, les problèmes d'ordre financier
qui allaient se poser du jour au lendemain. Or le gouvernement du Frère
Augustin, abstraction faite de sa néfaste action antimontfortaine, mettait en
jeu, sur le plan administratif, des qualités fort opportunes. Sa poigne,
excessive en d'autres temps, maintint ce qu'il fallait maintenir, et qui eût pu
facilement fléchir et se disloquer. L'oppression des esprits qui en résultait
avait une contre-partie bienfaisante. Par ailleurs, ennemi de tout confort,
austère et circonspect comme il l'était, le Frère Augustin ne pouvait manquer
de se signaler par une administration d'une économie sourcilleuse. On le vit
bien, notamment, quand il apprit que le Frère Elie, directeur de la maison de
Lille, allait se lancer dans des agrandissements qui eussent fait rendre l'âme
à un trop modeste budget. Au plus aigre de l'hiver, il s'imposa quarante jours
de voyage inconfortable pour étudier les devis sur place et les réduire à une
mesure prudente. A l'inverse de son Maître, il ne se complaisait point en trop
de chantiers.
Cette qualité ne tuait
pas en lui l'initiative, mais la limitait strictement aux possibilités. Dès
1838, il avait soumis au P. Deshayes l'idée de créer un pensionnat. La
réputation de l'école primaire de Saint-Laurent, tenue par les Frères, celle-là
même qui remontait à Montfort et, interrompue par la Révolution, avait repris
son enseignement après 1806, s'était étendue dans toute la région. Sur la
sollicitation des parents et de membres du clergé, deux petits gars de Vendée
avaient été acceptés comme pensionnaires. Une dizaine d'enfants avaient suivi
et les demandes venaient de toutes parts. Il fallait, sans plus tarder, ou
renoncer ou établir un pensionnat dans les formes légales. Le P. Deshayes donna
son assentiment. En 1840, le pensionnat s'ouvrait régulièrement avec onze pensionnaires
et douze externes. Il comptait cinquante externes, plus des demi-pensionnaires,
en 1844 et, pour les abriter, il fallut, cette année-là, bâtir. Telle est l'origine
de ce pensionnat Saint-Gabriel qui compte aujourd'hui huit cent soixante élèves
pensionnaires. La gloire en remonte incontestablement au Frère Augustin... Dès
1842, il avait fait aussi bâtir, prolongeant en équerre la maison Supiot, une
chapelle. Tout cela portait la marque de la plus stricte simplicité : les archivoltes
et décorations diverses n'étaient pas le fait du Frère Augustin. Il ne mettait
un pied devant l'autre que si l'expérience l'avait convaincu qu'il le pouvait
faire sans danger. Prudence appréciable car le temps des audaces salutaires
n'était pas encore venu.
Jusqu'en 1852, il eut le
titre de directeur du pensionnat, dont le Frère Michel fut, en fait, le premier
et très remarquable organisateur. Le Frère Augustin était trop occupé par ailleurs
pour y porter une attention quotidienne. Quelles charges n'assumait-il pas ?
Comme tous les grands autoritaires, il n'avait confiance qu'en ce qu'il
décidait et exécutait lui-même. Aussi prenait-il sur lui, bien souvent, ce que
ses subordonnés eussent fort bien fait. C'était un tort dont il a fait l'aveu
dans ses Chroniques ; il le compensait par une activité, jamais ménagée et un
courage peu commun. Délesté de sa lubie bretonne et de son caractère
atrabilaire, ce chef eût été suivi jusqu'à sa mort.
Il lui eût cependant toujours
manqué une intelligence assez ouverte. Et aussi une culture plus étendue ; la
sienne était limitée au rudiment et il semble bien qu'il mît, à ne pas l'étendre,
quelque parti pris. Il n'aimait pas qu'autour de lui on ne s'y tînt pas.
L'esprit de pauvreté, où il voyait avec raison l'âme de la vie religieuse,
l'entraînait à se défier abusivement des richesses de l'intelligence, voire à
les proscrire. On l'a vu : qu'on achetât des livres qui ne fussent pas les
seuls manuels d'école indispensables et il se hérissait ; qu'on apprît des
langues étrangères et il criait à l'abomination. Cependant, le Frère Augustin
se manifesta, dans le domaine des connaissances primaires, un excellent
pédagogue. Il composa, en 1847, une « Méthode pour bien faire la classe », qui
est claire, pratique et riche d'expérience.
L'influence lassallienne
y est visible. Le Frère Augustin a peut-être lu la Conduite des Ecoles. En tout cas, de ce manuel pédagogique
magistral, les principes et les applications étaient connus dans le monde
scolaire et il ne les pouvait ignorer. Au reste, le P. Deshayes avait donné aux
Frères l'indication de se conformer de façon générale à la pédagogie des Frères
des Ecoles chrétiennes[50].
Comment ne pas s'y rallier dans l'ensemble ? Les principes et les règles s'en
ajustent à merveille aux données du bon sens et de l'expérience, à l'équilibre
éternel des choses de l'esprit. Un modèle de cette qualité s'impose d'âge en
âge à toutes les équipes enseignantes. Techniquement, l'enseignement primaire
laïque lui-même en dérive. Toutefois, le P. Deshayes entendait, non que l'on en
pratiquât une imitation servile, mais qu'on s'en inspirât de façon souple et
intelligente. « Par méthode, précisait-il, on doit entendre plus
particulièrement la simultanée plutôt que la lettre de cette méthode. » Voilà
le grand mot lâché : il s'agissait de suivre la méthode d'enseignement
simultané, dont Jean-Baptiste de la Salle fut le metteur en œuvre, et non celle
d'enseignement mutuel dont le P. Deshayes était l'adversaire notoirement irréductible.
« Vous tâcherez, ajoute-t-il simplement, de faire lire et écrire les enfants
comme eux (les Frères des Ecoles chrétiennes) ; tâchez donc de suivre encore
leur manière de faire le catéchisme et les autres exercices de la classe, en
employant autant que possible, leurs signes et les livres à leur usage. » La
remarque maîtresse est celle-ci : « L'expérience peut faire trouver des moyens
plus avantageux que ce qu'on a fait jusqu'à présent et si l'on se tenait
strictement à la lettre de la méthode, on ne pourrait pas toujours faire usage
de ces nouveaux moyens ; et comme la plupart de vos frères sont seuls dans les
établissements, les exercices sont plus multipliés dans la même classe et par
conséquent la méthode des Ecoles chrétiennes ne peut pas toujours avoir son
entière exécution chez vous. » La recommandation a été bien entendue : en fait,
les manuels à l'usage des pédagogues n'ont guère gouverné la pédagogie des
Frères de Saint-Gabriel. La Méthode du Frère Augustin, elle-même, si elle a pu
assurer les premiers pas d'un jeune Frère dans l'art d'enseigner, n'a jamais
fait figure de prototype. Une caractéristique frappante de Saint-Gabriel est,
en la matière, un empirisme à jet continu. Il reste que le Frère Augustin a été
par sa méthode, agie et parlée plus qu'écrite, un excellent formateur de
pédagogues.
Passer de la férule du
Frère Augustin au gouvernement du Frère Siméon fut incontestablement une détente.
Parmi les raisons de grand poids à l'élire supérieur général, celle-ci ne fut
pas la moindre. Tous les traits de la figure pleine et reposée du Frère Siméon
exprimaient cette affectueuse douceur, cette bonté, cet amour des solutions paisibles
et conciliantes qui allaient lénifier l'atmosphère de Saint-Gabriel et donner
aux âmes, lasses du rude biscuit marin dont les nourrissait le Breton Augustin,
un aliment plus délectable dont elles avaient grand faim. La vertu du Frère
Siméon, profonde, était aussi d'une exquise humanité. Sa charité, attentive
surtout au spirituel, ne négligeait pas pour autant le temporel. Qu'un
postulant, nostalgique et transi, se présentât, venant de quelque lointain
village, c'est par un bol de lait fumant qu'il commençait de le mettre à
l'aise. La cordialité d'un bon accueil et de paroles paternelles faisaient le
reste. Le Frère Siméon était d'une humilité parfaite, et, en ses quarante-six
ans, où il accéda au généralat, d'une piété de novice. Limpide et ingénue, sa
dévotion allait, avec un élan particulier qui porte bien la marque de Montfort,
à la Vierge Marie. Il pratiquait et propageait la formule montfortaine de
l'esclavage de Jésus par Marie. Il portait toujours ostensiblement son rosaire
et, qu'il allât d'un point de la maison à un autre, les salutations angéliques
pleuvaient de ses doigts. Saint Joseph et sainte Anne complétaient le cercle de
la sainte famille dans le chaleureux foyer de son cœur. Certains traits de sa
vie le signalent entré fort avant dans l'intimité de Dieu et de ses saints et
bénéficiant de faveurs insignes.
C'est dire que les dix ans
de son généralat ont été un bienfait pour la vie intérieure des Frères. Le délicat
problème de la vie religieuse attirait ses soins attentifs. Dans cet ordre, il
fut amené à prendre une initiative importante. A cette époque — 1854 — les
noviciats ne s'ouvraient pas seulement aux jeunes gens, mais aux jeunes
enfants, encore en âge de collège. Cela n'allait sans inconvénients ni pour
ceux-ci, ni pour ceux-là. Le Frère Siméon créa le juvénat, institution qui
reçut les plus jeunes, leur ménageant pendant quelques années un régime analogue
à celui d'un pensionnat d'enseignement libre de nos jours, mais dans une
atmosphère de piété plus poussée, qui favorisait, sans la forcer, l'éclosion
des vocations. Ainsi un double but était-il atteint : le noviciat prenait son
plein sens et sa pleine efficacité à s'adresser à ceux-là seuls qui, par leur
âge, en pouvaient comprendre le but et l'esprit ; d'autre part, les jeunes
enfants, en qui montait un appel précoce à la vie religieuse, au lieu d'être
prématurément engagés dans le noviciat, s'y préparaient par le juvénat.
Le Frère Siméon fortifia
et perfectionna l'édifice pédagogique encore sommaire. Les mesures qu'il prit
dans ce sens le montrent préoccupé, à l'inverse du Frère Augustin, d'étendre la
culture des instituteurs. Il créa une commission, composée des Frères les plus
instruits et expérimentés, qui, à l'époque des vacances, faisaient passer des
examens aux professeurs. Ces examens étaient suivis de conférences pédagogiques
journalières. La première année de noviciat comporta désormais des cours de
pédagogie appliquée. Le novice, muni du bagage théorique indispensable,
suivait, à l'école paroissiale de Saint-Laurent, la leçon du professeur
habituel, puis, prenant sa place, recevait le baptême du feu. On assure que, sous
les regards malins des confrères accourus et des élèves, cette expérience
pédagogique se transformait, pour le professeur apprenti, en un bain de
confusion et d'humiliation dont il se fût bien passé. Il en devait cependant
retirer quelque bien, même d'ordre professionnel. Le Frère Siméon eût en outre
voulu que nulle fondation ne fût acceptée, pendant deux ans, pour que les jeunes
Frères ne fussent pas prématurément enlevés à leur formation pédagogique. Les
besoins du dehors, trop abondants et pressants, ne le permirent pas. Quoi qu'il
en soit, opérants ou non, les efforts du Frère Siméon se multiplièrent en vue
d’une solide préparation professionnelle. L'orientation de son gouvernement fut
à cet égard assez nette pour provoquer certains Frères à composer des manuels
ou traités classiques, qui furent d'excellents instruments de travail.
Comme allait se tenir le
chapitre de 1862, pour le renouvellement de l'administration générale, le Frère
Siméon supplia qu'on ne le réélut point. Il aspirait à rentrer dans l'ombre ;
au surplus, il éprouvait que sa nature, peu faite pour le commandement,
n'arrivait pas à s'y contraindre suffisamment. En quoi il voyait juste et, sans
qu'il y eût péril en la demeure, il était bon qu'à son gouvernement maternel
succédât non quelque roide autorité, à la manière de son prédécesseur, mais un
gouvernement plus viril, mettons paternel. Un évêque exprimait cela en un
charmant euphémisme : « S'il était meilleur, le Frère Siméon serait trop bon. »
On aime un jugement si discrètement exprimé, tant on s'en voudrait, par une
critique trop péremptoire, de contrister, par delà le tombeau, un être aussi
délicieux. Comme assistant, comme directeur du pensionnat qui se développait,
le Frère Siméon allait, jusqu'au 23 février 1885, où il s'éteignit, prodiguer
aux siens le parfum de son âme évangélique. Les Frères virent souvent cet
ancien supérieur général s'adonner, avec une joie surnaturelle, aux plus
humbles travaux domestiques. S'il n'est permis qu'à l'Eglise de dire s'il fut
un saint, on peut du moins convenir qu'il y ressemblait singulièrement.
Le choix du chapitre de
1862 exprima le besoin général. Pendant vingt ans, les Frères de Saint-Gabriel
allaient avoir à leur tête un chef lucide et expérimenté, à la fois ferme et
bon, plein de dons, apte à agir avec bonheur sur les plans les plus divers. Sa
personnalité, forte et rayonnante, allait attirer sur l'Institut l'attention
des élites, ecclésiastiques et laïques, de la France entière et de Rome, et le
faire entrer en quelque sorte dans le circuit des grandes Congrégations. Né à
Mondragon (Vaucluse) le 23 décembre 1823, le Frère Eugène-Marie avait donc
trente-neuf ans. Il arrivait du noviciat que les Frères avaient aux Mées, dans
les Basses-Alpes, depuis 1835 et qu'il avait dirigé pendant dix ans avec
beaucoup d'autorité et de savoir-faire.
A peine désigné par le
Chapitre, il s'affirma : « Vous m'avez appelé, fit-il, me voici ! » Et cette
phrase figurera en tête de chacune de ses circulaires aux Frères. Nulle
jactance en cela, mais l'allègre volonté de répondre à l'honneur du choix par
la plénitude du don. Le zèle dévorant qu'il déploya aussitôt était nourri de
vertus et de qualités humaines peu communes. Intelligence vive, aux curiosités
multiples, étendue autant que pénétrante et assimilatrice, il s'était acharné,
dès sa jeunesse et dans sa première maturité, au travail intellectuel, allant
des sciences sacrées aux sciences profanes d'un même mouvement plein d'aisance.
Il y gagna des névralgies tenaces qui, toute sa vie, le reprenaient quand il se
mettait à l'étude, le quittant quand il vaquait aux devoirs de sa charge.
C'était bien ce que, jeune, il avait demandé à Dieu : « On veut que j'aie mon
diplôme ; que j'y réussisse, mon Dieu, si c'est votre gloire. Quant au mal de
tête, laissez-le-moi comme un rappel à l'ordre, un avertissement de toujours
mettre mon devoir d'état avant ma passion pour l'étude. » Cependant, jamais il ne
cessa d'enrichir des fruits de l'étude son action généralice. Il savait de quoi
composer son miel : il se nourrissait inlassablement des sciences religieuses
et sa Bible le suivait partout. Ainsi fut-il un homme de forte et substantielle
doctrine. Une formation intellectuelle de cette qualité n'eût pu que l'incliner
naturellement à prendre les jésuites pour conseils et pour modèles, si déjà
l'exemple de Montfort, dont les jésuites furent les amis si compréhensifs et si
sûrs, n'eût suffi à l'y entraîner. Nombre de ses initiatives majeures
procédèrent de cette inclination.
Tant de solidité
s'unissait chez lui au brillant d'une imagination ardente, à la chaleur du
cœur, au plus vif entrain de l'esprit, à un tempérament fougueux. Il est bon
que les grands groupements humains soient parfois traversés de la flamme
persuasive et sapide du midi et il était bien un Méridional, du pays de la
terre ocre, parfumée de lavande et consumée de soleil. Il en avait même
certains excès ; trop de prolixité dans le discours et dans l'écrit, ce qui ne
l'empêchait point d'ailleurs, excellent orateur, d'être plein d'idées heureuses
et de vérités profondes et, bon écrivain, d'être clair, instructif et
convaincant. C'est un entraîneur ; écoutez-le, recommandant à ses Frères l'abnégation
: « Au premier son du réveil, nous ne ferons qu'un bond pour dire à Dieu :
Seigneur, vous m'avez appelé, me voici! La nature criera : le temps est dur ;
il fait froid... Abnégation! et debout! Il pleut, il neige, l'oratoire est
gelé, la chapelle est une glacière, je suis encore fatigué, le sommeil
m'accable. — Debout ! Le royaume du ciel souffre violence. Renonce à ce repos
d'un instant pour en mériter un qui sera éternel. » Telle est sa manière de
sublimer le détail, tel est le ton.
Une éloquence si imagée
déplaisait fort au Frère Augustin. Il en faisait un commentaire chagrin : « Les
longs écrits sont rarement pleins de vérités, plus rarement encore nets
d'orgueil et annoncent dans leurs auteurs, plus d'imagination, plus d'esprit même
que de jugement. » Mais l'âme sans amertume du Frère Siméon, à écouter ou lire
le Frère Eugène-Marie, s'épanouissait comme un tournesol. Les Frères, dans leur
ensemble, en recevaient une ardeur redoublée. Quant à insinuer que le Frère
Eugène-Marie fût atteint d'orgueil, il y fallait beaucoup de fiel. Il était
conscient de sa valeur — « Dans le gouvernement de la Congrégation, avertissait-il,
je serai moi-même et non un autre » — mais, avec la plus franche humilité, il
rapportait tout à Dieu. Un jour qu'un membre de son conseil lui adressait une
admonition fort véhémente, lui reprochant de ne pas assez sanctionner les
fautes contre la règle, il écouta en silence. Son interlocuteur lui demandant
de ne pas prendre son avertissement en mauvaise part, il répondit : « Je serais
un bien pauvre homme, si je ne pouvais entendre la vérité. » Son zèle
intrépide, qui avait sa source dans un esprit profondément surnaturel, ne se
laissait arrêter par aucune considération humaine. Il pouvait dire en toute
vérité : « Je ne crains que le péché. » Comme tous les chefs d'action
entreprenants, voire audacieux, il connut pourtant, et parfois de bien pénible
façon, l'incompréhension des retardataires éternels et le mécontentement des
médiocres. Mais il surmontait toutes les oppositions sans blesser personne. Son
dévouement aux âmes procédait du pur amour, puisé dans cette dévotion au
Sacré-Cœur dont sa vie intérieure se nourrissait et qui, bien comprise, est la
nourriture des forts.
Comme si rien ne devait
manquer à cette réussite humaine qu'il était, une belle prestance physique le
servait. Grand et de solide carrure, il avait une noble physionomie, des yeux
au regard aigu et plein de feu, un vaste front, un nez aquilin, des traits
fermes mais sans dureté. A travers l'enveloppe charnelle, l'âme transparaissait.
Il voulait que chaque
Frère se dît : « Quelque soit le poste que je remplis, que je sois malade,
infirme ou plein de santé, dès que j'ai fait profession dans l'Institut, je
suis religieux et, à ce titre, obligé de travailler à mon salut et à ma
perfection. Quelques heures me suffisent pour remplir strictement le devoir de
l'instituteur ou du catéchiste ; mais, vingt-quatre heures par jour, je suis
religieux. » Celui qui écrivit cela savait le prix d'une formation religieuse
en profondeur; aussi bien, est-ce dans ce sens qu'il souhaita deux réformes
maîtresses, l'une et l'autre inspirées des Jésuites : les grands exercices
spirituels ou retraite de trente jours, que les Frères doivent pratiquer une
fois dans leur vie, et le second noviciat où les Frères, déjà engagés dans l'œuvre
scolaire depuis plusieurs années, se retrempent et se renouvellent dans les
pratiques de leur première jeunesse religieuse. Il ne put réaliser que la
première réforme. La seconde devait l'être par un de ses successeurs, le Frère
Sébastien.
Formation intellectuelle
ensuite. Sur ce point, il résista inébranlablement à ceux qui, dans l'Institut
même, ne voulaient, pour les Frères, que le maigre bagage d'instruction,
suffisant, selon eux, à la pédagogie primaire. Dans sa circulaire du 2 juillet
1864 sur l'étude, le Frère Eugène-Marie rassembla ses arguments en un solide
faisceau : « Un instituteur qui n'aime pas l'étude, s'il n'est pas digne
d'instruire la jeunesse, en est assurément bientôt incapable, car il en est de
la science comme de la vertu : celui qui n'avance pas, recule... Tout progresse
autour de vous ; seul, resterez-vous stationnaire ?... Etudier pour devenir
meilleur, pour être plus apte à travailler au salut du prochain et à la gloire
de Dieu, comme saint Ignace, cette science n'est plus la science qui enfle,
c'est la charité qui édifie et qui sauve... La Sainte Eglise inspirée d'en haut
dédaigne-t-elle la science ?... Quoique nous soyons les plus petits des enfants
de l'Eglise, les derniers en vertus et en science, ne craignons pas cependant
d'imiter notre Mère... Loin de nous emprisonner par la lettre, affranchissons-nous
donc par l'esprit. Il ne faut pas immobiliser les congrégations enseignantes,
mais entretenir en elles ce mouvement doux et fort qui vient du ciel. » Comme
le Frère Eugène-Marie écrivait ou parlait, il agissait. La grande réforme que,
sur ce plan, il prépara et réalisa, fut le passage du primaire au secondaire.
Il groupa à Lille de jeunes religieux, sous la direction de quelques jésuites,
qui, par des cours de mathématiques, de littérature et de philosophie les
formèrent à leur mission nouvelle. De ces cours sortirent les premiers cadres
professoraux de l'enseignement secondaire dans l'Institut. Ces étudiants
eux-mêmes devaient plus tard, dans les scolasticats réorganisés, former d'autres
professeurs. Ainsi, à l'école primaire qui était et resterait l'axe de
l'Institut enseignant, allaient s'adjoindre des collèges conduisant leurs
élèves au brevet supérieur et au baccalauréat. Le pensionnat Saint-Gabriel qui,
malgré son importance croissante, ne menait les élèves que jusqu'au brevet
simple, allait être le premier à bénéficier de l'orientation nouvelle. Dans le
programme devaient entrer les langues étrangères.
Telles furent les entreprises
capitales d'un gouvernement fécond. Ce qui se traduit malaisément en chiffres
ou en dates, c'est l'entrain que cet animateur communiquait à tous les échelons
de l'Institut, le halo de sympathique attention qui l'entourait, ainsi que son
œuvre, cette émulation dans les études et l'apostolat qu'il suscitait. Les postes
se multipliaient dans un nombre croissant de diocèses. Le nombre des Frères
avait passé de 534 à la fin du généralat du Frère Siméon, à 804, répartis en
134 écoles. Mais rien assurément, en ces résultats si remarquables, n'était
cher au Frère Eugène-Marie comme d'avoir centré la piété de ses Fils sur le
cœur divin de leur Maître. Les chapitres de 1867, 1872, 1877, 1882 le
réélurent, témoignage saisissant d'une unanime et reconnaissante confiance. Nul
doute qu'il eût été réélu encore, si la mort n'avait passé. Le 28 février 1883,
une rupture d'anévrisme emportait, en quelques minutes, ce chef magnifique. Il
n'avait que soixante ans, mais son œuvre était faite.
En vrai chef, le Frère
Eugène-Marie savait discerner les hommes de valeur et les placer aux postes
névralgiques. Avant d'être élevé au généralat, il avait remarqué, chez un
Frère, que son extrême modestie aurait fait facilement oublier, des qualités de
fond dont il faisait grand état. A peine élu, il avait nommé le Frère Hubert,
qui avait alors trente et un ans, maître des novices, fonctions que celui-ci
remplit supérieurement pendant treize années. En 1877, le Frère Hubert était
premier assistant. Le 30 mars 1883, le chapitre général le plaçait à la tête de
l'Institut. Il dit alors, s'adressant aux Frères : « Je vous porte dans mon
cœur et me sens disposé à me dévouer pour tous et pour chacun. Vos peines
seront mes peines, vos joies seront mes joies... C'est par votre droiture,
votre piété franche, votre modestie, votre régularité, en un mot par votre
esprit religieux que vous gagnerez de plus en plus mon estime et ma confiance.
» Ces quelques mots, simples et vrais, donnent la note de son généralat. Son
intelligence n'avait pas le brillant et l'envergure de celle du Frère
Eugène-Marie ; elle était cependant vive et pénétrante. Il savait faire preuve,
selon les cas, de doigté et d'énergie. Mais sa caractéristique était
précisément cet esprit religieux qu'il recommandait à ses Fils. Il appliqua à
l'exercice du gouvernement la pondération, le ferme bon sens, le jugement si
sûr qui avaient marqué sa première jeunesse d'une précoce maturité. Son
prédécesseur apportait à une action de conquête l'effervescence de son Midi
rayonnant. A maintenir, à perfectionner sans cesse, le Frère Hubert s'affirmait
le Vendéen-type qu'il était : calme, tenace, réfléchi, allant jusqu'au bout de
ce qu'il avait reconnu comme raisonnable et bienfaisant, de cette allure égale
et tranquille du paysan de son pays, au long des sillons.
Sur le double plan de la
formation religieuse et de la formation intellectuelle, il confirma et poursuivit
l'œuvre du Frère Eugène-Marie. Une de ses décisions, qui va plus loin qu'un
profane ne pense, fut de séparer nettement juvénat, noviciat et scolasticat,
chacune de ces institutions étant désormais dotée d'un habitat et de cadres propres.
Jusque-là, juvénistes, novices et scolastiques étaient plus ou moins confondus,
ayant mêmes professeurs et même local. L'ensemble des scolastiques fut groupé
dans la Mayenne, à Clavières.
Ainsi, de généralat en
généralat, s'intensifiait l'effort pour soustraire la période de formation,
dont tout l'avenir dépend, aux improvisations et confusions du dedans comme
aussi aux sollicitations prématurées du dehors. Le problème n'était pas
particulier aux Frères de Saint-Gabriel ; il se posait avec plus ou moins
d'acuité pour toutes les Congrégations, surtout enseignantes, après la
Révolution, et particulièrement dans la première moitié du XIXe siècle. Il
fallait se réorganiser, reconstituer des élites, des cadres, les former ; or, à
ce labeur vital, s'opposa l'appel du champ de bataille catholique, les besoins
des âmes sevrées de pasteurs, des familles privées d'écoles. A Saint-Gabriel,
comme ailleurs, il avait fallu, pendant de longues années, envoyer des Frères
dans les postes de campagne, après quelques mois seulement d'un noviciat qui
n'était qu'un juvénat prolongé. La réaction contre cet état de choses,
inaugurée méthodiquement par le Frère Eugène-Marie, fut facilitée au Frère
Hubert par un recrutement abondant. Il devait laisser à l'Institut, après son
généralat, 1.323 sujets, qui permettaient de fournir en professeurs 166 écoles.
Sur le plan
intellectuel, le Frère Hubert n'innova pas. Aussi bien, tous les jalons
essentiels avaient-ils été posés par son prédécesseur. Il s'appliqua avec
bonheur à généraliser et à centraliser les initiatives prises. Il décida que le
centre de direction des études serait la Maison-Mère. Des programmes
enregistrèrent et codifièrent les réformes pédagogiques éparses. Par là, il
apparaît que le Frère Hubert était bien l'homme qu'il fallait pour succéder au
Frère Eugène-Marie et donner à son œuvre la garantie de la durée. Après
l'entraîneur, le créateur abondant, devait venir l'administrateur ; à l'élan
ardent et touffu, devait succéder la coordination des mouvements, la régulation
du courant. Le grand mérite du Frère Hubert est d'avoir compris que là était sa
tâche et de s'y être tenu.
Un trait éclatant
traverse la grisaille discrète, où, pour le plus grand bien de l'Institut, il
s'est confiné.
En septembre 1888, le
Frère Hubert réalisait un rêve déjà ancien, par une fondation au Canada. Les
six Frères qui partirent, ce mois-là, pour les rives du Saint-Laurent, allaient
réussir et proliférer, au point de donner à l'Institut une magnifique province.
C'est une grande date dans l'histoire des Frères de Saint-Gabriel et c'en est
une autre, non moins éclatante, que celle du dixième chapitre général qui,
comme on le verra plus loin, prit officiellement position sur la question de
la, filiation montfortaine.
Le Frère Hubert n'en
continuait pas moins à penser, dans son humilité, qu'il était la cinquième roue
du carrosse. Quand, en 1893, il fut réélu, il soupira : « Jamais croix ne
m'avait tant coûté. » Il ne l'en porta pas moins vaillamment jusqu'en 1898, où
le douzième chapitre général consentit à le laisser rentrer dans l'ombre. Il
occupa ses cinq dernières années aux fonctions de maitre des novices. Et
c'était bien ainsi. Il avait passé sa vie à surnaturaliser toutes choses, en
lui et autour de lui, et rien ne l'attirait qui ne fût dans la lumière de Dieu.
Depuis les décrets de
1880, les signes avant-coureurs de la persécution religieuse se précipitaient.
Ils donnaient au Frère Hubert de lourds soucis. Mais il appartenait au Frère
Martial, élu supérieur général e 15 avril 1898, d'affronter le gros de l'orage
et d'en porter les crucifiantes conséquences. Nul choix ne pouvait être
meilleur. C'était un homme fort, aux robustes épaules, bien fait pour le
commandement. Comme il en était du Frère Eugène-Marie, son être physique
révélait une âme de chef. De haute taille et de noble attitude, il en imposait.
La bonté de son cœur, qui était grande, n'amollissait pas les fermes traits de
son visage ; transparaissant dans le regard, intelligent et direct, elle ne se
livrait pas à l'interlocuteur comme une concession mais comme un soutien. Né au
cœur de l'Auvergne, il tenait de son pays natal équilibre et solidité. Haussé
aux suprêmes responsabilités à une époque déchirée par la passion
antireligieuse, l'histoire de son généralat est l'histoire de son combat. La
lutte trouva un lutteur à sa taille.
Il avait déjà fait ses
preuves. Maître des novices pendant vingt ans, il s'était affirmé un formateur
de grande classe. Assistant du Frère Hubert depuis deux ans quand il accéda au
généralat, ce fut sur les conclusions de son enquête auprès des Congrégations
enseignantes que le Frère Hubert institua le scolasticat de Clavières. Il
apportait à tout une rare puissance de travail. Devenu supérieur général, il
sembla qu'il se surpassait. Dans les années troublées qui précédèrent le coup
de tonnerre de 1901, bien que son regard lucide discernât l'approche de
l'orage, il vaqua, avec un parfait sang-froid, aux affaires ordinaires de
l'Institut, stimulant les études, provoquant la rédaction et l'édition par
l'Institut de nouveaux livres scolaires, multipliant les fondations. Une
quinzaine d'établissements surgirent ainsi de 1898 à 1901. Face à la médiocrité
haineuse qui déjà poussait Combes aux avenues du pouvoir, il élargissait donc,
loin de le restreindre, le champ apostolique de ses Fils.
Au point de
développement où en était arrivé, en France, l'Institut, comment le Frère
Martial, si agissant, n'eût-il pas médité de lui faire franchir les frontières
? Il s'y trouva doublement engagé par la menace qui pesait sur lui.
L'éventualité n'était que trop à craindre de la fermeture des établissements
congréganistes; il fallait s'assurer des postes de repli qui fussent en même
temps des postes de conquêtes. On lui propose des écoles en Belgique, à Tournai
et à Thuin ; il accepte. Mais son regard va plus loin : c'est une
caractéristique de l'apôtre que la nostalgie des terres païennes où planter
l'étendard de la foi. C'est ainsi que d'autres postes sont fondés au Gabon —
Libreville et Lambaréné — sur la côte des Somalis, à Djibouti, enfin en
Abyssinie. Plus tard, cette fois sous le coup des lois de proscription, ce
seront le Siam, Madagascar, les Indes. Sous le gouvernement du Frère Martial,
l'Institut de Saint-Gabriel est entré dans la phase universelle de son
existence. Le temps n'était pourtant pas si lointain — quelque
quatre-vingt-cinq ans — où quatre Frères, l'un faisant l'école, les trois
autres s'affairant aux carrés de choux de l'enclos du Saint-Esprit, semblaient
attendre que s'épuisât à jamais, en leurs vieux membres, la sève des premiers
compagnons de Montfort. Epopée si rapidement conduite que, d'un bout à l'autre
de cette courbe apostolique, une seule vie d'homme pourrait tenir.
Nous voici donc arrivés
à cette période très amère où la France officielle et une large part de la
France administrée se refusaient, jusque sur le terrain légal, à reconnaître
tout ce que la grandeur historique du pays doit à la vitalité chrétienne et de
quel inestimable appoint étaient les Congrégations en général, et les
Congrégations enseignantes en particulier, pour la défense des fondements
intellectuels et moraux de la société française. La partie se jouait sur la
double équivoque de la laïcité et du cléricalisme. Ce qui, en réalité, se
trouvait en cause, c'était d'une part, non la laïcité — nul catholique sensé ne
songeait à attaquer le fait de l'Etat laïc — mais le laïcisme, laïcité
agressive et religion d'Etat, et non le cléricalisme — intrusion abusive du
spirituel dans le temporel et, comme tel, condamné par l'Eglise elle-même —
mais les forces religieuses. On ne voulait pas d'une libre et loyale
concurrence, qui eût pu susciter une saine émulation; on n'entendait pas se
borner à freiner telles ou telles manifestations isolées d'un cléricalisme
authentique ; on voulait supprimer les Congrégations enseignantes, c'est-à-dire
la source religieuse de l'enseignement. L'histoire « juridique » de l'affaire
congréganiste le prouve surabondamment. C'est en fait une série de dénis de
justice qui, au regard de l'histoire impartiale, apparaît comme une comédie à
ce point saturée de moliéresque amertume qu'on ne peut, Français, l'étudier de
près sans en ressentir un sentiment de gêne, de confusion, et, dans la bouche,
comme un goût de cendres.
A cette offensive, qui
usait de tous les moyens et des pires — accusations et procès d'immoralité, de
sévices, haros sur des thésaurisations clandestines, etc... — répondit une
dispersion dans les réactions, une confusion et une hésitation dans les
esprits, une absence de directives précises et surtout de direction commune
qui, sous cet angle, ne fait pas de cette période une belle page de l'Eglise de
France. Préparée et annoncée depuis 1899 par toute une jurisprudence sectaire,
la loi du 1er juillet 1901, sous couleur de liberté d'association, ligotait les
congrégations dans un règlement aux multiples lacets. Elle édictait, comme on
sait, qu'aucune congrégation ne pouvait se former ni exister licitement sans
une autorisation donnée par une loi qui devait déterminer les conditions de son
fonctionnement. Les congrégations, existant en fait au moment de la
promulgation de la loi, devaient demander l'autorisation dans un délai de trois
mois. Toute congrégation, qui n'aurait pas sollicité l'autorisation dans les
trois mois, devrait se disperser et il serait pourvu à la liquidation de ses
biens.
Fallait-il, ne
fallait-il pas solliciter l'autorisation ? Dès le début de 1901, où se
dessinait l'orientation de la future loi, le sentiment du Frère Martial n'était
pas douteux. Il avait pris le parti d'une tenace résistance passive. « Moins on
veut de nous, écrivait-il dans une circulaire aux Frères, plus nous nous imposerons...
Restons à notre poste, laissons-nous arrêter, dépouiller, maltraiter, mais ne
nous lassons pas dans la lutte. » Seulement, pour suivre une telle ligne de
conduite, il fallait qu'elle fût adoptée par les plus puissantes congrégations,
et il n'en fut rien ; au lieu de faire front commun, chacune s'appliqua à se
sauver elle-même, sans souci des voisines. Comme allait expirer le délai
indiqué par la loi pour le dépôt du dossier et la demande d'autorisation, le
Frère Martial tenta un suprême effort. Dans la dispersion générale, huit
congrégations, dont les Frères de Saint-Gabriel, s'étaient unies pour adopter
une formule commune.
Le Frère Martial
provoqua la réunion de leurs supérieurs majeurs qui se tint les 16 et 17
septembre 1901 ; il se fit personnellement accompagner de l'avocat de
Saint-Gabriel, M. de Lacoste, du barreau de Niort, pour plaider, avec plus
d'autorité juridique, le maintien du statu quo. Le Frère Martial souhaitait,
quant à son Institut, faire valoir les approbations légales antérieures —
celles de 1823 et 1853, toujours valables — pour n'avoir pas à produire de
nouvelles demandes d'autorisation et il espérait rallier à cette attitude les
sept autres Instituts. Petit nombre, mais suffisant pour étayer une résistance
à laquelle un Institut isolé ne pouvait prétendre. Le résultat, le Frère
Martial nous l'apprend en clair, dans sa circulaire du 25 janvier 1902 : « Un
concours de circonstances, qu'il est inutile de rappeler ou de qualifier,
amena, à tort ou à raison, au milieu de toutes les bonnes volontés unies, un
effondrement général et complet. La mort dans l'âme, les derniers, nous
faisions le dépôt de notre dossier, le 27 septembre[51].
»
Les événements devaient
montrer que le point de vue du Frère Martial était, non seulement le plus
courageux, mais le plus lucide. Dans la circulaire précitée, le Frère Martial
pouvait encore écrire : « Nos écoles fonctionnent comme par le passé... le nombre
des enfants qui les fréquentent n'est pas inférieur à celui des années
précédentes. En plusieurs endroits même, il y a plutôt augmentation. Les
populations chrétiennes se montrent partout très attachées aux Frères et sont
heureuses de leur témoigner, en toute occasion, leur sympathie et leur
dévouement. » C'était précisément ce qu'en haut lieu on ne voulait pas. Le 7
juin 1902, Combes accédait au pouvoir. Cet ancien séminariste, ce lettré qui
choisissait comme sujet de sa thèse de doctorat ès lettres la Psychologie de saint Thomas et la Querelle de saint Bernard et d’Abélard,
allait une fois de plus prouver qu'il n'y a pas plus acharné adversaire de
l'Eglise qu'un ancien homme d'Eglise. Le 27 juin 1902, un premier décret prononçait
la fermeture de cent vingt-cinq écoles où enseignaient les membres de
congrégations autorisées. En juillet, par une simple circulaire ministérielle,
Combes ordonnait, dans un délai de huit jours, la fermeture de deux mille cinq
cents écoles libres. Les recours formés contre le décret du 27 juin furent
rejetés. Diverses mesures vexatoires suivirent, auxquelles la loi du 24
décembre 1902 donnait, après coup, apparence de légalité. La loi du 17 juillet
1904 aggravait les dispositions antérieures. La comédie juridique continuait.
Il devenait évident que le couperet de cette guillotine sèche n'épargnerait
aucune congrégation enseignante. D'ailleurs, le 4 juillet 1902, Combes,
répondant à la Chambre à l'interpellation de Denys Cochin sur le décret du 27
juin, avait déclaré sans ambages : « C'est le premier acte et cet acte sera
prochainement suivi d'autres actes. »
Sur ces entrefaites, le
Frère Martial, par une circulaire du 21 janvier 1903, annonçait la convocation
du treizième chapitre général aux fins d'élections de la nouvelle administration
générale. Or, deux mois après, tombait, sur l'Institut de Saint-Gabriel, le
coup fatal. Le 18 mars 1903, en effet, la Chambre, par 300 voix contre 257,
refusait de discuter les articles du projet de loi relatif à la demande
d'autorisation, formée par vingt-cinq congrégations enseignantes, dont,
précisément, les Frères de l'Instruction chrétienne de Saint-Gabriel. Elle ne
se souciait même pas de faire précéder, d'un simulacre de jugement, ces
condamnations à mort.
C'est dans ces
conditions que devait s'ouvrir le chapitre général du 17 avril 1903. Le
douloureux dilemme était posé : ou refuser de s'incliner, ne céder qu'à la
force et, dispersés, tenter de se retrouver, ou se séculariser, c'est-à-dire
renoncer à la vie religieuse. Les malheureux religieux, visés par la loi,
attendaient des directives. Or Rome se taisait. Du côté de l'épiscopat,
flottement, dès que, des protestations solennelles et des condamnations de
principe, il fallait passer à des instructions pratiques. Enfin, une tendance
se dessina qui rallia, non l'unanimité, mais une grande partie de l'épiscopat :
pour sauver les œuvres ces écoles à quoi, justement, les évêques tenaient tant
— il fallait exiger des ouvriers le sacrifice de leur état religieux. Mgr
Catteau, évêque de Luçon, était, très nettement, de ceux qui pensaient de la
sorte. Il prêtait, comme ses collègues de même sentiment, une oreille favorable
aux propos des juristes, et ceux-ci militaient contre la résistance. Les
juristes, fournisseurs et commentateurs de textes, ne sont point faits pour
suggérer des solutions héroïques. Cependant, ils furent ceux qu'on écouta. M.
de Lacoste, l'avocat de Saint-Gabriel, qui opinait en 1901 pour que l'on ne fît
point de demandes d'autorisation, conseillait en 1903, qu'on s'inclinât, sans quoi,
disait-il, l'on perdrait tout. Mgr Catteau décida de présider lui-même le
chapitre général, et s'y rendit, accompagné de M. de Lacoste.
C'était trancher le
débat avant qu'il ne s'ouvrît. L'Institut des Frères de Saint-Gabriel était
alors une congrégation diocésaine et, comme telle, relevait directement des
évêques, partout où il était établi, non de Rome. Le chapitre général, bien
qu'animé, à la suite du Frère Martial, de l'esprit le plus généreusement
combatif, ne pouvait que s'incliner devant une directive aussi précise[52],
qui d'ailleurs fut formulée comme un ordre. Par ailleurs, M. de Lacoste, au nom
des paperasses, déclarait l'acceptation nécessaire. Comme autant d'épouvantails,
il agitait des textes.
L'évêque levait le
scrupule religieux ; l'avocat faisait entrevoir la vindicte de la loi. Un morne
découragement succéda à l'ardeur. C'est dans cette atmosphère pénible que la
sécularisation fut décidée en principe, les Frères restant libres d'opter,
individuellement. En cette année 1903, l'Institut comptait, avec les sujets
encore dans les maisons de formation, 1.500 Frères, répartis en 180 maisons. Le
nombre de leurs élèves s'élevait à 21.000. Ces chiffres mesurent l'ampleur du
sacrifice demandé.
Avec son habituel esprit
de résolution, le Frère Martial s'applique à le circonscrire. Déjà, il avait
ouvert à l'Institut des débouchés à l'étranger. Des Frères avaient été envoyés
par lui en Belgique, en Hollande, en Suisse, en Italie, en Espagne, en
Angleterre, pour repérer les bases de fondations possibles. Quand il fallut
obéir à l'ordre de dispersion, un grand nombre de Frères reconstituèrent en
chacun de ces pays des communautés. Leur histoire, que nous dirons plus loin,
fut brillante, n n'en alla pas de même des Frères demeurés dans le vieux pays.
Parmi ceux-là, les plus éloignés de la Maison-Mère écrivirent pour recevoir des
instructions. Il ne leur fut pas répondu. La poste était peu sûre, la
correspondance surveillée. Les magistrats, que manœuvrait la politique, eussent
facilement forgé, à l'aide de textes habilement « sollicités », des griefs de
sécularisation fictive ou autres. Au reste, les supérieurs eussent-ils osé
donner des instructions ? Ils craignaient bien trop qu'elles heurtassent le
clergé à tous les échelons. Combien de Frères ne quittèrent l'Institut que
faute de ces directives !... Ceux qui purent rejoindre le Frère Martial furent
reçus par lui, l'un après l'autre dans son cabinet. Devant lui, ils avaient
signé, et lui-même contresigné, une déclaration attestant qu'ils avaient cessé,
volontairement et de leur plein gré, de faire partie de la congrégation. Et
chacun de poser la question angoissée : « Mais enfin, est-ce pour de bon ? —
Non, répondait fermement le Frère Martial, c'est une fiction. »
Mais Mgr Catteau ne
l'entendait pas ainsi. Il avait relevé les Frères de leurs vœux ; il les
déclarait libres de tous engagements religieux, et ayant, en conscience, le
droit de vivre dans le monde comme s'ils ne l'eussent jamais quitté. Mgr
Rumeau, évêque d'Angers, convoquait tous les Frères sécularisés, à la trappe de
Bellefontaine, et leur déclarait que leur congrégation n'existait plus et
qu'ils n'avaient, en conséquence, d'autre supérieur que leur évêque. Dans les
divers postes de ville ou de campagne, où l'ordre de dispersion avait surpris les
Frères, le clergé leur distribuait des conseils contradictoires et généralement
mal inspirés. Engoncés dans leurs habits civils, qu'ils s'étaient procurés
hâtivement, qui étaient plus ou moins à leur taille, devenus gauches et
hésitants d'alertes et débrouillards qu'ils furent, doutant toujours, pour la
plupart, s'ils étaient ou non religieux encore, ils se trouvaient comme frappés
d'inhibition. Une peur obscure, mais toute-puissante, où entrait, plus encore
que la crainte du gendarme, celle de risquer l'existence de leurs écoles, les
saisissait pour la plupart, traqués comme ils l'étaient, toujours sous le coup
de perquisition ou d'arrestation, trouvant souvent à leur porte le gendarme
venu pour s'assurer s'ils étaient sérieusement sécularisés. Ils n'osaient
engager les moindres démarches, redoutant de compromettre leurs supérieurs et
leur Institut. Ainsi vit-on cette triste chose : à peine quelques rares Frères
présents aux obsèques du Rév. Frère Hubert, ancien supérieur général, en février
1904. Même cas à la retraite annuelle à Saint-Laurent. La grande majorité
n'avait osé venir, pour ne pas donner prétexte au délit redoutable et toujours
menaçant : reconstitution de congrégations non autorisées... Puis, la nécessité
de vivre pressant, chacun se mit en quête d'une situation, d'un métier. Les uns
y végétèrent, quelques-uns y réussirent et même trop ; ce n'est pas à la légère
que la vie de communauté est considérée comme l'axe de l'état religieux. Puis, la
plupart pensaient qu'ils étaient réellement relevés de leurs vœux, puisque
l'évêque les en assurait. Isolés, ils prenaient peu à peu le pli civil. Certains
se marièrent, souvent sur les conseils des curés qui voulaient avant tout
sauver les œuvres. Nombre de Frères cependant tinrent bon, continuèrent de se
considérer comme religieux et guettèrent patiemment l'occasion de se retrouver.
Une communauté échappa à
la débandade, celle qui formait les cadres du pensionnat de Saint-Laurent,
alors en pleine prospérité. En déclarant le pensionnat collège diocésain, en
nommant, comme supérieur, un prêtre séculier, l'abbé Limousin, Mgr Catteau
sauva l'établissement. Du même coup, il donnait au Révérend Frère Martial,
l'ordre de le quitter. Il y mit toutes les formes qui convenaient à l'égard
d'un religieux dont il estimait hautement la valeur et la vertu, mais, enfin,
il le donna. Le 20 juillet 1903, une magnifique cérémonie d'adieux, organisée à
l'occasion de la distribution des prix, entoura le Frère Martial d'un unanime
regret, qu'atténuait une espérance invincible. L'évêque était là, entouré des
sénateurs et députés de la Vendée, de magistrats, de nombreux prêtres et
notabilités, d'une foule d'anciens élèves et d'amis. Le 7 septembre, le
Révérend Frère Martial quittait la Maison-Mère[53].
Il établit sa résidence
et, bien entendu, celle de l'administration générale, en Belgique, à Péruwelz
jusqu'en juillet 1906, puis à Etterbeek. De là, il partait visiter les maisons
de l'Institut, tant au Canada qu'en Europe ; son inlassable activité le portait
partout ; il veillait, en chaque poste, à stimuler le progrès pédagogique et
l'approfondissement de la vie religieuse. Il voyait peu à peu la situation se
redresser en France, et une certaine lassitude, un certain dégoût aussi, et
comme une honte inavouée, succéder, jusque dans les sphères officielles, au
sectarisme ignominieux des années cruelles. Rome avait enfin donné ses
instructions; les Vœux des « sécularisés », présumés abolis, restaient valables
; le Pape encourageait à une reprise, discrète, prudente, mais persévérante, du
regroupement. Le Frère Martial se multiplia pour communiquer, en tous lieux où
ils étaient, ces consignes aux Frères ; les timorés retrouvaient courage, les
incertains lumière et fermeté, nombre d'amollis regagnèrent les voies de
l'ascétisme religieux. Et ce fut le commencement du renouveau. Comme des
difficultés d'interprétation subsistaient encore, du fait des solutions
diverses ou même contradictoires indiquées par les évêques, le Révérend Frère
Martial s'en fut à Rome et le Pape lui dit : « Si vous étiez approuvés par
Rome, tous ces obstacles seraient aplanis. » Ce trait de lumière indiquait la
voie à suivre. Le Révérend Frère Martial s'y engagea aussitôt. Les démarches
aboutirent le 4 février 1910 ; le décret de louange et l'approbation ad experimentum de l'Institut
Saint-Gabriel étaient publiés. L'approbation définitive devait suivre en 1916.
L'Institut allait retrouver du coup ses possibilités d'extension et l'aisance
de ses mouvements.
Le Révérend Frère
Martial était en Espagne, quand la guerre de 1914 éclata. Il était de ces
hommes pour qui le péril est un appel. Il se hâta de rentrer en Belgique. De
là, autant que le lui permettaient les entraves de l'occupation allemande, il
se préoccupa de maintenir le lien entre les membres dispersés de sa famille
religieuse. La paix revenue, il donna ses soins à la préparation du seizième
chapitre général. Réélu le 17 avril 1903, le 23 avril 1908, le 17 avril 1914,
le Révérend Frère Martial espérait bien ne plus l'être cette fois. Or il le
fut. Les Frères entendaient garder pour chef l'homme fort et le religieux
surnaturel qui avait supérieurement soutenu l'Institut dans les deux pires
tourmentes qui l'eussent jamais secoué. Le Révérend Frère Martial apprit avec
larmes son maintien au poste suprême. Mais, comme toujours, il fit face à la
tâche nouvelle avec son intrépide allant. Seulement son organisme était atteint
en ses profondeurs par tant d'alarmes et d'épreuves. Comme il entrait, le 26
mai 1922, dans la cabine du navire qui, de Liverpool, devait le conduire au
Canada, son cœur fléchit soudain. Il ne put que murmurer : « Je m'en vais » et
il s'en alla en effet, vers le Christ qu'il servit si noblement. Sa vie
intérieure avait toujours été pleine de lui. Soucieux d'entrer de plus en plus
profondément dans l'intimité divine, il allait souvent, de passage à Paris,
s'abreuver de lumières surnaturelles auprès de ce grand mystique de l'école du
P. Lallemand que fut le Père jésuite de Maumigny, cet ascète dont le seul
regard, dans la face décharnée, disait la présence de Dieu. Une référence de
cette qualité est à elle seule une indication maîtresse sur l'âme du Révérend
Frère Martial.
Après un tel généralat,
celui du Frère Sébastien peut sembler terne. Le nouveau supérieur général, élu
le 29 décembre 1922, n'eut pas en effet à exercer ses hautes fonctions en ces
circonstances dont l'éclat et le pathétique se reflètent sur les hommes.
L'époque tranquille de l'entre-deux-guerres ne nécessita pas l'exercice d'un
héroïsme extérieur. Elle ne connut pas, malgré une tentative que la réaction
catholique fit avorter, la persécution religieuse. Les religieux ayant prouvé,
une fois de plus, par le sacrifice de leur vie, ou leur bravoure sur le champ
de bataille, qu'ils s'égalaient aux meilleurs des Français, refusèrent de partir
et ne partirent pas. Les Frères de Saint-Gabriel qui avaient perdu vingt et un
des leurs et totalisé un nombre impressionnant de décorations, n'étaient pas à
l'arrière-garde. Les uns et les autres reprirent leurs postes d'enseignement.
La France officielle n'eut pas le courage d'abroger les lois iniques,
échelonnées de 1901 à 1904, mais elle les laissa à l'état de lettre morte.
Donc, aucune fièvre dans l'atmosphère. Par ailleurs, le Frère Sébastien n'avait
pas les qualités brillantes qui enchantent ou électrisent les hommes ; il était
tout en solidité, très intelligent, mais d'une intelligence horizontale, au
cheminement mesuré et méthodique. Dans le milieu où s'écoula son enfance, celui
de l'artisanat paysan, on le disait « bien malin », ce qui équivalait, dans le
langage populaire, à reconnaître une sagacité dont il témoigna en effet à un
rare degré. Son bon sens robuste et son jugement sûr, qualités si précieuses au
gouvernement religieux, et qui avaient certainement beaucoup contribué à
l'élever au généralat, s'exprimaient en formules d'une précision mathématique
et dépourvues de vains ornements. De fait, il avait le tour d'esprit
scientifique. Etant assistant général, il lui plaisait, en cours de voyage, de
lire, dans le train, un manuel de géométrie, comme d'autres, au rythme cahotant
des wagons, aiment à bercer leurs songes. On ne s'étonnera pas, après cela,
qu'il fut de pied en cap, physiquement et moralement, un homme grave. Il ne
plaisantait jamais, supportait qu'on se récréât mais n'y poussait pas. Dans ces
conditions, lui rendre visite, c'était sacrifier l'agréable à l'utile ; comme
son abord froid ne se dégelait guère et qu'il parlait peu, les indécis, les
hésitants, les timides restaient en transes. Mais ceux qui avaient le courage
de surmonter ces apparences et de s'ouvrir à lui, comme ils l'eussent fait du
plus chaleureux des conseillers, n'avaient pas à le regretter.
Il était en effet la
sagesse même et la vertu. Son intelligence comme son labeur l'avaient doté
d'une forte culture. Premier Frère de Saint-Gabriel à passer — et avec succès —
l'examen du baccalauréat spécial, il faisait partie du groupe qui s'y était
préparé sous la direction des jésuites de Lille. Professeur au pensionnat
Saint-Gabriel, il s'y affirma pédagogue excellent. Maître des novices, puis, en
1898, cinquième assistant, il continua, dans ces fonctions, à sa manière lente
et efficace, de s'assimiler et de repenser les matières et les affaires dont il
eut à traiter. En 1903, en même temps que la charge de protecteur, agréé par le
gouvernement, des Frères âgés qui restaient à la Maison-Mère, il avait assumé
celle d'économe général, singulièrement délicate et complexe en ces temps
troublés. Ce scientifique y excella si bien qu'il eût pu en remontrer à un
banquier. Des expériences, à ce point diverses et réussies, rendaient fructueux
les avis et les directives du supérieur général qu'il devint à soixante-deux
ans.
Sa vertu portait la
marque de son tempérament ; elle se signalait par une conscience exacte,
rigoureuse, sans fissure ni défaillance. On pouvait vraiment dire de lui qu'il
était la règle vivante. Au reste, sa froideur ne signifiait pas rigueur et si
sa réelle bonté ne s'épanchait guère, elle se manifestait cependant par une
indulgente compréhension à l'égard de la faiblesse humaine. Sa vie surnaturelle
avait des profondeurs que ne trahissaient pas ses circulaires, riches d'enseignement
spirituel mais dont la forme et le fond restaient livrés à l'inconsciente
tyrannie d'un esprit exagérément méthodique. Le secret de son âme apparaît
pourtant dans certaines notes et relations qu'il a laissées. Tel récit d'une
communication qu'il eut avec l'au-delà impressionne d'autant plus qu'il est
conté avec la froide précision d'un rapport administratif, et, par là, incline
à penser que le Frère Sébastien ne fut pas, ce jour-là, victime d'une illusion.
Malgré tout, tant d'objectivité scientifique, en matière si émouvante,
déconcerte ; le tempérament suffit-il à l'expliquer ? Il semble qu'il y ait là
aussi quelque défense contre soi-même. Il est difficile de rendre compte d'un
homme si fermé.
La principale création
du Frère Sébastien porte précisément au centre de la vie intérieure du religieux.
Il réalisa en effet le second noviciat, décidé en principe par le Frère
Eugène-Marie, ce temps de reprise de la ferveur originelle, des ardeurs sacrées
d'une vocation qui commence de s'accomplir. Le premier, Ignace de Loyola
l'avait conçu et appliqué dans sa plénitude par le Troisième an. Pour une moins
longue durée — trois mois, — le noviciat des Clématites à Boechout (Belgique)
rassembla, chaque année, une quinzaine de Frères, de trente à quarante ans, en
une nouvelle probation. Le Frère Sébastien assura à cette institution des
cadres parfaits et une atmosphère vraiment ascétique. Il n'est signe plus certain
de la vitalité d'un Institut religieux que cette volonté efficace de retour aux
origines. Si tant d'Ordres religieux ont eu besoin d'une réforme, s'ils étaient
comme vidés de leur sève, c'est que, cédant à la routine ou à la facilité, ils
s'étaient trop éloignés de la source première.
Les douloureux
événements de 1901-1904 n'avaient pu manquer de retentir sur les effectifs de
l'Institut — moins cependant qu'on n'aurait pu craindre. Devenu de droit
pontifical, il rayonnait sur plusieurs continents ; il avait acquis
définitivement ses titres de catholicité[54].
Depuis 1875, la question
de la filiation montfortaine avait continué à se développer, prenant d'année en
année plus d'ampleur et même un caractère inattendu. Et d'abord, contrairement
à ce qu'on eût pu penser, le Frère Eugène-Marie, supérieur général quand le Frère
Augustin mourut, n'intervint pas, du moins directement et solennellement, pour
en finir avec l'incertitude des esprits que le Frère Augustin avait divisés ou
influencés, et rétablir, une fois pour toutes, au profit de l'Institut, les
droits de l'histoire; sans doute pensa-t-il qu'ils s'affirmeraient à leur heure
sans qu'il fût besoin de les dresser précipitamment sur des cendres encore
chaudes. Il se borna à faire jour à la vérité, discrètement, mais nettement, en
tout lieu propice[55].
Le Frère Hubert, qui lui
succéda, était resté longtemps à l'établissement des sourds-muets de Nantes,
sous la direction du Frère Louis qui, je l'ai dit, était ardemment partisan de
la thèse du Frère Augustin. Bien que la personnalité du Frère Louis, puissante
et populaire, influençât fort ses collaborateurs immédiats, le Frère Hubert,
dès le début de son généralat, témoigna de la liberté et de la sûreté de son
jugement, en ce qui concernait la filiation montfortaine. Dans la circulaire
même où il annonçait aux Frères son élection, il parlait « du vénéré P.
Deshayes et de celui dont il était à la fois le fils et le successeur, le
vénérable Louis Grignion de Montfort ». Dans sa circulaire du 10 janvier 1887,
il appuyait plus fortement sur le fait historique, en rappelant les paroles du
P. Deshayes, « sixième successeur de Montfort » : « Je ne fais que réaliser le
projet du vénérable de Montfort qui, lui-même, de son vivant, avait fondé plusieurs
écoles pour les garçons. » Il préparait ainsi les voies à un projet mûrement
médité[56].
Quand, en effet,
s'ouvrit l'année 1888, celle de la béatification solennelle du Père de
Montfort, il adressa aux Frères une circulaire dont le texte était décisif :
Nous nous sommes
demandé, y disait-il, quel était notre devoir en cette circonstance solennelle.
L'exemple de deux communautés, nos sœurs, et, par-dessus tout, vos désirs, nous
déterminent à prendre part à cette manifestation catholique. Enfants du P. de Montfort,
nous avons encore un motif de plus d'entreprendre le voyage de Rome. Vous vous
unirez à nous pour remercier le Souverain Pontife de la couronne de sainteté
qu'il daigne déposer de la part de Dieu, sur le front de celui que nous nous
glorifions d'appeler notre Père. Il nous sera doux de penser que notre vénéré
P. Deshayes sera au milieu de nous pour acclamer le saint Apôtre. Nous ne
doutons pas qu'il lui demande de jeter un regard de complaisance sur ses trois
familles. »
Le 27 janvier de cette
même année, s'ouvrait à Rome le triduum des fêtes de la béatification. Une même
vague de ferveur, de vénération, d'amour y jeta les trois familles religieuses
de Montfort : les Pères de la Compagnie de Marie, les Filles de la Sagesse, les
Frères de Saint-Gabriel, ceux-ci conduits par le Frère Hubert.
A ces journées
inoubliables, le chapitre général, réuni le 10 juin 1888 à Saint-Laurent, sous
la présidence de Mgr Catteau, évêque de Luçon, donnait la consécration qui
convenait. Il vota, par 27 voix contre 2 (dont celle du Frère Louis) une
déclaration reconnaissant le bienheureux Grignion de Montfort comme « le
fondateur de la congrégation des Frères de Saint-Gabriel » et le P. Deshayes
comme « l'homme suscité par la divine Providence pour restaurer et développer l'œuvre
du bienheureux ». Du moins quant à l'Institut, le point final était mis à une
équivoque qui avait pour cause première l'ignorance; le mot de l'histoire était
proféré avec l'autorité qui convenait[57].
Nul n'en fut plus
satisfait que les Pères, dont le sentiment n'avait pas varié et dont la ligne
de conduite, fraternelle et d'une belle générosité spirituelle, ne s'était
jamais démentie depuis le transfert des Frères de classe à la maison Supiot. De
quoi ils allaient donner, en 1887 encore, un éclatant témoignage. Cette
année-là paraissait, sous la signature du P. Fonteneau, premier assistant
général de la Compagnie de Marie, une vie du Père de Montfort. Elle avait été
expressément demandée à l'auteur par le P. Guyot, le précédent supérieur
général de la Compagnie de Marie, décédé le 26 décembre 1886, et portait
l'imprimatur de son successeur, le P. Maurille. C'est dire qu'elle exprimait le
sentiment officiel et unanime des missionnaires à la veille de la
béatification. Or, elle affirmait et développait, conformément aux évidences de
l'histoire, le fait de l'origine montfortaine des Frères et, par le seul exposé
objectif des événements, faisait bonne justice de la thèse du Frère Augustin.
Ce que le P. Dalin, supérieur général des missionnaires, avait fait en 1839, le
P. Fonteneau le faisait de nouveau en 1887. On ne peut concevoir union plus
émouvante, ni volonté plus manifeste de saluer, dans le grand apôtre des pays
d'Ouest, le fondateur commun de trois grandes familles religieuses.
Et cependant, du jour au
lendemain, la situation changea. Depuis la fin de 1887, un travail souterrain
avait été fait, tant à Saint-Laurent qu'à Rome. Certains incidents, durant le
triduum, auraient pu le déceler, mais ils furent noyés dans la lumineuse splendeur
des fêtes et la réalité du coude à coude. C'était le fait d'un isolé, mais de
marque, puisqu'il s'agissait du supérieur général de la Compagnie de Marie, le
P. Maurille en personne. La révélation douloureuse en fut brusquement faite à
la fin de 1889, quand le P. Maurille eut fait publier par un des missionnaires
de son Institut, le P. Jouet, une brochure intitulée : Deux points d'histoire. L'auteur y soutenait, d'une part, que le P.
de Montfort avait fondé non pas deux mais une seule congrégation d'hommes,
composée de prêtres missionnaires et de Frères convers et d'autre part que le
P. Deshayes était l'unique fondateur des Frères de Saint-Gabriel. Dans le cours
de la même année, le P. Maurille décidait que les missionnaires toucheraient
désormais, pour leurs prédications à Saint-Gabriel, les honoraires en usage
dans les paroisses ou dans les Instituts étrangers. La cassure ne pouvait être
plus péremptoire.
Un fait symptomatique
éclaire, semble-t-il, la nouvelle attitude du P. Maurille. Il avait eu avec
l'évêque de Luçon, Mgr Catteau, d'épineuses conversations. Une question de
juridiction ecclésiastique sur les Filles de la Sagesse les séparait[58],
Mgr Catteau assurant que le supérieur général de la Compagnie de Marie usurpait
à cet égard certains pouvoirs qui, normalement, appartenaient et donc devaient
revenir à l'évêque. Toute occasion lui était bonne pour rappeler son argument
favori : Congrégation montfortaine, longtemps soumise à la juridiction du
supérieur des missionnaires, l'Institut de Saint-Gabriel y était aujourd'hui
soustrait ; donc, nulle difficulté à ce qu'il en fût de même des Filles de la
Sagesse. Le P. Maurille s'éleva là contre avec une vigueur fort explicable, cette
puissante congrégation représentant, pour les missionnaires, une force
d'appoint de premier ordre. Il est de fait que, dans le temps comme dans les
perspectives internes, l'affirmation des PP. Maurille et Jouet que l'Institut
de Saint-Gabriel n'est pas une congrégation montfortaine est rigoureusement
parallèle à l'affrontement de Mgr Catteau et du P. Maurille sur l'affaire de la
juridiction. L'historien qui, ici, n'a pas à s'occuper de la controverse, ne
peut que noter ces concordances et coïncidences, et passer. Son affaire est la
ligne simple de l'histoire qui a son point de départ dans le testament de
Montfort.
Il reste que depuis ce
temps, donc depuis un demi-siècle bientôt, une querelle aussi pénible que
vaine, brouillant les pistes, truquant les perspectives, tronquant les
documents, s'est développée avec une acuité croissante jusqu'aux environs de
1939[59].
Elle fut traversée, le 19 janvier 1910, d'un rayon d'apaisante lumière. Ce
jour-là, en effet, la Sacrée Congrégation des évêques et réguliers rendait le
décret annonçant à l'Institut de Saint-Gabriel que la louange et l'approbation
apostolique lui étaient concédées par le Souverain Pontife. Il y était dit
expressément que « les Frères de l'Instruction chrétienne de Saint-Gabriel,
autrefois dits du Saint-Esprit... ont pour Père et invoquent le bienheureux Louis
Grignion de Montfort ». Le décret parlait aussi de la « stabilité morale que
lui ont procurée environ deux siècles d'existence ».
Le primat de l'Esprit
enrichit par ailleurs le fait historique de justifications et de pertinences
souveraines. Nous avons vu comme, dans l'extrême obscurité de leur condition au
XIXe siècle, les Frères perpétuaient, dans leurs humbles travaux, la
Geste héroïque de leurs ancêtres spirituels, les compagnons du grand apôtre de
l'Ouest. Tout au long du XIXe siècle, et jusque de nos jours, leur
action apostolique par l'école, leur vie intérieure et leur comportement
quotidien, continuent d'être marqués d'une empreinte originale, qui est
précisément celle de Montfort.
TROISIEME PARTIE
L'ESPRIT DE SAINT-GABRIEL
I - LA REGLE
En fait de communautés
religieuses, qui dit règle, dit esprit. La règle, il ne la faut point entendre
au sens de la lettre qui tue, tandis que l'esprit vivifie ; elle concentre en
formules dont la sécheresse n'est qu'apparente, la pure essence de la vie d'un
Institut. En soustrayant l'esprit à la mobilité des esprits, elle le sauve.
Elle le garde des déviations, des interprétations fallacieuses, des revanches
subtiles de la facilité, des révoltes ou des bouderies de la chair, des erreurs
du jugement et des faiblesses du cœur. Elle fixe à chacun son rôle et son
devoir, elle règle minutieusement le rythme de son existence quotidienne, mais
pour garantir sa définitive libération. A la volonté qui a adhère une fois pour
toutes, et après mûre délibération, elle donne le moyen d'être fidèle à
elle-même. Aussi lien ce texte si froid, pour peu qu'on le presse, laisse
percevoir comme le départ d'une source jaillissante ou le joyeux tumulte d'un
envol.
Ici à quel texte faut-il
se référer ? La règle primitive, rédigée par Montfort, vraisemblablement en
1714, a disparu au début du généralat du P. Deshayes, détruite volontairement, selon
le Frère Siméon qui atteste avoir vu l'ancienne règle[60].
Depuis, comme on sait, sont venues les règles de 1830 et 1838. Cette dernière,
promulguée en 1841 et qui mettait un Frère à la tête de l'Institut, a été
plusieurs fois remaniée, complétée, refondue, pour aboutir aux constitutions définitives
de 1910, accordées aux nouveaux canons de l'Eglise. Légère brochure dont le
format ni couvre même pas le plat de la main, mais riche de substance.
Le but général des
Frères — glorifier Dieu en travaillant à leur sanctification — se confond avec celui
de tous les instituts religieux. Néanmoins, l’énumération des moyens comporte,
après la pratique fidèle des vœux et l'observance exacte des constitutions,
cette « vraie dévotion à la Sainte Vierge » chaîne d'or par laquelle les Frères
se raccordent au foyer brûlant de la spiritualité montfortaine, expression insigne
de leurs chères origines et de leur séculaire fidélité.
« Leur but particulier,
ajoutent les constitutions, est de se dévouer à l'éducation et à l'instruction
chrétiennes de la jeunesse, tout spécialement des enfants du peuple dans les
écoles primaires. Ils s'occupent aussi de l'éducation des sourde-mues et des
aveugles. » Il est à remarquer que nulle exclusion ne frappe l'enseignement
secondaire, voire supérieur, qui reste ouvert aux Frères comme une modalité précieuse
de leur apostolat pédagogique. Mais l'accent est vigoureusement mis sur l'école
populaire, sur l'école primaire. Les autres formes d'enseignement sont
susceptibles de multiplication et d'extension dans toute la mesure, mais dans
la mesure seulement, où non sera pas altéré, dans le principe et dans les
faits, la prépondérance donnée à l'enseignement primaire. L'éducation des sourds-muets
et aveugles, sauf exception individuelles, sauf aussi la part faite à l'éducation
artisanale, rentre dans le cadre de l'instruction primaire, dont elle est une
des formes les plus originales et les plus émouvantes...
Les Frères sont appelés «
de l'Instruction chrétienne le Saint-Gabriel ». Ils sont de fait, dans leur
masse, affectés à l'enseignement. La règle, qui le précise, établit cependant
des Frères voués aux travaux manuels, dits couramment « Frères d'emploi ». Des
uns aux autres, il n'y a nulle différence de hiérarchie, de préséance. Une même
règle les régit tous. Les mêmes exercices religieux les appellent aux mêmes
lieux, aux mêmes heures. Un même esprit les anime, une même fraternité les
unit. Cela est si vrai que les constitutions ne contiennent aucun chapitre
spécialement consacré aux « Frères d'emploi ». Ceux-ci ne se différencient des
Frères de classe que par leurs occupations. Y exceller, tant par la compétence
que par la conscience professionnelle, est, pour eux comme pour les autres, un
moyen d'atteindre à la perfection religieuse, ou de s'en rapprocher. Tout
travail, fût-ce le plus humble, le plus servile, est sublimé par sa destination
divine et son intention surnaturelle ; il se situe et rayonne dans la lumière de Dieu. Que ce soit
l'inaptitude à l'enseignement ou l'aptitude particulière à un emploi temporel
qui les ait fixés dans le labeur des mains, les Frères, que la décision des
supérieurs y confinés, composent à leur manière le miel de ruche commune.
Pour les uns comme pour
les autres, l'esprit des Frères doit être envers Dieu, un esprit de foi,
d'amour et de filiale confiance en sa divine providence. — Envers eux-mêmes un
esprit d'abnégation, de sacrifice et d'humilité. — Envers leurs supérieurs, un
esprit de filiale docilité et de respectueuse soumission. — Envers leurs
Frères, un esprit de simplicité, de paix et de charité, qui fera de la congrégation
une seule famille en Notre-Seigneur. — Envers les enfants et leur Institut, un
esprit de zèle et de dévouement surnaturels ».
Et voici reparaître, en
un article spécial, l'invocation majeure, le signe de ralliement : « L'Institut
a pour Mère et Patronne la Très Sainte Vierge Marie... Les Frères seront
heureux de se donner à Elle comme esclaves d'amour, par la parfaite
consécration enseignée par le bienheureux Louis-Marie Grignion de Montfort. »
Il va de soi, après cela, que les fêtes de la Vierge Marie qui s'espacent,
comme les grains d'un rosaire, tout au long de l'année liturgique sont, à
Saint-Gabriel, autant de fêtes de famille, surtout l'Annonciation, la fête
patronale de l'Institut, et l'Immaculée Conception. Il n'est véritable disciple
de Montfort, chevalier de la Mère de Dieu, qu'en cet esclavage mystique dont ce
saint disait qu'il est « un secret de sainteté ». Et quels sont les protecteurs
particuliers de l'Institut ? La famille de la Vierge — saint Joseph, sainte
Anne et saint Joachim — puis son grand paladin dans la croisade des missions,
Louis-Marie Grignion de Montfort, honoré à ce titre comme à celui de fondateur,
et encore saint Gabriel, ange du Message — « Je vous salue, Marie, plein de
grâce... ». Hors cette cohorte proprement mariale il n'est protecteurs
particuliers des Frères que leurs anges gardiens dont les hommes se soucient si
peu. Cette dernière dévotion est, dans l'Institut, d’une importance capitale. L'esprit
et la tradition débordent ici de beaucoup la lettre de la règle. L'ange
gardien, auxiliaire du Maître, protecteur de l’enfant, est fréquemment invoqué
comme tel. Le beau texte de l'Ecriture : « Il t'a envoyé ses anges pour qu’ils
te gardent en toutes tes voies », prend, à Saint Gabriel, une plénitude
insigne. Tout cela ne va pas à meubler les niches de statues, mais à introduire
la vie profonde des Frères dans certains grands courants surnaturels. A la fin
de ce premier chapitre des constitutions, où est condensée l'économie
spirituelle de l'Institut, un article spécial dégage les caractéristiques
idéales de la spiritualité gabriéliste : amour filial pour la Vierge Marie,
imitation des vertus de Montfort, en particulier de son zèle pour l'éducation
chrétienne des enfants.
La courbe de la vie
religieuse, dans l'Institut de Saint-Gabriel, est, à quelques détails près,
celle que l'on observe dans la plupart des congrégations sans cléricature :
Postulat de six mois, noviciat d'un an ou dix-huit mois, selon le jugement du
supérieur qualifié[61],
six années de vœux temporaires, puis profession perpétuelle, si l'épreuve est
convaincante.
Le gouvernement de
l'Institut, au poste suprême, est assumé par le Frère supérieur général et son
conseil, en temps ordinaire, et extraordinairement, par le chapitre général. Le
supérieur général, élu pour six ans, ne peut être immédiatement réélu que pour
une seule période de même durée. Son conseil se compose des assistants
généraux, au nombre de quatre, nommés pour six ans et indéfiniment rééligibles.
Un secrétaire général, un économe général, un procureur général près le
Saint-Siège composent, avec le supérieur général et son conseil,
l'administration générale.
Un trait marquant de la
forme du gouvernement chez les Frères de Saint-Gabriel est, à l'inverse de la
formule des jésuites où le pouvoir du général est quasi absolu, une
décentralisation très accusée. Et d'abord, le supérieur général et son conseil
forment un bloc, dont procède l'autorité suprême plutôt que du supérieur
général, pris individuellement. Les constitutions disent : « Le Frère supérieur
général doit gouverner et administrer scion les constitutions de l'Institut »
mais elles précisent ailleurs : « Le conseil général, et non le supérieur
général seul, est la première autorité ordinaire de l'Institut. » En toutes
affaires importantes, les assistants, réunis en conseil une fois par mois et
aussi souvent qu'il est nécessaire, ont voix délibératives et non pas
consultatives ; les décisions sont prises au scrutin secret et à la majorité
des voix.
Le supérieur général
n'en a pas moins autorité directe sur tous les Frères, et autorité indiscutée.
Mais elle est remarquablement dépourvue de ces formes strictement hiérarchiques
et administratives qui, ailleurs, l'expriment et la signifient. Le mode
affectueux domine chez le chef, la déférence familière chez les subordonnés ;
de ceux-ci à celui-là les contacts sont directs. Cela rend toute manifestation
sévère de l'autorité pratiquement inutile. Nul ne lésine sur l'obéissance, mais
celle-ci reste humaine.
Les supérieurs
provinciaux ont, à l'égard du conseil général, la plus grande latitude dans
l'administration de leurs provinces. Admission, formation et placement des
sujets, dans leurs provinces respectives, visite des maisons, maintien de la
discipline religieuse entrent dans leurs attributions et ils s'en acquittent
avec la plus grande liberté de mouvements. Ils doivent sans doute soumettre
leurs décisions au conseil général, en nombre de cas précisés par les
constitutions, et notamment en ce qui concerne l'admission aux vœux temporaires
ou perpétuels, mais il est exceptionnel qu'elles ne soient pas ratifiées. Si le
supérieur a le droit d'imposer un sujet et en use, en certains cas, d'ailleurs
très rares, c'est au provincial qu'il appartient de le nommer avec référence au
conseil général. Le supérieur provincial retrouve d'ailleurs, à l'intérieur du
conseil de la province, les limites à l'autorité personnelle que connaît, par
l'intervention de ses propres conseillers, le supérieur général. Le vote y joue
pour toutes résolutions importantes qui sont prises, ici comme là, à la
majorité des voix.
Cette répartition de
l'autorité sur plusieurs têtes n'en énerve pas le principe, en raison surtout
de l'efficacité d'un esprit de famille qui soude les uns aux autres, par le jeu
de l'amour fraternel, tous les Frères et se fait sentir à tous les échelons, du
supérieur général au plus humble des Frères d'emploi. Cet esprit existe
assurément, plus ou moins, dans toutes les familles religieuses, mais il est
poussé, dans l'Institut des Frères de Saint-Gabriel à un point qui leur confère
une féconde originalité. « L'esprit de l'Institut, disent les constitutions,
étant un esprit de paix et de charité, les Frères vivront ensemble dans l'union
la plus parfaite, s'aimant et s'aidant réciproquement ; ils écarteront avec
soin tout sujet de querelle, ne se témoigneront les uns aux autres ni
éloignement, ni mauvaise humeur... » Les circonstances m'ayant permis d'approcher
de très près et longuement les Frères de Saint-Gabriel, j'ai pu constater que
ce texte n'est pas lettre morte mais au contraire reste plutôt en deçà de la
réalité vivante. Il va de soi que, comme partout où les hommes subissent, d'un
bout à l'autre de leur vie, le contact continu de la vie communautaire, la
misère de la condition humaine s'exprime ici, parfois, par des accès de
mauvaise humeur, d'antipathie ou d'aigreur, mais cela est assez rare pour
détonner violemment sur l'ambiance. Ce qui est courant — j'allais dire banal, à
force d'être constant, — c'est, des uns aux autres, une amitié fraternelle,
chaudement cordiale, détendue, pleine de franchise et d'abandon, et d'un dévouement
réciproque que le détail fatigant d'une vie toujours pareille à elle-même n'use
pas, une atmosphère telle enfin que les familles naturelles les plus unies nous
en donnent le spectacle.
Encore que les affinités
intellectuelles et morales y jouent leur rôle, le principe en est surnaturel,
mais il n'en résulte aucune apparence de contrainte. Rien de plus agaçant pour
le prochain que, chez tels dévots, une vertu mal digérée; celle-là l'est bien.
A force d'avoir occupé les profondeurs de l'être, elle prend, dans les gestes
et les physionomies, le naturel de la vie. Etre aimé en Dieu et pour Dieu,
c'est chose admirable, et la plus désirable pour qui en est l'objet, mais
agréable seulement si l'on n'a pas l'impression que, n'était Dieu, vous seriez
envoyé à tous les diables. Or, un Frère qui rencontre un Frère, il semble que
toutes les joies de l'amitié entrent en effervescence et l'apparence est bien
conforme à la réalité. L'on pense à la belle remarque du Frère Eugène-Marie : «
La charité de Jésus-Christ nous presse les uns contre les autres et c'est là ce
qui fait notre force et notre vie. » Le supérieur lui-même n'est pas un être
lointain et l'appui que les Frères prennent sur lui est bien celui, plein de
confiance, du fils sur son père, un père qui est aussi un ami. Le respect joue,
assurément, mais du supérieur aux subordonnés, les distances ne sont pas celles
que j'ai pu observer ailleurs, et peut-être penserait-on, en d'autres
Instituts, qu'elles ne sont pas ici suffisantes. L'expérience d'une familiarité
de bon aloi — qui, même telle, comporte ses inconvénients — est poussée aussi
loin que possible mais avec un rare bonheur. On n'en peut discuter que
théoriquement le bien fondé. Dans la pratique, le résultat en est excellent.
C'est que cet esprit de
famille a ses sources en deux caractéristiques majeures de l'Institut qui sont
la simplicité et le dévouement total. Sur la simplicité, entendons-nous bien.
Aux yeux d'un vain peuple, il n'est être simple que tant soit peu godiche.
Signification dérivée que celle-là. Il faut ici se référer au dictionnaire «
Simple. Qui n'est pas composé. Qui n'est pas double ou multiple » et à la
surnaturalisation du Littré. Là-dessus, écoutons encore le troisième supérieur
général de l'Institut, le Frère Eugène-Marie. Dans une de ses circulaires, il
donne de la simplicité une claire définition : « Par simplicité, j'entends
l'opposé de la duplicité : ce qui est simple est un. Le Frère simple à mes yeux
n'est point un homme crédule et faible d'esprit : tant s'en faut ! C'est un
homme qui va droit à son but... C'est un homme dominé par une idée à la
réalisation de laquelle il subordonne tout ce qu'il est et tout ce qu'il a, et
au triomphe de laquelle il fait tout concourir. Cette unité de vues lui
communique une énergie qui surmonte tous les obstacles ; car plus il y a
d'unité dans une vie, plus il y a de force et de grandeur. » Il s'agit de cette
« belle simplicité surnaturelle qui consiste à ne voir, à n'estimer, à ne
sentir, à ne goûter, à ne vouloir que Dieu seul... Simplicité de notre esprit
qui est l'œil de notre âme et ne voit que Dieu ; simplicité de cœur, qui n'aime
que Dieu ; simplicité de volonté qui ne veut que Dieu ; simplicité d'action,
qui ne travaille, qui ne s'applique qu'aux œuvres de Dieu : c'est-à-dire à
celles-là seulement qu'il peut rapporter directement ou indirectement à la
gloire de Dieu ».
Ceci soit dit sans
préjudice d'une certaine simplicité d'ordre naturel, gagnée au contact constant
avec les enfants, dont les Frères partagent toute la vie. De cette unité
d'intentions, de vues, d'action, de cette volonté bien arrêtée de rejeter les
complications, conventions, superfétations dont on encombre indûment la voie
royale du royaume de Dieu, viennent précisément chez le Frère de Saint-Gabriel
cette charité fraternelle si loyale, si vraie et, dans son allure, ce regard
franc et direct, cette aisance et cette promptitude à rendre service qui
frappent aussitôt chez lui. Toutes choses étant une fois pour toutes mises sur
leur véritable plan, le reste va de soi. Et voilà qui est bien de Montfort.
S'il est saint qui ait jeté par-dessus bord toute la quincaillerie de l'esprit
du monde, pour ne garder que l'or pur de l'esprit de Dieu, c'est bien lui. S'il
a paru si extravagant, c'est surtout qu'il avait renoncé radicalement à toutes
les conventions qu'accumulent les hommes entre eux et qui les fait ne plus se
voir, se comprendre et s'aimer. Dieu seul, disait-il. Par là, il désignait à
ses Fils le droit chemin de la simplicité qui est celui de la grandeur.
Cette simplicité se
retrouve dans la piété des Frères. Outre la confession, hebdomadaire, et la
communion, aussi fréquente que possible, leur vie intérieure s'exprime en
exercice, quotidiens peu nombreux, sobres, sans complications : « Prières du
matin et du soir, disent les constitutions, méditation d'une demi-heure,
assistance à la sainte messe, examen particulier d'un quart d'heure, lecture
spirituelle d'une demi-heure, rosaire, adoration du Saint-Sacrement d'un quart
d'heure, prières de l'heure, étude de la religion durant un quart d'heure ainsi
que pendant les temps libres des dimanches et des fêtes. » Il est difficile
assurément de demander davantage à des existences dévorées par l'œuvre de
l'éducation de l'enfance. Mais la part relativement restreinte, donnée aux exercices
de piété, a une autre signification. C'est dans la ferveur qui y est apportée,
que le Frère doit s'assurer l'équivalent en enrichissement intérieur, d'une vie
orante et méditative plus poussée. Le milieu, qui est ici l'enfance, donne à
cette vie intérieure une allure de confiance et d'abandon, le caractère de
contacts familiers avec Dieu, ses saints, ses anges, plus que d'une contemplation
spéculative. La prière est pleine du souci des enfants et de leurs besoins
spirituels. L'âme est centrée sur le service du Christ dans la personne des
petits. D'où simplification extrême de la vie intérieure. En principe comme en
fait, la « petite voie » de sainte Thérèse de Lisieux lui convient à merveille.
Par ailleurs la vie entière du Frère étant engagée dans le service de Dieu, il
doit faire de l'action continue, du labeur de chaque jour, une prière. Tout est
ramené à l'unité de l'intention et du but. Quand il lui a été demandé comment
il fallait prier, le Christ ne nous a pas légué autre chose que le Pater, mais
c'est un monde. Le Frère se complaît dans les prières simples et essentielles
qui rendent le son de l'Evangile et il n'est rien dont il enchante et berce son
âme comme de la succession des Ave.
Tout se tient. Qui a
renoncé aux complications d'un amour-propre qui s'attarde à l'esprit du monde,
se donne d'un bloc aux âmes. Les Frères de Saint-Gabriel vont à la fine pointe
du dévouement. Le don de soi, pratiqué par Montfort jusqu'à l'usure extrême de
son corps, caractérise fortement leur Institut. Poussé à ce degré, il
représente une mortification intense et incessante. Aussi bien, la règle n'autorise-t-elle
pas les pénitences corporelles extraordinaires sans permission et celle-ci
n'est donnée qu'avec la plus grande circonspection. Dans le même esprit, la
règle, traitant de la réfection corporelle, prescrit que « la nourriture des
Frères sera commune et ordinaire, mais saine, suffisamment abondante et
convenablement apprêtée ». C'est que la vie d'enseignement est épuisante et il
importe de sauvegarder ce qui est le but même de l'Institut. Le Frère Eugène-Marie,
dans cette même circulaire où il interdit le jeûne aux Frères de classe,
rappelle que plusieurs Frères « n'écoutant que les inspirations d'un zèle plus
généreux que discret se sont mis déjà hors d'état de faire leur classe et le
noviciat est lui-même dans l'impossibilité de les remplacer ». La
recommandation, qui vaut pour toutes les congrégations enseignantes, est pour
celle-ci d'une particulière opportunité. Dans les pensionnats — secondaire
moderne ou primaire supérieur — des Frères de Saint-Gabriel, il n'y a pas de
surveillants. C'est le professeur lui-même qui ajoute aux fatigues de
l'enseignement cette lourde tâche de la surveillance qui, à toute heure de nuit
ou de jour, le tient auprès des enfants, dont il partage la vie. A quelque
poste qu'il occupe, de classe ou « d'emploi », le zèle du Frère de
Saint-Gabriel s'ingénie en mille petits services, menus affluents du grand
courant de la charité. Il est toujours là pour la bricole, le coup de main, le
remplacement, la besogne de surcroît. Ce bienfaisant réalisme dans la charité
est bien de Montfort ; le Frère Nicolas, tirant la langue de fatigue, il le
voulait charger sur son dos. Tel Frère que je connais, chargé de la cour des
petits, ne se contentait pas de surveiller leurs jeux ; il était attentif à
tout, comme le serait une mère, avec la même vigilance tendre. Une chaussure
qui se délaçait, risquant de provoquer une chute, une bosse, une égratignure, aussitôt
il accourait, pansant ceci, soignant cela, rajustant les lacets. Nul ne savait
comme lui dissiper un chagrin. Les supérieurs pensèrent qu'il serait un
infirmier idéal pour l'infirmerie des enfants et, depuis de longues années, il
s'y trouve en effet ; avec sa blouse blanche, son bon regard sous les sourcils
neigeux, entouré des petits convalescents, gentiment tyranniques, il semble une
grand-mère au milieu de ses enfants.
A l'éducation
chrétienne, le Frère de Saint-Gabriel doit tout sacrifier, voire, chaque fois
que de besoin, des études intellectuelles plus poussées. Le besoin des postes à
pourvoir prime tout. Inversement, il arrive qu'un Frère doive quitter
l'enseignement pour un autre emploi, si les supérieurs jugent que ce changement
est de l'intérêt de l'Institut. Lourd sacrifice pour lui, puisqu'il s'agit de
renoncer à la plus fervente aspiration de sa jeunesse religieuse. Comment il le
porte, en voici quelques exemples qui montrent bien ce qu'est le dévouement en
action et le zèle que propulse le seul amour de Dieu.
Le Frère Odéric, fils
d'un pauvre vigneron; professait depuis 1878 la petite classe à l'école du
bourg de la Poitevinière quand, en 1882, son état de fatigue le fit rappeler à
la Maison-Mère de Saint-Laurent. Remis, on en fit un linger. A vrai dire, son
bagage culturel était fort réduit et bien qu'il moulât d'une calligraphie
impeccable ses fautes d'orthographe, celles-ci n'en subsistaient pas moins. Il
reste que le passage sans transition d'une classe à la lingerie est bien fait
pour exercer les vertus d'obéissance et d'humilité, mais elles étaient
précisément les plus belles fleurs de cette âme simple. A remplir les rayons
d'un linge éclatant de blancheur, rangé en piles strictement quadrangulaires, à
assurer à des serviettes, transparentes à force d'usure, une survie
déconcertante, il apporta cette conscience professionnelle et silencieuse qui
était partout sa marque. En 1897, le voilà infirmier à Clavières, dans la
Mayenne, puis, après la dispersion de 1903, à Givisiez, Péruwelz, Boechout, en
Belgique.
Dans cette fonction, il
se révéla un de ces praticiens dont l'empirisme intelligent et dévoué sauve
souvent le malade du médecin. Des soins heureusement appliqués, il se haussa à
un excellent diagnostic. Ses heures libres, il les consacrait à un bricolage
intense dont les bénéficiaires étaient ses chers petits malades. Doué d'un
esprit d'économie que son amour de la pauvreté rendait doublement ingénieux et
efficace, il trouvait mille manières d'améliorer l'ordinaire, d'entretenir à
l'infirmerie un régime fortifiant. De son regard, intelligent et pénétrant, rayonnait
sa vie intérieure, candide et fraîche, comme une source. Plus que sur les
corps, il était penché sur les âmes des enfants qu'il soignait. Ce qu'ébauchait
en elles son exemple déjà si puissant, sa parole l'achevait. Il excellait à les
hausser vers celui qui les a tant aimés. Sa présence leur était un charisme. Il
est mort pour être accouru, mal remis d'une mauvaise grippe, et tout en
transpiration, au chevet d'un de ses petits malades. Une complication
pulmonaire l'emporta. A sa manière faite de silence et d'effacement, il avait
fait œuvre divine dans son emploi comme il le faisait dans sa classe, portant
la pratique des plus difficiles vertus, l'humilité et l'obéissance, au point de
perfection.
Le Frère Nicéphore, lui,
fut, au bout de quarante ans d'enseignement, en 1897, affecté au plus dur des
emplois : celui de quêteur. Ce méridional, originaire du Vaucluse, avait
pourtant apporté la plus belle flamme à un ordre de labeur qui ne semble guère
prédisposer au rôle de Frère mendiant. Très doué, avec des parties d'artiste,
cet instituteur excellent n'avait cessé de pousser, aux heures de loisir, sa
culture intellectuelle, de développer ses dispositions remarquables pour la
musique et le chant. Mais il s'était avisé qu'il fallait soutenir son Institut,
trop souvent à court d'argent, par les moyens qui réussissaient si bien à
d'autres. Il laissait entendre, avec un désintéressement magnifique, qu'il
accepterait volontiers de se livrer aux collectes nécessaires. Un jour, ses
supérieurs le prirent au mot et le voilà, désormais délesté de l'enseignement,
parcourant Languedoc et Provence, vignobles opulents et sèches terres
parfumées, bien accueilli ici, froidement là, rebuté souvent, mais au total
réussissant si bien que l'Institut allait pouvoir, grâce à lui, dans les temps
calamiteux de la persécution, soutenir ses maisons de formation et ses
vieillards. Parfois traqué par la police, prestement expédié par tel évêque
hors de son diocèse, accueilli avec mauvaise humeur par certains curés, il eut
même la déception d'être fort mal reçu par le patriarche des poètes de langue
d'oc, Frédéric Mistral en personne, dont, ce jour-là, la gentille Mireille
n'avait point sans doute hanté les songes : « Ce n'est pas moi qui vous ferai
des largesses, dit sèchement Mistral, elles seraient mieux méritées par ces
ouvriers mineurs que vous voyez là-bas et qui souffrent de si grandes fatigues.
» Et le Frère de répondre : « Vous n'en trouveriez pas un parmi ces ouvriers,
monsieur, qui consentirait à changer sa corvée pour la mienne. » De tels rebuts
froissaient douloureusement sa vive sensibilité, son cœur délicat. Ils lui
furent, surtout dans les premières années, une lancinante souffrance morale que
sa vertu transforma peu à peu en surnaturelle joie. En 1907, une attaque de
paralysie le frappait en pleine rue. En avril 1908, à peu près sur pied, il
reprenait son errance vaillante. Huit ans encore, il allait en être ainsi, son
corps se refusant de plus en plus, son âme le remettant sans cesse debout,
jusqu'au jour — il avait alors soixante-quinze ans — où le soleil, le
surprenant en train de gravir une côte escarpée, à l'heure caniculaire, où ne
s'agitent que les cigales, le frappa d'une définitive attaque. Humble disciple
de Montfort, il avait, pendant vingt ans, pèlerine et mendié sur les routes,
portant la Vierge Marie en son cœur qui lui était très dévot. Il mourut le jour
de la Vierge, un samedi.
Le Frère Constantin, lui
aussi, après avoir été, pendant dix ans, professeur au pensionnat de Saint-Gabriel,
puis, pendant six ans, directeur de l'école de Pouzauges, qu'il quitta pour
prendre la direction de celle de Châtillon-sur-Sèvre, directeur enfin de
l'école Gellusseau à Cholet, s'improvisa recruteur et quêteur, au lendemain de
la guerre de 1914-1918. C'était une personnalité puissante, truculente,
tumultueuse, un chef-né qui partout s'imposait, un entraîneur qui avait les
moyens physiques de ses qualités : une constitution robuste et une voix à
couvrir les trompettes du jugement dernier. Partout où il s'engageait, il passait
tout entier et ce n'était jamais sans déterminer de vastes remous, parfois des
contre-courants, mais des quelques oppositions qu'il rencontrait, il avait vite
raison, par sa belle franchise, la droiture de sa nature et sa cordiale
rondeur. Extrêmement populaire, il laissait, en tout lieu qu'il quittait, comme
une partie de lui-même, de nombreuses et inébranlables fidélités. On était pris
par quelque chose de plus fort que son don de sympathie et qui était un
dévouement sans mesure.
C'est ce dévouement
précisément qui le jeta à une tâche nouvelle et apparemment ingrate. La guerre
avait terriblement clairsemé les rangs des Frères de Saint-Gabriel et son cœur
si gabriéliste frémissait devant ces vides. Avec un tempérament comme le sien,
de telles visions se traduisent immédiatement en action. Il n'attendit pas une
obédience : il la provoqua, et bientôt fut sur les routes. Il alla de village
en village, enthousiaste, péremptoire, convaincant. Partout il agitait les
belles images de l'apostolat par l'école. Les résultats furent étonnants : les
recrues levaient, nombreuses, sous ses pas. Lui, ne les trouvant jamais assez
abondantes, lâcha la bicyclette dont il usait pour la moto. L'auto vint
ensuite, mais sa fougue native ne maîtrisant pas suffisamment sans doute ses réflexes,
le Frère Constantin connut des accidents mémorables. On lui donna un chauffeur.
Du coup, cinq départements virent passer et repasser ce virtuose de l'apostolat
pédagogique. C'est chemin faisant que le Frère Constantin s'avisa de faire coup
double : le recruteur se doubla du quêteur, et celui-ci valait celui-là. Le
supérieur général était déjà heureux ; l'économe le fut à son tour. Le Frère
Constantin usait des moyens classiques de la quête à domicile sur bonnes
adresses, mais surtout des autres, ceux que lui suggéraient une ingéniosité peu
commune et dont l'étourdissante énumération serait trop longue ici.
On ne se donne pas avec
cette généreuse plénitude sans que le corps humain fasse sentir la précarité de
sa condition. Traversé de rhumatismes, le Frère Constantin, en 1938, dut
connaître le repos, lui qui n'avait jamais souhaité que celui de l'éternité. Sa
volonté mata ses nerfs et leur souffrance. Il ne pouvait plus allier aux
autres, mais les autres allaient à lui. Ce vieux religieux de soixante et onze
ans dont les membres étaient noués, comme un vieux cep, par les rhumatismes déformants,
prodiguait à tous une jeunesse impérissable, un imbattable optimisme, un
entrain vainqueur. Il contait les belles histoires de la Vendée militaire,
qu'il connaissait comme personne, écrivait des souvenirs, émouvants d'accent
apostolique, mais dont la verdeur de ton ne fait pas une lecture pour les
vieilles filles. La Maison-Mère de son cher Institut et ce pensionnat qu'il
aimait tant, il les couvait du haut de sa fenêtre, d'un ardent regard. Jusqu'au
jour de sa mort qu'annonça, en mai 1943, une crise d'urémie, il garda sa
prodigieuse vitalité. Quelques minutes avant de mourir, il parlait de se
rendre, vaille que vaille, aux vêpres. Une défaillance soudaine jeta ce grand
vivant selon le cœur de Dieu dans l'éternelle vie.
Le cas du Frère Constantin
souligne une particularité remarquable de l'Institut, c'est que des personnalités
de cette originalité et de cette trempe, qui feraient craquer d'autres cadres
religieux, s'y déploient à l'aise et rentrent dans le courant normal sans le
faire déborder. Et ce n'est pas un cas exceptionnel ; ce l'est d'autant moins
que l'esprit même de l'Institut dilate, au lieu de les étouffer, les ressources
du tempérament en ce qu'il a de plus personnel. Je sais un Frère, directeur
d'un important pensionnat de bretonnante Bretagne, qui, pendant l'occupation
allemande, et de ce fait, fut la providence humaine d'un département et même,
je crois bien, des départements voisins. Homme d'action dévorante et qui ne
tient pas en place, d'un cran et d'un aplomb imperturbable, poussant au génie
l'application du système D, se faisant de l'obstacle un auxiliaire,
remarquablement équipé pour les temps difficiles et les solutions héroïques,
que de gens et de collectivités locales n'a-t-il pas tirés d'affaire! Préfecture,
évêché, administrations diverses se disputaient le Frère D... Il faut un quinze
tonnes pour Paris ? Le voilà. Ici et là le pain manque ? Qu'à cela ne tienne!
et bientôt les miches dorées de pleuvoir. Quant aux jeunes gens que le Frère a
sauvés de l'oiseau de proie germanique, ils sont légion. Tout cela à la barbe
des Allemands qui, faute de comprendre, ahuris devant ce tourbillon fait homme
et religieux, entrent dans l'aura d'admiration qui l'environne. La Gestapo s'en
mêla bien mais en fut pour ses frais. De tels cas, pour être liés à un
tempérament et à des circonstances exceptionnels, n'en sont pas moins
significatifs.
Tout cela est caractéristique
aussi de l'esprit missionnaire, de même que l'affectation des Frères et leur
manière de faire l'école. Us sont toujours prêts à se rendre en tout poste où
ils pourraient servir utilement la cause de l'éducation chrétienne de» enfants,
si humble et abandonné que soit ce poste et qu'il se trouve à la ville ou à la
campagne[62].
Il est de l'esprit comme de la tradition gabriélistes de prendre, s'il le faut,
ce dont les autres ne veulent pas. Nouveau témoignage de cette simplicité qui
est l'âme de l'Institut... Par ailleurs, les supérieurs majeurs n'ont jamais
hésité, durant de longues années, à pourvoir tels postes qui ne comportaient
qu'un seul titulaire. Les inconvénients de l'isolement, de la privation de
toute vie de communauté ne leur ont pas paru balancer le bien à faire.
Aujourd'hui, il est peu de Frères isolés. Au temps où ce cas était fréquent, il
est admirable de constater comme ils ont su, tout comme un Frère Nicéphore
pérégrinant seul pendant vingt ans, sauver dans l'ensemble leur vocation, mieux
que cela : en sublimer l'accomplissement par l'acceptation généreuse de la
solitude.
Le Frère directeur campe
avec ses adjoints dans la paroisse, surtout rurale, dont son école est une des
articulations maîtresses, à la façon de Grignion de Montfort quand il
missionnait sur place, pendant un mois, souvent deux. Il ne prend plus ses
repas, comme autrefois, à la table du curé ; lui et les Frères adjoints sont «
à leur ménage ». Ils forment une petite communauté authentique, avec son
règlement, adapté au lieu et fixé par le Frère Provincial. Ils n'en prennent
pas moins conscience active de ce que leur école est une école paroissiale ;
leur collaboration avec le curé est assidue. Le Frère Eugène-Marie, dans une de
ses circulaires, les avertit qu'ils doivent en être les humbles auxiliaires. «
Ce n'est pas notre œuvre que nous faisons, précise-t-il, mais l'œuvre de ceux
qui daignent nous appeler. » C'est bien là l'esprit de la mission, telle que la
pratiquait Montfort. Les constitutions sont d'ailleurs formelles sur ce point :
« Les Frères auront beaucoup d'égards... en particulier pour M. le curé de la
paroisse ; convaincus que, de l'union avec leur pasteur, dépend le bien qu'ils
sont appelés à faire, ils entreront dans ses vues en tout ce qui sera conforme
à l'esprit des constitutions. »
L'action paroissiale des
Frères est considérable par le seul fait qu'ils ont en charge l'instruction et,
dans une large mesure, l'éducation générale des enfants. Elle va souvent au
delà. Le Frère Nectaire — Auvergnat de vieille souche paysanne et chrétienne —
exerça une profonde influence dans la commune de Tauves, en Auvergne, et la région
avoisinante. En 1871, il était envoyé à l'école de ce bourg, où il professa la
petite classe, puis la seconde, puis la troisième, jusqu'en 1883 où il en
devint directeur, pour le rester jusqu'à sa mort, survenue en 1935. Educateur
parfait, joignant la bonté à la fermeté, plein de bon sens et de sûr jugement,
mûrissant doucement au bon soleil de l'expérience ces solides qualités et bien
d'autres, il ne se contentait pas de mener à merveille les 250 élèves de cette
école, dont plusieurs furent conduits par lui à la vocation gabriéliste ; il
conseillait et guidait les familles qui, de plus en plus nombreuses, recouraient
à lui. En 1904, sur les instances du maire et des conseillers municipaux, il accepta
d'ajouter à ses fonctions celles de secrétaire de mairie. Il s'en acquitta,
notamment pendant la guerre de 1914-1918, avec tant de sagesse, de sens administratif
et de dévouement, qu'il fit autour de lui, à dix lieues à la ronde, l'unanimité
de la reconnaissance et de la vénération. La sécularisation le surprit en 1904,
en sorte que sa photographie nous lègue le souvenir d'un bon vieillard à
redingote et bonnet noir, pareil, entre ses favoris, à quelque tabellion débonnaire.
Mais il n'était sécularisé que d'habit. M. Annet Ducros restait le Frère
Nectaire, le religieux humble et de grande vie intérieure, uni de toute son âme
à sa chère congrégation. S'il laissait si libéralement venir à lui les
visiteurs, c'était pour faire quelque bien à leurs âmes et la question religieuse,
surtout auprès de» malades, venait vite en son propos. Son humilité s'inquiéta
de la rosette d'officier d'académie qui lui fut conférée en 1924 et nul doute
que sa confusion eût tourné à l'abattement, s'il avait pu prévoir les obsèques
qui lui seraient faites. La montagne environnante se vida ce jour-là de sa
population. Six cents hommes suivirent son cercueil.
Nombreux sont les Frères
de cette génération — tel un Frère Traséas, directeur de l'école de Machecoul[63]
— qui, loin de se confiner dans leur école, ont fait rayonner leur apostolat,
discret mais fervent, sur la paroisse et la commune au point que celle-ci ni
celle-là ne se concevaient sans eux. Lee mœurs du temps de leur jeunesse,
heureusement attardées en des pays comme la Vendée ou l'Auvergne, leur
permirent certains moyens d'influence qui ne s'accordent plus avec une
mentalité fortement évoluée. Mais d'autres moyens s'offrent au jeune Frère
d'aujourd'hui. Sans doute, l'accroissement de la population scolaire, les
programmes plus chargés qu'autrefois lui prennent toute sa journée. Mais, dans
le seul cadre de la vie scolaire qu'il ne doit pas déborder, quelles
magnifiques possibilités d'action sur le pays immédiat ! Et d'abord il garde le
contact avec ceux qui, formés par lui quand ils étaient enfants, restent ses
amis en devenant jeunes gens, hommes faits, chefs de famille. Les grandes
organisations catholiques d'enfants — Cœurs vaillants et Croisés eucharistiques
— ont leurs membres sur les bancs de son école et, par là, sur le seul plan
scolaire, il participe aux œuvres paroissiales ; il peut agir en profondeur par
son conseil sur les parents des enfants ; enfin, depuis quelques années, il
professe des cours du soir d'ailleurs pratiqués depuis longtemps dans les écoles
gabriélistes, où il dispense un enseignement artisanal, agricole, régional,
adapté aux temps actuels, d'ordre à la fois théorique et pratique, et ces cours
rassemblent, en des bourgs, pourtant de médiocre importance, jusqu'à
quatre-vingts et cent auditeurs.
Cet apostolat du Frère,
au delà de l'instruction proprement dite des enfants, est plus ou moins
rayonnant suivant le degré de collaboration que le curé, seul maître en la
matière, juge bon d'accepter de lui. Les cas sont divers. Le passage tumultueux
du Frère Constantin dans la paroisse de Pouzauges, quand il vint prendre la
direction de la nouvelle école, suffoqua de prime abord le curé-doyen. La
personnalité du Frère Constantin était un aimant magnétique ; il n'en abusa
pas, mais ses méthodes, d'une vive originalité, ne s'accordaient pas toujours
avec celles du curé, surtout quand celui-ci s'appela l'abbé Bureau (dont la
mémoire est restée en vénération dans le clergé vendéen). Il y eut entre eux
telle entrevue où la voix fracassante du Frère Constantin suivit un
impressionnant crescendo. Mais c'étaient, de part et d'autre, de grands cœurs
qui se retrouvaient dans l'amour des âmes et le culte de la justice. S'étant
une bonne fois « reconnus », leur collaboration devint parfaite... Ailleurs, le
curé n'entend pas partager la moindre parcelle de son autorité et de son
influence et il appartient alors au Frère de se souvenir des sages recommandations
de ses constitutions. Dans de nombreux cas, par contre, le curé fait le plus
cordial appel à la collaboration du Frère qui dirige son école, quand il a
distingué en lui les qualités et les vertus qui la peuvent rendre féconde.
Ainsi faisait le doyen de Saint-Jean-de-Monts, le chanoine Pignon, à l'égard du
Frère Marie de Montfort, religieux d'éminente vertu et d'un admirable esprit de
pauvreté. Il l'utilisait largement, le pressant de donner des conférences aux
jeunes gens de son patronage, d'organiser des séances récréatives, de tenir les
grandes orgues à l'église, de former la clique. Loin de prendre ombrage de son
influence personnelle, si bienfaisante, il s'en réjouissait. Quand le Frère
Marie de Montfort mourut, en 1934, après avoir, pendant vingt ans, semé à
pleines mains son dévouement, le doyen éleva sur sa tombe une louange mémorable
: « Notre cercle, dit-il notamment, absorbait... une grande partie de son activité
et combien heureux et fier il était de le voir fréquenté par un nombre toujours
croissant d'hommes et de jeunes gens ! Pour tous, il fut l'ami fidèle et le
conseiller prudent. Toujours il s'est fait l'auxiliaire précieux du clergé...
Il ne comptait jamais avec le temps et la peine, et il n'avait pas de passion
plus grande que celle de se donner et de se sacrifier. »
L'idéal gabriéliste est
inscrit en lettres d'or dans cette dernière phrase. Elle vaut pour le supérieur
comme pour le subordonné. Un Frère Louis de Gonzague, premier provincial de la
province du Midi, qui fut directeur de l'école de Lorgues, sous le P. Deshayes,
et vécut assez pour assister aux fêtes romaines de la béatification de Montfort,
était omniprésent dans l'extraordinaire comme dans l'ordinaire. Ainsi se
jeta-t-il à corps perdu dans l'épidémie de typhoïde de 1860, ne pensant qu'à
arracher les malades à la double mort, temporelle et spirituelle. Ainsi fit-il
des maisons de sa province, en 1870, des ambulances où ses Frères se
dévouèrent, plusieurs jusqu'à en mourir. Un Frère Damase, provincial du Centre,
légendaire par sa bonté, se prodiguait jusqu'à l'extrême usure physique,
répondant, à ceux qui l'engageaient à se reposer quelque peu, qu'il préférait «
mourir debout ». Et des Frères d'emploi, quelle merveilleuse galerie
d'héroïques laborieux ne pou-rait-on dresser ? Leurs notices nécrologiques,
quand je les feuillette au hasard de la Chronique de l'Institut, me ravissent.
Ce Frère Eugène ! Cuisinier d'un bout à l'autre de sa vie religieuse, il ne
vivait qu'en Dieu, sans que, d'ailleurs, sa cuisine en souffrît. Tel était son
recueillement que rien ne le pouvait occuper, hors ce qui intéressait sa
conscience professionnelle. L'univers entier eût pu traverser sa cuisine sans
que son regard quittât le fourneau qu'il surveillait, le chapelet à la main. Il
n'aurait vécu, quant à lui, que de pain sec, si l'obéissance le lui avait
permis ; du moins se nourrissait-il de ce dont les autres ne voulaient pas, de
rebuts où parfois grouillaient les vers. Tellement enfoncé dans l'ombre qu'une
canonisation ne saurait où le prendre, il rivalisait, en humilité et
mortification, avec les Pères du désert. Il lui arrivait de projeter son humilité
dans la conscience des autres, de façon parfois bien imprévue. Quand son propre
Frère consanguin, le Frère Hubert, fut promu au généralat : « Comment ! lui dit
le Frère Eugène, vous avez osé accepter une telle charge ! Avez-vous oublié ce
que nous sommes, d'où nous venons ! C'est trop pour vos épaules ! » Sa vie est
faite de traits qui semblent de la légende dorée. La note dominante, ici
encore, c'est l'intensité d'un labeur qui, par l'esprit qu'il y apportait,
était un oraison continuelle.
Au terme de telles vies,
la mort n'est plus pour les Frères le royaume des épouvantements. « Ah ! s'écriait
quelques jours avant sa mort le Frère Louis-Victor — dont la tuberculose eut
raison, comme il avait quarante ans — Ah ! les saints ! Les saints ! Qu'ils
viennent donc nous chercher sur cette terre de misère, où nous sommes toujours
en danger d'offenser Dieu. » Et ceux-là qu'emporte le mal impitoyable, en la
fleur de leurs vingt ans ? « Quand je pense au bon Dieu que je vais voir,
s'exclame avec ardeur le jeune Frère Albert-Stanislas, j'ai envie de bondir de
mon lit. Je suis trop heureux. » La même cantilène de joie s'échappe des lèvres
du Frère Amance expirant. Sa vie religieuse si brève avait été une lutte,
énergique et victorieuse, contre son tempérament ardent, son caractère
généreux, mais violent. Sa vertu fut plus forte que les puissances obscures qui
se cabraient en' lui.
Au témoignage du Frère
Eugène-Marie « jamais il ne considéra ses supérieurs que comme ses pères et ses
meilleurs amis ». Cette filiale obéissance le soutint dans son combat et c'est
d'une âme très pure et très méritante que, sentant sa mort prochaine, il
aspirait à prononcer ses vœux perpétuels. On lui accorda de faire profession
par anticipation. Ce lui fut un jour de lumière. Maintenant, la mort pouvait
venir et elle vint, en effet, très vite. Il la vit s'approcher avec une
surnaturelle ivresse : « Je suis un peu inquiet au sujet de la joie dont je
surabonde, confia-t-il au supérieur général ; je n'ai aucun sentiment de
crainte et c'est pourquoi je crains d'être dans l'illusion... Oh ! que je suis
heureux ! » Heureux ! Ce mot revient comme un leitmotiv incessant quand il
s'agit de Saint-Gabriel ; il illumine l'apostolat des Frères ; il rayonne sur
le front des morts. Un enfant, futur membre marquant de l'Institut, disait à sa
mère, qui lui demandait le pourquoi de sa vocation gabriéliste : « Je veux être
Frère parce qu'ils ont toujours l'air d'être heureux. » Ainsi Montfort avait-il
vécu, joyeux, parmi des tribulations sans nombre. Ainsi était-il mort, en chantant
son cantique : Allons mes chers amis — Allons en Paradis — Quoi qu'on gagne en
ces lieux — Le Paradis vaut mieux.
Les Frères de
Saint-Gabriel procèdent d'ailleurs de Montfort par bien des traita encore.
Montfortaine, cette âme mariale qui fait des Frères, les chevaliers servants de
la Vierge ; montfortaine, cette manière tout unie, toute droite, d'aller à
Dieu, et cette simplicité foncière, dans la dévotion, dans l'action ; cette
franchise et ce franc-parler dans les rapports humains ; montfortain, ce
caractère missionnaire de leur apostolat pédagogique, qui les rend à chaque
instant « prête à faire tout ce qu'on leur ordonnera », avec un entrain
obstinément juvénile, jusque sous le poids des années, qui leur donne tant de
souplesse d'adaptation, d'ingéniosité et de variété dans les moyens et les
méthodes, et aussi ce sens du débrouillage et du bricolage qui leur fait tirer
parti de tout pour la plus grande gloire de Dieu ; montfortain, ce dévouement à
l'objet propre de leur apostolat : l'éducation chrétienne de l'enfance ;
montfortains, cet entrain conquérant, cette initiative toujours en mouvement,
qui ne laisse pas s'engluer la volonté dans la routine et la passivité;
montfortaines encore, cette révérence pour le clergé, cette collaboration
active avec lui qui les font s'ajuster au mouvement général de la vie
paroissiale; montfortaine enfin, cette prédilection pour les Jésuites auxquels
ils ont emprunté quelques méthodes majeures de formation religieuse qui les
aident précisément à réaliser avec plus d'ampleur l'idéal de Montfort. Au vrai,
ce qui distingue les Frères de Saint-Gabriel des congrégations similaires,
c'est le ferment montfortain.
Pour des raisons, dont
l'histoire rend compte, ce ferment a joué, pendant longtemps, comme un instinct
atavique ; jusqu'aux débuts du XIXe siècle, les Frères ont
spirituellement vécu de la règle, probablement assez embryonnaire, léguée par
Montfort, mais plus encore du charisme émané du tombeau, d'une tradition
vivante dont ils étaient tout imprégnés, qui a pénétré, à l'exception du Frère
Augustin, les éléments nouveaux importés par le P. Deshayes et qui a tout
naturellement passé de la maison du Saint-Esprit à la maison Supiot. Jusqu'en
1888, les supérieurs généraux, sans oser, pour les motifs que l'on sait, faire
passer dans la règle ou autres textes officiels la déclaration d'une filiation
qui était dans la vie, ont développé dans leurs circulaires une spiritualité
toute montfortaine ; les Missionnaires, de leur côté, par leur ministère
toujours très actif à Saint-Gabriel, ont contribué, jusqu'à cette date, à
l'entretenir chez les Frères. Enfin le chapitre général du 4 juin 1888 consacra
officiellement le fait historique, sur lequel, à leur tour, se sont
explicitement fondées les nouvelles constitutions de l'Institut.
Même après sa mort temporelle,
Montfort n'aura rien fait comme les autres. Ce qu'il y a d'exceptionnel dans
l'origine de ses fondations, subsiste dans leur développement. Pour ses propres
Fils, il a été longtemps, il reste encore, à la fois le plus agissant et le
moins connu des fondateurs. J'ai dit le long oubli où fut tenu le Traité de la vraie Dévotion à la Sainte
Vierge[64].
Le Secret de Marie, la Prière pour demander à Dieu des
missionnaires sont aussi de notoriété relativement récente. La biographie
critique de Montfort est loin d'être écrite. Nombre de ses manuscrits
importants n'ont pas encore vu le jour, notamment les notes qui devaient servir
à l'élaboration des sermons. Sa spiritualité n'a pas fait l'objet, jusqu'à nos
jours, d'études approfondies, exhaustives. Elle n'est méthodiquement enseignée
dans les noviciats de Saint-Gabriel que depuis peu[65].
On pourrait allonger la liste de ces particularités étonnantes. Elles sont la
preuve la plus saisissante qui soit de l'intensité de la vie surnaturelle
léguée par Montfort et de la fidélité des Frères au souvenir de leurs origines,
si intense en vérité que la carence des textes, les obscurités de la vie du
fondateur n'ont rien pu là contre. Il faudra bien qu'un jour les écrits non
encore publiés de Montfort, et les précieux manuscrits qui peuvent jeter sur
certains points importante de sa vie de précieuses lumières, sortent des limbes
où ils sont confinés. On peut imaginer ce qu'il adviendra le jour où la
puissante personnalité de Montfort aura fait sauter, une bonne fois, la pierre
de son tombeau. A la façon de grandes eaux enfin libérées, une poussée nouvelle
de son esprit irriguera, d'une vitalité accrue, l'Institut des Frères de
Saint-Gabriel. Tout s'est passé et se passe comme si la pleine révélation des virtualités
magnifiques de sa sainteté ne devait se produire qu'en ces Derniers Temps dont
il a parlé et où nous voici peut-être entrés.
II - FORMATION RELIGIEUSE ET
CULTURE INTELLECTUELLE
A la base de la
formation religieuse et intellectuelle est le juvénat où, tout en poursuivant
les études préparatoires au baccalauréat, l'enfant est élevé dans une
atmosphère propre à confirmer ou développer le premier appel à la vocation
religieuse qu'il a entendu dans sa famille et que le Prêtre ou le Frère du lieu
l'ont aidé à expliciter. J'ai vu maintes fois les juvénistes travailler et
s'ébattre soit au château de la Tremblaye, — à sept kilomètres de Saint-Laurent
— soit au pensionnat Saint-Gabriel à Saint-Laurent. Ils sont rassemblés dans le
premier, pendant trois ans, dans le second, jusqu'à la fin de la première.
Le château de la
Tremblaye, construction assez récente, a belle allure, malgré son architecture
exagérément tourmentée. De vastes étendues l'entourent où l'été s'épanouit à
merveille ; profonde sapinière, pelouses où de beaux bosquets surgissent des
hautes herbes. Le perron majestueux domine une prairie où scintille l'eau
immobile d'un étang. Au fond, des ruines : le lierre en enserre étroitement les
murs épais ; des douves les entourent, transformées en marais d'où montent,
parmi les nénuphars, le cri grasseyant des grenouilles. Ce sont les restes de
l'ancien château, détruit pendant la Révolution. Immédiatement au delà du
domaine, en bordure d'un chemin, une croix. C'est là qu'après un des plus
sévères engagements de la guerre de Vendée fut étendu Lescure blessé.
Ainsi l'histoire glorieuse
de leur pays, ici embusquée à tous les tournants, presse de près les petits
gars des pays d'Ouest. Des espaces généreux s'offrent à eux, ruraux pour la
plupart et habitués au plein air, mais ils ne peuvent s'y ébattre. Une barrière
les en sépare. Saint-Gabriel n'a pu malheureusement acquérir autour du château
qu'un enclos de médiocre étendue. Il comporte néanmoins un petit bois où se protéger
du soleil vertical de la canicule, un terrain de jeux, des dépendances du plus
charmant style rustique, dont les bâtiments, allongés en ailes, longent une
cour intérieure, propice aux jeux d'hiver.
Au reste, ici, la
lumière afflue, la lumière, sœur de l'enfance. Elle ruisselle dans cette classe
où je m'attarde, où les bancs s'alignent sous les hauts plafonds d'une des
salles du château. Les fenêtres sont ouvertes sur mai triomphant ; l'air est
plein de chants d'oiseaux. Et c'est plaisir, dans le renouveau de toutes choses,
de voir ces jeunes vies épanouies, ces joues rondes, duvetées comme les nids,
et ce clair et franc regard que j'aime tant à Saint-Gabriel, où se réfléchit la
pureté des cieux intérieurs. Tant de printemps qui, du dehors, rayonne sur les
pupitres, doit bien brouiller, parfois, par l'incantation de la nature en fête,
l'enseignement du professeur. « De la classe, je vois des canards dans l'étang
», écrivait un des enfants à sa mère. « Tu ferais mieux de regarder le tableau
noir », répondit la sage Vendéenne. Mais ce n'est là que plénitude heureuse de
la santé physique et morale. Ces petits juvénistes sont, dans l'ensemble, fort
studieux, me disent leurs professeurs et, aux examens, les résultats sont bons.
D'ailleurs, le principe gabriéliste est de se faire du grand air, dont on sait
les vertus, un allié, pour l'éducation des enfants. Rien n'est négligé à cet
égard. Pour aménager des dortoirs en ce château, nullement préparé à une
destination scolaire, il a fallu abattre des cloisons, éventrer ici, ouvrir là,
voire déplacer un escalier. On n'a pas reculé devant l'obstacle. Le résultat ?
Des dortoirs nets, aérés, lumineux. Nous voilà loin du collège-étouffoir.
Le réfectoire est au ras
du sol, le jardin comme à portée de la main. Je vais à la chaire du lecteur,
poussé par ma curiosité professionnelle. Que lit-on cette semaine ? Une famille
de brigands en 1793. Brigands ! Ainsi les Vendéens étaient-ils appelés par les
bleus. C'est la monographie d'une famille paysanne pendant les guerres de
Vendée. Le récit est de la grand-mère. Il passionne les enfants. Ainsi les
Frères entretiennent-ils sans cesse le souvenir des aïeux, ceux de la croisade
immortelle.
A première vue, rien ne
distingue un juvénat d'un pensionnat ordinaire. Mais à qui pousse son enquête,
une distinction essentielle apparaît vite. Sans doute, le juvéniste ne fait pas
partie de la congrégation. Le juvénat n'en est pas moins fondé sur le premier
appel divin entendu par l'enfant, plus ou moins nettement, mais certainement,
au pays natal ; c'est une préparation au noviciat, un surnaturel apprentissage
de l'état religieux, au cours duquel la vocation, chez la plupart, se précise
et s'affermit. Le noviciat, formation ascétique, mais aussi exaltation des plus
pures ferveurs de la jeunesse, est situé à l'horizon du juvéniste comme le premier
but auquel il doit tendre, comme un désirable épanouissement, dans une lumière
accrue, de son état présent. La formation qu'il reçoit doit aller, sur tous les
plans, à lui en donner pleine conscience.
Et d'abord, l'ambiance
familiale, que j'ai notée comme une caractéristique des communautés
gabriélistes, l'enveloppe dès son entrée. L'enfant a quitté sa famille
naturelle, courageusement, mais le cœur gros ; il en retrouve une autre, qui a
la chaleur et, sous l'inévitable discipline, la douceur du foyer. La
sollicitude des Frères s'étend aussi bien à la santé physique qu'à la santé
morale des juvénistes. Ils s'appliquent à faire en sorte, jusque dans les
moindres détails matériels, que nul regret nostalgique ne lancine l'enfant, et
qu'il baigne dans un climat de confiance et d'abandon.
La destination propre du
juvénat étant la préparation au noviciat, les études sont un but secondaire,
cependant d'importance, la congrégation de Saint-Gabriel étant enseignante. La
tendance actuelle, qui va à un approfondissement et à un élargissement du
savoir, est de faire passer la première partie du baccalauréat à tout juvéniste
avant son entrée au noviciat. On pousse aujourd'hui à élever aussi haut que
possible le niveau intellectuel du futur gabriéliste dès le juvénat, à ne pas
hésiter, par exemple, à lui mettre entre les mains, pour ses lectures
particulières, tel ouvrage, dont la substance à première vue peut paraître trop
forte pour lui. Ainsi seraient à la fois provoquées une saine avidité
intellectuelle et une salutaire gymnastique de l'esprit.
La formation religieuse,
qui s'exprime ici par la préparation spirituelle du noviciat, est la grande affaire,
la plus délicate aussi. La note générale est donnée par l'aumônier ; la note
particulière, gabriéliste et mariale, par le Frère directeur et les maîtres du
juvénat. Le travail essentiel consiste à faire passer l'enfant d'une piété
instinctive, transmise par tradition, et généralement limitée à des prières
vocales, dont le sens est plus ou moins saisi, à une vie spirituelle véritable,
à l'entrée en ligne des puissances du cœur et de l'esprit, à l'union à Dieu par
une prière qui soit connaissance et amour. Le tout, bien entendu, à la mesure
de l'enfance, ainsi qu'une certaine initiation déjà à la pauvreté religieuse,
au dépouillement intérieur. Le sentiment d'une appartenance, non de règle mais
d'esprit, à la famille de Saint-Gabriel est également suscité, développé, sans aucune
pression indiscrète d'ailleurs. On entraîne l'enfant à l'ascèse chrétienne par
l'examen particulier de chaque jour, d'abord, qui l'engage à pourchasser et à
vaincre son défaut habituel, puis par un entretien de quinzaine avec le
directeur du juvénat qui lui signale les défectuosités à combattre, les bonnes
habitudes à contracter. Cet entretien, fait d'ouverture confiante d'une part,
de sollicitude affectueuse de l'autre, est le plus efficace moyen d'éclairer et
d'approfondir la vocation.
Au bout de trois ans, le
juvéniste passe de la Tremblaye à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Une partie des bâtiments
du pensionnat de Saint-Gabriel est affectée au juvénat, mais le juvénat a son
organisation propre, absolument séparée de celle du pensionnat, ses classes et sa
cour de jeux. Les juvénistes sont maintenant des garçons de quinze ans.
Combien, parmi eux, passeront au noviciat ? On estime aux deux tiers le nombre
des persévérants. Il faut donc trois juvénistes pour faire deux postulants
(proportion qui n'est d'ailleurs pas absolue, la province du Canada comptant un
postulant pour trois juvénistes). Sur ceux qui persévèrent, soixante à
soixante-cinq pour cent viennent des écoles des Frères. Fait notable, car il
signale l'importance des écoles pour le recrutement ; il est un témoignage de
la valeur de l'exemple. A l'école, comme d'ailleurs au juvénat, les juvénistes
ont sous les yeux l'exacte image de ce que seront leur vie religieuse et leur
apostolat, s'ils se décident à faire le grand pas. Elle est, cette image, assez
séduisante pour être le plus entraînant des facteurs de recrutement. Il y a là
encore une formation pédagogique dont on ne saurait sous-estimer l'importance.
Le juvéniste voit enseigner selon la méthode qu'il appliquera lui-même.
Chaque province et
chaque district a son juvénat, entretenu par sa province et son district. Le
recrutement de la province de l'Ouest est, pour le plus fort contingent, des
départements de Vendée et de Loire-Inférieure, avec un certain nombre de
Bretons.
Il y a encore peu d'années,
le juvéniste passait postulant à quinze ans. En 1942, il fut décidé qu'il ne
sortirait du juvénat qu'à seize ans. Il n'en peut sortir aujourd'hui qu'à
dix-sept. Cette modification porte plus loin qu'on ne pense. Le juvéniste de
quinze ans n'est encore qu'un enfant ; celui de dix-sept est un commencement de
jeune homme. Il est bien davantage à la mesure des résolutions définitives
qu'il va avoir à prendre, des graves pensées où-il est introduit. D'autre part,
celui qui a préparé son baccalauréat a largement, désormais, la possibilité de
passer les examens de la première partie avant d'entrer au noviciat. C'est une
simplification considérable, sans parler de la valeur de ce complément
d'études, pour une formation intellectuelle plus mûrie, dont son noviciat
bénéficiera.
La nécessité d'une formation
intellectuelle et religieuse plus approfondie, et par là plus solide, a imposé
cette réforme. D'une telle nécessité, le Frère provincial de la province de
l'Ouest, le Frère G..., était convaincu de longue date. L'âpreté de la vie
d'enseignement, surtout conçue à la manière gabriéliste, le « totalitarisme »
du dévouement requis — toute la vie, toute la personne du professeur étant
absorbées dans la vie de l'enfant — le surmenage physique et moral qui en
résulte, requièrent des esprits bien nourris et des âmes fortes, ascétiques,
éprises de perfection. Il faut encore compter avec la situation de ces petits
groupes de Frères — trois ou quatre au plus — dispersés dans les bourgs de la
province, ne recevant forcément que de temps à autre le réconfort et le
stimulant de la visite du provincial, ne reprenant contact avec la grande
communauté qu'au moment des retraites et des vacances. On voit assez, sans
qu'il soit besoin d'y insister, le danger de repliement sur soi, de
découragement, de lassitude, d'amenuisement moral, de dessèchement spirituel
que comportent de tels cas, les plus nombreux, de beaucoup, dans l'Institut. Un
déchet excessif, trop d'abandons de la vie religieuse ont manifesté que ce
danger n'est pas illusoire. Un tel apostolat, vu du dedans comme du dehors, demande
un ensemble de qualités acquises et de vertus que peut seule donner une
formation religieuse très poussée. Enfin, face à un monde qui se matérialise à
toute vitesse et, par ailleurs, perfectionne de plus en plus son équipement
scientifique, il importe de poster au bon endroit, qui est l'école, des
religieux avertis des besoins et des exigences de leur temps, aptes à y faire
face, et à représenter, comme il convient, l'éminente dignité et la fonction
salvatrice de la pensée catholique.
Comme j'ai visité le
juvénat, j'ai fait du noviciat. J’y ai passé, à deux reprises, des heures
enchantées. La règle de Saint-Gabriel nomme expressément, parmi les protecteurs
de l'Institut, les anges gardiens. Celui qui assiste le Frère G. se montra
singulièrement tutélaire et bienfaisant le jour où il le conduisit au château
du Boistissandeau, l'actuel noviciat, enfoui dans la paix divine des collines,
des vallons et des bois. Et cet ange gardien, que l'activité dévorante du Frère
Provincial doit provoquer à de continuelles initiatives, avait certainement des
complicités célestes auprès de la comtesse de la Morinière et de Mlle
Henriette, sa fille. La châtelaine du Boistissandeau, en qui s'obstine la
distinction de la vieille France et qui, en l'année où j'écris, porte ses quatre-vingt-huit
ans avec une jeunesse impérissable, a compris, de tout son cœur généreux, la
portée d'une œuvre telle que celle du noviciat qui en conditionne tant
d'autres. Elle lui a fait le don fastueux du château et de son cadre. Elle ne
s'en est réservé, pour elle et les siens, qu'une partie. Sa discrète
bienfaisance s'exerce en mille attentions délicates à l'égard de ces jeunes
aspirants à la vie religieuse qu'elle considère comme ses enfants et qui le
sont en effet, non sur les registres de l'état civil, mais sur ceux du Royaume
de Dieu. Elle vit ainsi toute proche du grand travail intérieur qui s'opère
ici, saturée d'une atmosphère spirituelle dont elle est bien faite pour comprendre
la noblesse et la fécondité.
A peine avais-je quitté
la route des Herbiers à Chantonnay, au lieudit du Loup-Blanc, pour prendre
l'avenue descendant au noviciat, que j'étais déjà saisi par le génie du lieu.
Cette avenue est une des merveilles de ce vieux pays. Longue de neuf cents
mètres, elle aligne, sur plusieurs rangées, hêtres, charmes et marronniers
opulents dont le feuillage d'été est comme la voûte d'une cathédrale mouvante.
Je n'aperçois le château qu'après l'avoir suivie de bout en bout. Il est en
effet situé en contre-bas, à mi-coteau. Au lieu de chercher, comme ses pareils,
un point de domination, quelque orgueilleuse éminence, il épouse étroitement
l'humble terre, le taillis, la courbe modeste de la colline. Cette disposition
discrète et, dirait-on, confidentielle, comme elle convient à sa présente
destination ! Deposuit potentes de sede
mais aussi exaltavit humiles. Le
Boistissandeau n'en conserve pas moins allure de noblesse et de grandeur. Oui,
le beau château que voilà !
La cour d'honneur est
encadrée face à l'allée par une grille, au fond par le corps de logis, à droite
par des communs d'une charmante ordonnance, prolongés d'une chapelle au curieux
clocheton ; à gauche, par une construction neuve, où l'on s'est appliqué, avec
une intention méritoire et un résultat relativement heureux, à rester dans le style
de l'ensemble qui est de la fin de la Renaissance, donc d'une sobre
architecture, avec des fenêtres à meneaux et portes à plein cintre. Un seul
étage, que coiffe un toit d'ardoises percé de quatre lucarnes à fronton
triangulaire, le cintre de la façade, avec ses armoiries, son horloge, est
flanqué à hauteur du toit par une tourelle ronde, en encorbellement, délicieusement
imprévue. Le bâtiment latéral de gauche a respecté une partie des servitudes
qui faisaient autrefois exactement pendant à celles d'en face. C'est qu'une
large dalle de granit, d'émouvante mémoire, y fait saillie. Sous l'ancien régime,
elle servait de montoir pour les dames et les cavaliers, partant à la chasse à
courre. La grande Révolution l'a transformée en pierre sacrificielle pour ses
cultes monstrueux. Là, en effet, le 31 janvier 1794, fut égorgée Mme
d'Hillerin, ancêtre par alliance de la comtesse de la Morinière, tandis que les
hussards de Travot abattaient ses deux filles dans la cour d'honneur, à coups
de pistolet et de mousqueton.
Hue! et hue! et hue!
Qui ne les a vues...
Fières amazones
Sur leurs palefrois
Dans les grands arrois
Des tièdes automnes...
Ainsi chantait le Frère
Armand-Joseph, premier assistant de Saint-Gabriel et disciple de du Bellay, au
cent cinquantenaire du massacre. Rien décidément ne manque aux bienheureux
novices du Boistissandeau. Les souvenirs austères et exaltants de l'épopée lointaine
s'unissent, dans le plus aimable des paysages, aux enchantements des saisons.
Mais ma plus belle
surprise fut la façade du château qui regarde les jardins et le vallon. Elle
est flanquée de deux tours dont on n'aperçoit, côté cour, que les toits pointus.
De leur rotondité puissante, elles en compensent la grâce presque trop légère.
Une terrasse, large de quelques mètres, dont les dalles descellées laissent
pousser, dans les intervalles, les fleurs et les plantes, domine un parterre à
la française, tracé par un élève de Le Nôtre, où des ifs centenaires, taillés
en figures géométriques, piquent leurs sombres silhouettes. Et ce parterre
s'achève en une autre terrasse d'où l'on peut rêver devant un paysage très
bucolique ; d'un côté des arbres de haute futaie qui entourent une pièce d'eau
dormante ; en face, une colline, des champs, les folles herbes ; tout en bas,
un moulin avec son bief dont l'épanouissement donne un semblant d'importance au
petit Lay qui s'affaire, presque invisible au fond du vallon, ruisseau en
vérité qu'on ne pourrait dénommer rivière qu'au pays du Tendre. De l'autre
côté, s'étendent les potagers, encore des ifs taillés, une charmille-Mais quoi
! Les novices ont-ils temps et goût pour rêver comme j'ai fait, accoudé à ma
fenêtre, tandis qu'une lune impeccablement ronde, stylisée comme les ifs, en
faisait ressortir, en rudes ombres, l'immobile procession ? La vie de ces
jeunes gens est en effet toute répartie entre les profonds sommeils de la bonne
conscience, les prières, les études religieuses et des jeux enragés. C'est même
sous ce dernier aspect de leur activité que je les ai d'abord surpris. Je ne
crois pas avoir jamais vu lancer le ballon, le rattraper, le talonner avec une
telle fougue, et en un si furieux envol de soutanes. Mais où mon admiration,
mon ébahissement ont atteint leur sommet, c'est à les voir aménager pour le
basket-ball un terrain conquis, à muscles hypertendus, sur une vaste pièce de
taillis. Le taillis rasé, ils éventraient la colline. Juste ciel ! Se peut-il
que l'on remue tant de terre en si peu de temps ! Comment douter qu'il y eût là
beaucoup de vertu associée à une belle hérédité paysanne ? Ici et là, c'était,
à coup sûr, témoignage d'une magnifique santé physique et morale... Un coup de
sifflet du maître des novices ou du professeur et le jeu se figeait soudain ;
les novices se rassemblaient autour de moi pour une conversation franche et
joyeuse, pleine d'abandon. Quoi de plus frappant que leur gaieté ? Elle n'est
autre que l'effervescence ingénue et ardente d'âmes très pures, l'écho de leur
félicité intérieure, « Cher Frère disait un jour un novice au directeur, je
suis si content que je voudrais chanter ! » L'heure de la récréation ou de la
conversation passée, les voilà qui s'égrènent au long de l'avenue, isolés,
silencieux, le chapelet à la main, comme autant d'ombres méditatives.
J'ai longuement parlé
d'eux avec leur maître des novices, le Frère J... Il a répondu à mes questions
avec une ouverture totale. C'est un esprit fin, délié, apte à se retrouver
parmi les changeantes nuances et les replis du cœur humain, où tant se perdent
comme en un labyrinthe, un religieux à la fois profondément soucieux de la
formation ascétique et très averti du caractère de la nouvelle génération et
des besoins des temps nouveaux. Nul ne pousse plus que lui à l'approfondissement
du monde intérieur ; nul ne croit davantage que le noviciat ne doit pas être un
étouffoir, qu'il le faut aérer, en ouvrant des avenues à l'initiative
individuelle, et de larges perspectives sur la vie de l'esprit dans le monde.
De fait, il n'est point ici d'airs penchés, contractés, de mains dans les manches,
d'yeux baissés hors de propos. Si le Frère J... obtient qu'il en soit ainsi, ce
n'est point par l'effet d'une consigne, mais par l'atmosphère spirituelle vivifiante
que dégage sa doctrine.
Je retrouve bien entendu
les caractéristiques générales du tout noviciat : expériments divers qui
tendent à former à l'humilité, à l'obéissance, prudence à l'égard des voies
extraordinaires. Les mortifications corporelles sont interdites, sans
autorisation spéciale ; on voit assez les graves inconvénients qu'elles
auraient pour des jeunes gens de cet âge déjà soumis à un règlement austère,
dur à la nature. C'est à la mortification intérieure surtout qu'on les provoque.
Leur maître, interprétant d'ailleurs ainsi la spiritualité gabriéliste,
m'indique comme traits majeurs de la formation poursuivie : la piété, la
franchise, la simplicité, la charité fraternelle, la gaieté. Il n'a
certainement pas à imposer celle-ci ; elle fuse de toutes parts, témoignage
spontané de consciences pures et de cœurs en paix. Elle ne doit pas nous donner
le change sur le profond sérieux de l'œuvre intérieure. Postulants pendant six
mois, novices pendant dix-huit mois, ils passent ces deux ans au noviciat, sans
contact avec le monde, sans vacances au dehors. On sait assez le prix attaché
par la spiritualité ignacienne à l'ascèse, à la mort à soi-même. Or c'est sur
elle que se fonde la spiritualité du noviciat gabriéliste, sur un entraînement
constant de la volonté à la victoire sur ses mauvais penchants, à la traque
minutieuse des défauts les plus subtilement camouflés. C'est une tâche austère
et qui ne connaît point de répit. Ajoutez à cela une retraite de dix jours tous
les six mois, l'exclusion de toutes études profanes dans les matières
d'enseignement qui sont : la vie de Jésus-Christ, l'Histoire Sainte, l'histoire
de l'Eglise, l'ascèse d'après les grands auteurs spirituels, le catéchisme qui
est en fait un exposé assez poussé de la doctrine catholique.
Si les directives
générales sont immuables, l'action propre de chaque maître de novices se
discerne aisément. Celle du Frère J... va à desserrer ce qui serait trop tendu,
à assouplir ce qui serait trop sévère, trop strict. Un des graves inconvénients
d'un système trop rigide et trop uniforme, qui ne laisserait aucun jeu à la
personnalité, serait de favoriser le manque de franchise, voire l'hypocrisie.
De jeunes religieux, ainsi formés ou plutôt déformés, mis ensuite en contact
avec la vie, risqueraient fort de faire, tôt ou tard, sauter le moule, rejetant
le bon du même coup que le mauvais. Le Frère J... mène une guerre persévérante
au formalisme collectif et favorise, dans toute la mesure où la règle, le bon
ordre extérieur ou intérieur n'en souffrent pas, l'action individuelle. A cet
égard, une de ses innovations est bien significative. Il a autorisé la
formation d'un cercle d'études où, entre eux, hors la présence de tout
directeur, les novices reprennent les grands thèmes religieux du noviciat, pour
se fortifier de leurs expériences réciproques, trouver de nouveaux moyens de
perfectionnement intérieur. Cela aboutit pour chacun à une étude sur la
question traitée. Les meilleurs travaux, et les plus personnels, sont lus dans
une réunion générale du noviciat. Sur cette séance, un novice fait un rapport,
soumis au Supérieur général, qui approuve ou freine telle initiative, en
propose une autre... La vitalité du cercle est grande. L'émulation y fait
merveille. Le Frère directeur m'en a donné un exemple typique. La pratique de
la coulpe avait été supprimée : on avait dû se rendre compte qu'elle
aboutissait à un mécanisme verbal, où l'âme ne s'engageait pas et, le collégien
survivant chez le novice, devenait une occasion à malicieuses observations, à
taquineries fort innocentes mais assurément dépourvues de valeur ascétique. Or,
en cercle d'études, les novices décidèrent de demander le rétablissement de la
coulpe ; il le leur fut accordé. Faite depuis avec un profond sérieux, dans le
plus pur esprit de pénitence, de réparation, d'humilité, de charité
fraternelle, elle est un nouvel élément de progrès intérieur. Voilà qui
suffirait à justifier la méthode, hardie et sage, du Frère directeur. La
personnalité de chacun concourt au bien de la communauté. Il en va ainsi, parce
que cette jeunesse aime le Christ, brûle de le servir et qu'elle a la
générosité à la fois de son âge et de la vertu. C'est parce que le Frère J...
le sait qu'il lâche la bride, quitte à la reprendre, quand il convient, d'une
main dont la fermeté égale la douceur. Ce n'est pas lui qui méconnaîtra jamais,
chez ses jeunes disciples, l'humain et les légitimes exigences de l'humain.
Cela le rend également très attentif à la part du jeu, de l'exercice physique,
du sport. Il attache le plus grand prix à la valeur, morale autant que
physique, de cette détente. Cet espace, que j'ai vu transformer en un magnifique
terrain de sport, ce n'est pas un à-côté, mais un élément essentiel de sa tâche
formatrice. Par là, il ne rejoint pas seulement une des vues justes de son
temps, mais l'éternelle sagesse.
J'ai demandé au Frère
directeur quelle est au juste la prise du maître des novices sur ce qui est de
l'âme. En principe, me dit-il, n'étant pas prêtre, il doit diriger sur ce qui
est de l'extérieur seulement, en l'espèce sur le défaut apparent et en tant
qu'il apparaît. Il est du rôle proprement sacerdotal de l'aumônier, et du seul
aumônier, installé en permanence au noviciat, d'entrer dans le fond des
consciences, sans cependant entamer la fonction de direction générale qui appartient
au seul maître des novices. Si je m'en tenais à la théorie, cette distinction
me paraîtrait bien subtile. Le novice, par exemple, ne doit-il pas, une fois
par semaine, rendre compte au maître des novices de la façon dont il a pourchassé
son défaut principal ? Comment cela se pourrait-il, sans que l'intime de la
conscience soit mis à nu ? Mais en pratique, les choses s'arrangent pour le
mieux, les principes étant saufs : noviciat et novices sont bien ce que le
maître des novices les fait. Ce qui est d'aveu obligé au confessionnal de
l'aumônier est généralement de confidence spontanée et confiante auprès du
maître des novices, quand celui-ci, comme c'est le cas, justifie leur
confiance. Ainsi son influence ne manque-t-elle pas de s'exercer en profondeur,
jusque dans les cas délicats que pose une puberté en plein éveil. Je note en
passant l'extrême et salutaire franchise avec laquelle ces cas sont traités
quand ils viennent à surgir. Sur ce plan comme sur les autres, l'intelligente direction
du Frère J... n'a pire ennemi qu'une dissimulation, un trouble inavoué dont les
conséquences sont toujours néfastes. Le clair soleil doit régner ici partout.
Pas de coins d'ombre !
Les études religieuses
sont menées avec le souci croissant — assez récent, disons-le aussi — de les
accorder aux dernières recherches des meilleurs spécialistes de notre temps, au
lieu de s'accrocher à des manuels vieillis, excellents pour leur époque, mais
qui, fond et forme, ne conviennent plus aux intelligences d'aujourd'hui. C'est
ainsi que la Vie de Jésus-Christ de
l'admirable P. de Grandmaison triomphe au noviciat du Boistissandeau, et j'ai
pris acte, avec une joie sans mélange, de la ferme intention du Frère J... de
garnir les rayons de la bibliothèque des meilleurs ouvrages de cette
renaissance littéraire catholique qui, dans tous les genres, s'est épanouie
durant l'entre-deux-guerres. N'a-t-elle pas fourni, notamment, une production
hagiographique, drue et vivante, qui a renouvelé le genre, en rétablissant les
droits de la vérité totale dans l'histoire religieuse et en n'oubliant pas
l'humain chez le saint ? Une conférence que j'ai donnée là-dessus aux novices m'a
montré combien ils étaient ouverts à ces nouvelles formules. Au reste, leurs
maîtres, choisis avec le plus grand soin, sont les premiers à les encourager.
C'est une belle équipe d'entraîneurs, dont le rôle et l'influence, aux côtés du
directeur du noviciat, dont on ne saurait les séparer, quand il s'agit tant de
la formation des novices que des résultats acquis, sont considérables. L'un
d'eux enseigne Histoire de l'Eglise, français, méditation de formation, un
autre la vie de Jésus-Christ, la musique et le chant, le troisième l'Histoire
Sainte et le dogme. Les études montfortaines sont, par ailleurs, vigoureusement
activées aujourd'hui. Ce que le magistral Traité de la vraie dévotion à la Sainte
Vierge de Montfort présente d'interprétation difficile est éclairé aux novices
par des commentaires fort pertinents.
Ma visite au
Boistissandeau doublait mon désir de surprendre en plein travail le scolasticat
de la Mothe-Achard. Je m'y suis rendu avec le Frère Provincial. C'est bien
ainsi, car ne vais-je pas au cœur d'une de ses plus chères pensées ? C'est au
scolasticat que s'achève et s'épanouit cette réforme si importante qui recule
de quinze à dix-sept ans l'âge de sortie du juvénat, et porte de dix-huit mois
à deux ans la durée du noviciat. Quant au scolasticat, la même volonté
d'approfondissement de la formation le fortifie d'une année complémentaire. Si
le scolastique a passé avec succès, avant le noviciat, la première partie de
son baccalauréat, la durée du scolasticat sera pour lui de deux ans (une année
de philosophie, une année complémentaire) ; s'il en va autrement, il fera sa
première au scolasticat où il restera donc trois ans. Voilà qui est bien fait
pour freiner heureusement les généreuses mais excessives avidités d'apostolat
immédiat et substituer à l'appel prématuré du champ de bataille cette
préparation longue qui mûrit l'esprit, l'enrichit et fortifie l'âme pour les
futurs combats. Là encore, le principe des Frères de Saint-Gabriel rejoint
celui des Jésuites : tout allongement du temps de formation est un gain pour
l'esprit. Je ne sais signe plus frappant de la vitalité de Saint-Gabriel, plus
sûre garantie de son avenir que cet énergique mouvement qui, en pleine période
difficile, concentre ses jeunes forces sur la source première de tout Institut
religieux : la vie intérieure, celle de l'âme et celle de l'intelligence.
Le Frère G... a voulu
cela pour sa province de l'Ouest, de cette volonté qui est sa marque, calme et
douce, mais imbrisable et toujours prête aux attentes et patiences nécessaires.
S'il a dépassé cet âge qui, pour parler comme Paul Claudel, est entre le
printemps et l'été, c'est de peu, et d'ailleurs sa figure franche, ouverte et
cordiale, rayonne de l'optimiste jeunesse des hommes d'action. J'aime cette
manière allègre dont, son dessein étant arrêté, il passe à l'exécution. Il est
de ceux qui pensent que la difficulté est plus qu'à moitié vaincue dès qu'on
l'a virilement acceptée. Mais il ne confond pas l'action avec l'agitation ; ses
décisions ont longuement macéré dans l'observation quotidienne et perspicace,
dans la réflexion, la méditation. La décision arrêtée, sa faculté de
débrouillage, son entregent, son sens pratique, une diplomatie qui s'ignore,
mais donne à chacun son dû, l'aura de sympathie qui l'entoure, cet entrain
juvénile qu'un jugement sûr et pondéré ne laisse jamais extravaguer, tout cela
fait merveille. Et, en auto, à motocyclette, en express ou en l'un de ces «
tortillards » de province qui épousent tous les méandres des chemins vicinaux,
il fonce sur les quatre points cardinaux. Dieu sait si les difficultés abondent
au temps où j'écris ceci ; Frères déportés ou prisonniers manquent à tant de
postes ! La mobilisation continue de vider les maisons, de décimer les cadres.
A peine un trou est-il bouché que s'en ouvre un autre. Rien ne démonte le Frère
G... Alors que le radoubage suffirait à l'absorber, il s'occupe en outre de
construire, comme si la paix régnait à to.is les horizons. Si vous vous en
étonnez, il éclate en l'un de ces rires sonores et communicatifs qui lui sont
familiers et sèment la confiance et l'espoir.
Il m'a donc accompagné à
la Mothe-Achard et, chemin faisant, je l'ai pressé de me dire en quoi consiste
l'année complémentaire dont il a doté le scolasticat.
Le scolasticat, me
dit-il, met l'accent sur la culture intellectuelle. L'année complémentaire est
destinée à parfaire la formation humaine des jeunes Frères, à achever leur
culture première. Mais le Frère Provincial insiste sur le fait que les études
profanes, et les vérités qui en découlent, n'ont de valeur exaltante
qu'intégrées aux vérités transcendantes. « L'humanisme qui s'arrête à la
science, affirme-t-il, n'est que de surface et indigne de celui qui fait
profession de tendre à la perfection. » Aussi les études religieuses, y comprise
la fréquentation des grands mystiques, seront-elles la première des trois
disciplines principales de l'année complémentaire. Elles porteront surtout sur
le dogme « dont les âmes ont besoin pour assurer leur foi ». Dans le choix des
thèmes dogmatiques, les maîtres pourront s'inspirer des circonstances, en
traitant, par exemple, dans une année marquée par la guerre et la misère
générale, du dogme de la communion des saints. Parmi d'autres sujets
recommandés sont les encycliques pontificales — celle sur l'éducation
notamment. Est encore proposée l'étude littéraire, ascétique et mystique de
certains offices liturgiques, de certaines hymnes, de certains ouvrages de
Grignion de Montfort. Les problèmes les plus actuels de la sociologie
catholique sont également en chantier : Laïcité et école libre — Liberté
chrétienne — Les catholiques dans les lettres, à la tribune et dans la presse —
La question de la lecture — Les mouvements spécialisés d'action catholique...
La seconde discipline majeure est la métaphysique, entendue au sens thomiste «
grand cri de l'âme humaine en direction de Dieu ». Saint Thomas doit être le
maître à penser du scolasticat ; un tel principe est aussi conforme aux
directives de l'Eglise qu'au mouvement propre de Saint-Gabriel. Le conseil
provincial a récemment décidé que la fête de saint Thomas serait la fête
patronale du scolasticat. Une séance doit exalter ce jour-là la vocation
d'éducateurs chrétiens dont saint Thomas est un exemple lumineux et parfait. A
droite et à gauche de la voie tracée par le Docteur Angélique, le maître ne
manquera pas « de faire admirer les horizons particuliers des grands penseurs
chrétiens »... Les études pédagogiques complètent le cycle principal. C'est, en
quelque sorte, « l'apprentissage du métier d'instituteur et d'éducateur ».
Histoire et méthodologie en sont les pièces maîtresses.
Enfin, l'année
complémentaire comporte un certain nombre de disciplines secondaires :
Littérature supérieure et exercices de composition — Art religieux — Folklore —
Notions d'enseignement agricole et d'enseignement nautique (nombre d'écoles
tenues par les Frères se trouvant sur la côte) — Notions, de commerce et de
comptabilité — Musique et peinture — Levées de plans et arpentage — Essais de
monographies locales — Préparation de conférences — Causeries à but religieux,
apologétique et moral — Education physique...
Ce tour d'horizon donne
bien l'idée de la richesse du programme. Il va de soi qu'il ne s'agit pas d'approfondissement
des matières. On n'en peut donner, en une année, qu'une vision rapide. Mais
celle-ci suffit à en imprimer dans les jeunes intelligences les notions
essentielles, à leur donner le goût des grands paysages de l'esprit, à exciter
et orienter leurs curiosités intellectuelles, à leur fournir les thèmes
initiaux d'une culture générale que leurs lectures et leurs études, plus tard,
pourront compléter, dans le sens indiqué au scolasticat. J'admire l'ampleur de
vues dont témoigne une telle conception, la valeur humaine de ce programme, sa
valeur actuelle. Cette largeur d'esprit, le Frère Provincial, d'ailleurs, la
recommande aux maîtres ; il désire « que les maîtres aient conscience de parler
à des hommes, et que les jeunes sentent qu'ils sont traités comme tels et non
plus conduits en enfants et que grandisse en ceux-ci le sens de leur
responsabilité, fait de liberté et de conscience individuelle, afin qu'ils
soient ainsi préparés à la vie personnelle et réfléchie qu'ils auront à mener
bientôt ».
Ainsi, en arrivant au
scolasticat, je suis bien renseigné sur l'âme neuve qui l'anime. Je sais bien
que ce programme non seulement n'a pu produira encore ses effets, mais que la
réalisation en est encore à l'état d'ébauche. L'organisation décidée d'une
année de cours complémentaire démarre à peine, au milieu de difficultés
inouïes, nées des répercussions de la guerre. J'arrive aux débuts d'une
expérience, et même d'une expérience provisoirement suspendue. Sur sept
scolastiques entrés dans le nouveau régime, six sont partis, après trois mois
de cours seulement, pour remplacer, dans les écoles, des Frères fraîchement
mobilisés. L'autre est en instance de départ. Enfin je ne trouverai que vingt
scolastiques au lieu de soixante qui est l'effectif normal. En ce mois de
janvier, où je visite le scolasticat, celui-ci est privé des jeunes Frères que,
sous l'autre régime, il eût reçu six mois plus tôt et qui ne seront là qu'en
novembre. Enfin, il y a encore des jeunes gens, entrés au noviciat à quinze
ans, qui, par suite, n'ont pu passer leur première partie de baccalauréat avant
le noviciat et doivent le préparer ici. L'atmosphère n'est donc encore, à aucun
titre, celle que l'on attend de la réforme quand elle aura joué à tous les
échelons. Ce ne sont donc pas des résultats que je viens enregistrer, mais des
impressions sur le nouveau régime.
Je me persuade sans peine,
en tout cas, qu'il se développera dans un cadre parfait. A un bon kilomètre de
la Mothe-Achard, gros bourg proche de la côte vendéenne et de la Roche-sur-Yon,
sur un plateau de hauteur médiocre, mais d'où l'on domine de vastes étendues,
se dresse le château où sont les services de l'économat, l'aumônerie et les
chambres des hôtes de passage. Ce n'est pas le Boistissandeau, grave, puissant,
chargé de souvenirs lointains, mais un joli petit château Renaissance, de style
parfait d'ailleurs, élancé, coquet sous son toit d'ardoises bleues. Derrière,
s'allongent deux constructions importantes, sobres et bien conçues, dont l'une
abrite les scolastiques et leurs professeurs, l'autre l'école d'agriculture qui
est une des gloires de Saint-Gabriel. Ce sont deux petits mondes bien distincts
qui ne fusionnent qu'à la chapelle, pour la messe quotidienne et les offices du
dimanche. Encadrant, en demi-cercle, cet ensemble architectural, un bois de
haute futaie justifie la dénomination du domaine : Notre-Dame-de-la-Forêt.
Quatre-vingts hectares de terrain, dont, pour la plus grande part, les Frères
de l'école d'agriculture ont fait un terrain d'expérience agricole qui appuie
leur enseignement théorique et, quant à la perfection des méthodes employées et
à l'excellence, en qualité et quantité, du rendement, offre peu d'équivalents.
Ecole catholique — où
l'instruction et la formation religieuse, morale et sociale des élèves tient
une place insigne — école professionnelle — école d'enseignement général
(correspondant au programme des 2ème et 3ème années des écoles primaires supérieures), l'Institution
agricole de Notre-Dame-de-la-Forêt est ouverte en principe aux jeunes gens de
quatorze à dix-sept ans qui entendent se former à l'exploitation ou à la
direction de domaines agricoles. Le cours d'enseignement agricole est très
poussé, les travaux pratiques ne le sont pas moins ; ils bénéficient d'un champ
d'expériences étendu. Cinq centres les sollicitent : expérimentation agricole
(essais comparatifs d'engrais, de semences et de plantes cultivées) ;
expérimentation de céréales (étude comparative de vingt à vingt-cinq variétés
de blé) ; station viticole (étude des hybrides français pour la Vendée) ;
arboriculture fruitière; poste de météorologie agricole... Je ne puis entrer
ici dans le détail des multiples et souples méthodes de pédagogie sur le vif
qui sont ici mises en action. Il y faudrait tout un chapitre qu'il conviendrait
d'ailleurs de laisser à de plus compétente. Sensible aux voix subtiles, aux
incantations qui montent des prairies et des bois, je serais, la bêche à la
main, le plus impuissant des hommes. Mais les paysans de Vendée, acharnée à
leur terre, témoignent de ce que vaut l'Institution. Certains jours de l'année
où les syndicats agricoles s'y rassemblent, ils sont un bon millier qui
visitent, observent, comparent et finalement sentent s'ébranler en eux et
s'effriter les obstinations de la routine. Tel résultat les convainc, plus que
tous les discours, de l'excellence de tel procédé nouveau. Eux qui font si
bien, ils comprennent qu'ils peuvent mieux faire. Au surplus, ils entourent d'une
haute estime de connaisseurs, d'une admiration fondée en expérience, le Frère
S.-M., directeur de l'Institution. C'est un maître en la matière, dont l'avis
fait autorité dans toute la région. Il m'a développé quelques-unes de ses vues,
avec un brio et une abondance magnifiques. Je suis sorti de cet entretien, tout
étourdi d'une compétence qui me dépasse de toutes parts. Sur un point du moins,
j'ai pu me donner, de la bonté de l'Institution, une conviction personnelle et
victorieuse. Le Frère S..., dont j'ai apprécié les multiples curiosités
intellectuelles, est aussi, de par une profonde hérédité, un maître vigneron.
Je fus avec lui visiter le chai. De tonneau en tonneau, l'éprouvette, que
maniait sa main experte, happant dans les flancs ventrus le soleil de la vigne,
en versait dans mon verre tendu le contenu généreux. Délicieuses minutes où
j'éprouvai qu'en effet le vin réjouit le cœur de l'homme. Mais bientôt une
chaleur excessive en mon être intérieur m'avertit de fuir le sort de Noé.
J'ai passé à la Mothe-Achard
six jours en conversations effervescentes, tantôt au coin d'un feu de bois,
tantôt, si le soleil dissipait quelque peu la brume glacée, en marchant au long
des allées, entre les hêtres somptueux que battait l'aile des corbeaux. Chaque
professeur m'a livré ainsi sa pensée, avec cette simplicité qui me change
agréablement des propos mondaine, conventionnels et hypocrites. Tel, que les
lettres et la philosophie enchantent et qui s'y meut avec une égale aisance, et
une pensée fort personnelle et même savoureuse, n'a aucune peine à capter
l'attention de ses étudiants. Tel autre témoigne de l'extrême souplesse d'un
esprit, très original, lui aussi. Ses compétences sont multiples, car il est
d'une avidité, pour parler comme la comtesse de Noailles, innombrable. Il
professe la littérature en première, mais, en cours complémentaire, avec une
égale aisance, l'entomologie, la botanique, la géologie, l'agriculture, et
surtout la méthodologie. Ce qui me frappe, chez ses collègues comme chez
lui-même, c'est l'humanité dont ils pénètrent leur savoir. Trop de professeurs
sont des cérébraux congestionnés. Eux, ils restent proches de la nature et du
cœur humain, de l'âme qui leur importe par-dessus tout. Par là, comme par la
variété des disciplines professées, ils sont en réaction saine contre le mortel
abus de la spécialité.
Le Frère J. de M.,
directeur du scolasticat, est, lui, centré surtout sur l'âme de ses
scolastiques. Il y a dans sa distinction native, que la vie intérieure
spiritualise, comme une réserve, mais qui n'est qu'apparente. Le tact de
l'esprit, la délicatesse du cœur, aux sensibles antennes, une certaine défiance
de lui-même, j'imagine, le défendent, peut-être avec quelque outrance, contre
toute expansion en gestes ou paroles. Ce ne peut paraître froideur qu'à ceux
qui sont dénués de sens psychologique, ou que la timidité retient eux-mêmes.
Certaines pudeurs excessives de l'âme peuvent bien en voiler les riches
réserves de charité aimante, gardées dans le secret ; elles cèdent vite à qui
se livre avec une confiante franchise, et c'est grand bénéfice pour qui s'y est
décidé. De fait, je tiens du Frère Directeur des précisions abondantes et
significatives.
Je n'en veux retenir ici
qu'une. Il me laisse entendre que les vies de saints n'ont pas, auprès de ses
scolastiques, tout le succès qu'on attendrait en principe d'une telle lecture
en un tel milieu, et qu'eux-mêmes souhaiteraient leur faire. Cela — vrai du
moins de cette année scolaire 1943-1944 où je m'informe — ne laisse pas de
m'intriguer. J'ai prié le Frère Directeur de faire une enquête. Il s'y est
prêté avec une parfaite bonne grâce. Des questions ont été posées à tous les
scolastiques. « Aimez-vous les vies de saints en général ? — Quelles vies de
saints avez-vous lues ? — Lesquelles préférez-vous ? — Quelles vies de saints
n'aimez-vous pas ?» Et les intéressés ont répondu.
J'ai sous les yeux ces
feuillets. Ils m'ont pleinement rassuré. La preuve est faite que, si les vies
de saints ne sont pas aimées des scolastiques, la faute n'en est pas au saint
mais à l'auteur. Les responsables sont les écrivains — généralement
ecclésiastiques — de l'ancienne formule, fort rares aujourd'hui, Dieu merci !
Ils nous présentaient des saints tout faits, des saints en série, qui n'avaient
pas de défauts, pas de personnalité propre, presque rien d'humain, des saints
inaccessibles, inimitables à force d'être projetés dans une sorte de
merveilleux chrétien perpétuel. Par là-dessus, un style fade et conventionnel.
Ce que veillent avec raison les scolastiques, c'est le vrai, c'est l'humain
mêlé au divin, c'est le saint que l'on peut suivre dans ses surnaturelles
ascensions parce qu'on l'éprouve homme comme nous. Or, sauf exception, les vies
de saints qu'ils ont lues appartiennent à la formule que j'ai dite, déplorable
et surannée. Es ne relèvent pas de cette hagiographie moderne, dont la pleine
floraison est de l'entre-deux-guerres et dont les écrivains sont, en très
grande majorité, des laïcs. Par ses caractéristiques, elle annule les objections
que posent très justement les jeunes scolastiques ; elle exprime la vérité
totale de l'histoire et met en relief chez le saint l'humain, c'est-à-dire à la
fois l'attitude et le rôle de la nature, sous l'assaut conjugué de la volonté
et de la grâce, et une personnalité originale que la sainteté ne détruit pas,
qui s'intègre au contraire dans l'œuvre de sainteté. Ainsi le saint authentique
leur est restitué ; il leur devient un modèle accessible, un homme de chair et
de sang qu'ils puissent suivre et aimer.
Cette petite enquête
improvisée souligne l'intérêt et même l'urgence de la réforme à laquelle le
Frère Provincial s'attache d'un vouloir lucide et tenace. Un tel
approfondissement de la formation religieuse, un tel élargissement de la
culture générale ne peuvent s'accommoder d'une bibliothèque médiocre. Celle de
la Mothe-Achard, pour autant que j'ai pu m'en assurer, ne tient qu'un compte
fort maigre des richesses que la renaissance intellectuelle catholique tient
depuis vingt-cinq ans à sa disposition. Si l'on pense — et comment ne le
penserait-on pas ? — que les vies des saints bien faites sont, pour l'esprit et
pour l'âme, la plus belle source d'exaltation, la bibliothèque de la
Mothe-Achard se doit de leur faire large part. Telles sont bien d'ailleurs les
directives actuelles.
Les scolastiques m'ont
paru très avides des nourritures de l'esprit. Malgré un certain prurit de vie
active immédiate dont leur trépidante jeunesse a peine à se défaire, ils
envisagent avec plaisir l'année de cours complémentaire qui les attend. Us en
éprouvent le besoin. Le passage de la discipline du noviciat à la relative
liberté du scolasticat détermine, chez la plupart, une crise psychologique que
cette année complémentaire contribue à résoudre. Si, quant à la maturité
intellectuelle, je n'ai pas trouvé ces jeunes gens très différents, sauf tel ou
tel, des novices du Boistissandeau, c'est qu'ils n'ont pu bénéficier encore, je
l'ai dit, de l'application de la réforme. Tels quels, ils n'en atteignent pas
moins un bon niveau culturel. Au reste, à égalité de bagage intellectuel, un
jeune Frère l'emporte sur un jeune laïque, par la plus-value, non seulement
surnaturelle, mais humaine que représentent ses études religieuses. Comme une
culture générale plus poussée entraîne une ferveur religieuse plus grande, des
études religieuses plus approfondies déterminent une formation intellectuelle plus
riche. Enfin, il y a, à la Mothe-Achard comme au Boistissandeau, cette pureté
de cœur, cette soif de l'apostolat, cette générosité dans le dévouement, cette
piété fraîche et robuste qui composent une atmosphère émouvante.
Le renforcement de la
formation intellectuelle et religieuse qui s'opère aujourd'hui correspond en
quelque façon à l'institution du second noviciat. Celui-ci, conçu et voulu par
le Frère Eugène-Marie, fut durablement organisé, en 1931, sous le supériorat du
Frère Sébastien. Tous les Frères, même ceux des plus lointains postes
missionnaires, et qui ont atteint ou dépassé leurs trente ans, doivent passer
par ce second noviciat, qui les rassemble pour une période de vie religieuse
analogue à celle du premier noviciat, mais adaptée à l'âge et à l'expérience.
La durée en était à l'origine de cinq mois ; en 1934, elle fut allongée d'un
mois ; on souhaite maintenant la porter à un an. Le siège en est à
Boechout-lez-Anvers. Ces retrouvailles avec les ferventes origines de la vie
religieuse sont pour l'âme d'un bienfait incalculable, comme l'a abondamment
démontré l'expérience du troisième an chez les Jésuites. La grande retraite que
les Frères doivent faire, au moins un fois dans leur vie, selon la pleine
formule de Saint-Ignace, c'est-à-dire pendant trente jours, deux retraites de
huit jours au cours du second noviciat, parachèvent l'armature de l'ascétisme
gabriéliste. L'effort actuel du Frère Provincial, loin d'être révolutionnaire,
est donc bien dans la pure tradition de l'Institut. L'effort des supérieurs
majeurs a constamment tendu à remédier, par des institutions idoines, à la
dispersion, à l'émiettement, au dessèchement qui menacent la vie intérieure des
Frères, si fortement aspirés, de par leurs fonctions mêmes, par le dehors.
Ces choses, et tant
d'autres qui se pressent en moi, je les appelle et rassemble en me promenant
dans ce beau domaine où la méditation s'accorde si bien aux larges horizons.
Subtilement, les images qui m'entourent se mêlent à mes pensées et les
excitent. Seule, la tenace boue vendéenne qui, ici et là, s'agrippe à mes
souliers, serait capable de m'en détourner. Je m'enchante du petit château, si
fin, si élégant, si légèrement posé sur la prairie où, là-bas, un étang
microscopique est comme tine larme du ciel. Je m'attarde dans le bois de hêtres
pour lequel je me sens pris d'une grande amitié. D'un groupe de pins proches,
un vol de ramiers décolle en un départ brutal. Voici que passe, d'un pas
rapide, au rythme lourd des sabots, une troupe d'élèves de l'école
d'agriculture, conduits par le Frère A..., chef des travaux. Oserai-je dire que
son équipement d'homme de la forêt lui va mieux que la soutane et que son
curieux feutre tyrolien, délavé par les intempéries, coiffe fort bien son
maigre profil ponctué par un bouc agressif ?
Je termine ma promenade
par une visite à l'atelier de cordonnerie, sis dans les dépendances du château,
où est aussi la chapelle. Là, solitaire et aimant sa solitude, mais
cordialement accueillant au visiteur, règne le Frère cordonnier. Tassé sur sa
chaise basse, il ne fait qu'un avec la galoche ou le sabot, maniés de main
preste. Il est aussi le sonneur attitré de la chapelle. Un étroit escalier, une
manière d'échelle, le conduit à la corde, qui semble, balancée par les courants
d'air, pressée de sonner l'heure de Dieu. Ainsi sa vie s'écoule-t-elle, toute
au Seigneur, entre le bruit mat du marteau sur le cuir rebelle et les
tintements de la cloche. Conscience professionnelle et prière ; par là, il
s'accorde, en son isolement, au rythme de la communauté.
Donc, du plus humble
emploi à la fonction de professeur, tout obéit ici à un ordre profond. La
Mothe-Achard, c'est la dernière étape d'intégral recueillement avant l'envol
des Frères vers les nombreuses écoles de l'Ouest, où les Gabriélistes ont
planté leur drapeau aux couleurs de la Vierge. Là, les attend une jeunesse qui,
par ses traditions conservées, est une des plus précieuses réserves morales de la
France. Ce que j'ai vu ici, comme au Boistissandeau, comme à
Saint-Laurent-sur-Sèvre, m'assure que les Frères l'auront bien équipée pour les
travaux et combats de demain, qui ne seront point légers.
QUATRIEME PARTIE LES ŒUVRES EN FRANCE ET A
L'ETRANGER
Word pag 25 ; pdf
pag 20.
I - LES AMES DÉLIVRÉES
Institutions de
sourds-muets, aveugles et sourds-muets-aveugles
Entre tous les malheureux
que couvait la tendre compassion de M. de Montfort, ceux dont l'indigence s'aggravait
d'infirmité avaient sa prédilection. En quelque grande ville qu'il allât,
Poitiers ou Nantes, ou La Rochelle, il n'était lieu qui lui plût comme les
hôpitaux, où grouillaient, comme en une cour des miracles, pieds-bots, cancéreux,
estropiés, ulcéreux et aveugles. A leur intention, il fonda à Nantes, l'hospice
des incurables qui lui fut si cher. Comment n'aurait-il pas confié à ses
compagnons apostoliques, les Frères, le soin des malades ? Il n'était pas une
de ses missions qui ne connût la ruée vers lui des gueux très pitoyables, aux
corps ravagés de plaies et rongés de vermine, des parias du monde. Mathurin, ou
Jacques, ou Pierre ou Nicolas les ont assurément pansés et soignés, comme il
leur en donnait l'exemple. D'importants témoignages d'anciens missionnaires
assurent que les « Frères de la communauté du Saint-Esprit, pour faire les
écoles charitables », avaient aussi dans leurs attributions institutionnelles
le soin des malades (et des pauvres) dans les hôpitaux d'hommes et dans les
paroisses, et que la règle primitive le stipulait expressément.
Aussi bien, la maison
achetée pour les Frères en 1721 par le marquis de Magnane le fut-elle non
seulement pour qu'ils y fissent l'école charitable, mais pour qu'ils s'y
vouassent au soulagement des pauvres malades. Un précieux témoin des origines,
la sœur Florence[66],
confidente de la Mère Marie-Louise de Jésus, précise que M. Mulot, dès son
arrivée à Saint-Laurent, entendit faire honneur à ce double engagement et
désigna, pour en assurer l'exercice, le Frère Joseau. Comme celui-ci
n'entendait rien aux soins des malades, un chirurgien de Châtillon-sur-Sèvre,
M. Barberin, y pourvut. « En peu de tempe, écrit la sœur Florence, il le mit en
état de saigner, de médicamenter et de rendre aux malades les services
essentiels. »
Toujours attentif à
entrer dans les vues de Montfort, le P. Deshayes n'en pouvait négliger cet
aspect capital. Il y était d'ailleurs porté lui-même et avait déjà prie en
Bretagne, dans ce domaine, des initiatives du plus haut prix. Mais,
précisément, celles-ci l'engagèrent, sans qu'il négligeât les hôpitaux où il
envoya nombre de Frères, à donner à cette forme traditionnelle de l'apostolat
montfortain une orientation neuve. Le P. Deshayes, qui avait fondé en 1810 un
établissement de sourdes-muettes, à la Chartreuse d'Auray, lança du même coup
dans cette voie, dès 1826, les Frères de l'Instruction chrétienne du
Saint-Esprit. Les Filles de la Sagesse, elles, professaient déjà à la
chartreuse d'Auray, sur sa demande, depuis 1812.
L'abbé Sicard, disciple
de l'abbé de l'Epée et continuateur de son œuvre, avait renseigné le P.
Deshayes, par une correspondance active, sur l'esprit, les principes et les
méthodes de son maître. Cet abbé de l'Epée, c'est, dans la constellation des
bienfaiteurs de l'humanité, une étoile de première grandeur. Non qu'il ait été
le premier à concevoir et à appliquer l'éducation du sourd-muet ; moins
notoires que lui, des devanciers de haute valeur avaient réalisé dans cet art
difficile des performances mémorables : un saint Jean de Beverley, archevêque
d'York, au IXe siècle, un Frère Pedro Ponce de Léon, bénédictin, au XVIe
siècle, un Paul Bonet, un van Helmont, Hollandais, un Conrad Anmau, au XVIIe
siècle, un Wallis, un Jacob Rodrigue Pereire au XVIIIe siècle. Mais
il ne s'agissait là, avec des résultats d'ailleurs tout à fait remarquables,
que d'éducation individuelle sur des sujets, pour la plupart, supérieurement
doués. Le trait de génie de l'abbé de l'Epée, qui lui appartient bien en
propre, ce fut l'éducation collective, populaire et gratuite, des sourds-muets.
Elle impliquait, non plus des méthodes soigneusement cachées, par crainte de la
concurrence, mais, au grand jour d'une stimulante expérience publique, toute une
pédagogie des signes, à l'usage du plus grand nombre, toute une éducation
faisant accéder les organes phonateurs du sourd-muet à l'usage de la parole, sa
personne à la vie en société, son intelligence au savoir et son âme à la
lumière de Dieu. Aussi, l'année 1760, où l'abbé de l'Epée fonda à Paris le premier
établissement public de sourde-muets, est-elle la grande date de libération
d'une immense infortune.
L'abbé Sicard, qui jouit
d'une réputation presque égale à celle du grand précurseur, la mérite par
certaines qualités qui, précisément, s'imposaient pour que l'œuvre de l'abbé de
l'Epée atteignît à l'universalité. Le tour ingénieux, souple et pratique de son
esprit la renforça dans ses caractéristiques les plus bienfaisantes, en la
popularisant davantage et en exploitant avec bonheur sa perfectibilité. Les
méthodes de l'abbé de l'Epée, assouplies et enrichies par l'abbé Sicard, mirent
aux mains du P. Deshayes, puis des Frères et des Filles de la Sagesse, un
instrument, qui, pour avoir été largement dépassé, n'en était pas moins
excellent.
Les plus laudatives
épithètes ne sont pas excessives, appliquées au P. Deshayes, en tant qu'animateur
de l'œuvre des sourds-muets. Ce créateur, qui ne se perdait pas dans la
multiplicité de ses créations, les vivifiait toutes. Nul doute cependant que
cette œuvre-là n'ait été la fille préférée de son âme. La misère humaine le tenait
en état constant d'alerte et d'émoi ; il n'avait de cesse qu'il ne l'eût
soulagée. Par ailleurs, il voyait grand et, par ses dons d'organisation, son
sens pratique, il était bien équipé pour adapter les moyens à l'ampleur de ses
conceptions. Dès qu'il eut sous la main les Filles de la Sagesse et une équipe de
Frères suffisamment étoffée, il vit le parti qu'il en pourrait tirer pour la
mise en œuvre méthodique des initiatives de l'abbé de l'Epée et de M. Sicard.
Déjà, en 1810, dans sa paroisse d'Auray, il avait fondé la première école de
sourds-muets, avec le concours de Mlle Duler, professeur de l'école impériale
de sourds-muets de Paris et en 1812, une école de garçons, dirigée par M.
Humphry, élève de Mlle Duler. Mais, précisément, ces deux expériences l'avaient
fixé sur la nécessité d'assurer à une pédagogie si spéciale qui ne se développe
et ne se perfectionne que par un empirisme traditionnel, la continuité nécessaire.
Une congrégation, c'est à la fois le recrutement et la sélection indéfiniment
possibles, la permanence d'un même esprit, la transmission fidèle des
expériences et des méthodes, ce dévouement enfin, désintéressé, souvent
héroïque, et de tous les instants, que réclame l'éducation d'un sourd-muet,
menée comme il convient. Utiliser Filles de la Sagesse et Frères, c'était
fonder sur le roc, soustraire l'œuvre aux caprices individuels, et, du même
coup, disposer d'un instrument bipartite. Aux Frères, le P. Deshayes confia les
garçons, aux Sœurs les filles. Partout où il se pouvait, les deux institutions
étaient jumelées. A sa mort, le P. Deshayes laissait huit fondations : deux
(jumelées) à Orléans, deux (jumelées) à Solesons, deux (jumelées) à Lille, une
à Loudun pour les garçons, une à Pont-Achard, près Poitiers, pour les filles[67].
Ainsi ont pu se former, de part et d'autre, une lignée de maîtres de compétence
mondialement reconnue, dont les méthodes ont été se perfectionnant de
génération en génération, sans avoir à subir, d'un maître à l'autre, le
désarroi d'une cassure, ni même le trouble d'une transition incertaine. Ainsi
s'est constitué un corps pédagogique dont l'enseignement, par sa cohérence, par
une expérience longuement éprouvée, par des succès éclatants et réguliers,
représente à l'égard de l'éducation des sourds-muets, la formule-type. Le P.
Deshayes est incontestablement à l'origine de tout cela, qui dérive des
principes et des moyens qu'il a posés. Il avait su voir également la nécessité
d'assurer aux sourds-muets, avec l'instruction générale nécessaire, une
formation artisanale qui leur permît de gagner leur vie. Il avait été même
jusqu'à prévoir et désirer une école normale pour l'enseignement des
sourds-muets. Enfin, l'œuvre des sourds-muets-aveugles, qui, conjointement avec
celle des sourds-muets et sous le même toit, devait plus tard être réalisée par
les Frères et par les Filles de la Sagesse, si elle n'a pas été envisagée par
le P. Deshayes, a été rendue possible par lui. Des laboratoires de la charité
qu'étaient ces institutions de sourds-muets sont sortis et la sœur Marguerite,
fleur de génie et de sainteté et, par elle, la méthode qui a libéré les « Ames
en prison [68]
».
Depuis 1841, date de la
mort du P. Deshayes, les Frères de Saint-Gabriel ont ajouté à ses fondations
celles de Nantes en 1845, de Toulouse, en 1859, de Clermont-Ferrand-Royat en
1871, de Currière près la Grande-Chartreuse en 1877, de Bordeaux en 1881. La loi
de 1901 les obligea à abandonner les institutions de Lille,
Clermont-Ferraud-Royat et Currière. Actuellement, certaines maisons ayant
disparu, d'autres étant nées, l'œuvre des Frères se trouve répartie entre six
grands centres : Bordeaux, Marseille (fondé en 1918), Nantes, Orléans, Poitiers,
Toulouse. Ce sont là, il y faut prendre garde, des institutions régionales qui
absorbent en fait le recrutement en sourds-muets du tiers des départements
français soit près de six cents enfants. Soixante-dix Frères, soigneusement
choisis parmi les plus aptes à cette pédagogie difficile, y sont chargés de
l'instruction et de l'éducation.
La question capitale de
la préparation des maîtres, qui hantait l'esprit du P. Deshayes, fut, dès le
début, la préoccupation principale des Frères. Un enseignement aussi spécial
requiert de ceux qui le professent une instruction générale plus poussée que
chez les instituteurs d'enfants normaux, et notamment une connaissance approfondie,
un maniement aisé de la langue française. D'autre part, ils doivent non
seulement bien pratiquer une méthode, mais encore être en mesure de formuler
sur elle un jugement informé et une appréciation critique. Plus que toute autre
pédagogie, celle-là est soumise à des modifications incessantes qui sont autant
de progrès et le progrès est ici fonction, plus qu'ailleurs, de la valeur
individuelle du maître. La force et la souplesse d'observation de tel Frère, la
façon dont il a su dominer son expérience quotidienne pour en dégager des lois
générales, a abouti, plus d'une fois, noue le verrons, à imposer, avec une
méthode nouvelle, un progrès nouveau. Les Frères de Saint-Gabriel, appliquée à
l'instruction des sourde-muets, éprouvèrent vite le besoin de confronter les
vues, les procédés, les résultats, en vue d'arriver non à une uniformité rigide
qui paralyserait l'initiative individuelle, si précieuse en telle matière, mais
à une certaine unité dans l'orientation pédagogique. En 1854, chaque maison
délégua ses meilleurs spécialistes à un premier congrès.
L'échange de vues qui
s'ensuivit éclaira les données maîtresses du problème. Les Frères constatèrent
surtout trois choses : l'instruction des élèves confiés à des Frères
inexpérimentée en souffre un très grand dommage; les maîtres qui débutent dans
une Institution se découragent devant les difficultés de la tâche ; les élèves
s'aperçoivent de l'inexpérience des maîtres et leur confiance en eux s'en
ressent. La solution, chacun la voyait : une école normale. Mais on se borna à
en formuler le vœu. Les choses restèrent donc en l'état jusqu'à l'arrêté gouvernemental
du 3 septembre 1884 qui institua, pour l'enseignement des sourds-muets, des
certificats à deux degrés, le premier portant sur l'aptitude à exercer le professorat,
le second sur l'aptitude à former des aspirants au professorat. Mais, à partir
de 1906, les autorités officielles cessèrent de s'en occuper. Il en alla ainsi
jusqu'en 1925. Alors intervint M. Lemesle, en religion Frère Benoît.
Le passage de ce Frère
de Saint-Gabriel, dans l'enseignement des sourds-muets, est mémorable. Né en
1856, il fit, à peine sorti du noviciat, en 1874, ses premières armes de
professeur à l'Institution de Poitiers, après une rapide initiation donnée à
Nantes par le Frère Louis. En 1885, donc âgé de vingt-neuf ans, il en devint le
directeur, et le resta jusqu'en 1918 où il fut appelé à la direction de
l'établissement de Nantes. La loi de 1901 passa sur lui sans autre résultat que
de séculariser son habit et son nom. M. Lemesle est seul connu dans les milieux
qui, de près ou de loin, s'intéressent aux sourds-muets, mais l'Institut de
Saint-Gabriel garde jalouse mémoire du Frère Benoît, religieux de profonde
piété, d'observance exemplaire, et dont le dévouement jaillissait
intarissablement des sources profondes de sa règle. Il avait beau être
chevalier de la Légion d'honneur, officier d'académie, honoré de tout un monde
officiel, chamarré de titres et de décorations, son ordre de grandeur était
ailleurs. Il resplendit dans les mots qu'il prononça en expirant, le 28
septembre 1939 : « Mon Dieu, faites que je vous aime et que je meure en
sentant que je vous aime. » Il n'avait fait autre chose, en vérité, tout au
long de sa vie, que d'aimer le Christ en la personne des plus disgraciés de ses
enfants.
Son action pédagogique
fut considérable et novatrice, mais il se révéla aussi un chef d'envergure, un
organisateur-né, un administrateur de grande classe. A cet égard, son œuvre maîtresse
fut de grouper les Institutions de sourds-muets et d'aveugles, tant pour la défense
de leurs intérêts communs que pour promouvoir la meilleure méthode
d'enseignement et réaliser sur elle l'unité désirable. Le 1er février 1925, la
Fédération des Associations de patronage des Institutions de sourds-muets et
d'aveugles de France était officiellement constituée, avec M. Lemesle comme
secrétaire général. Le nombre des Institutions ainsi fédérées était de
trente-six sur les quarante-sept que compte la France. Il va de soi que M.
Lemesle partait du grand principe : au commencement est le maître. La
préparation technique du maître, il la prit en main au nom de la Fédération, et
sur le programme de l'Institution nationale de Paris. Désormais — conformément
à l'arrêté ministériel du 3 septembre 1884
— tantôt dans un établissement, tantôt dans un autre, des
examens sont régulièrement passés devant un jury de la Fédération composé de
professionnels et qui délivre des diplômes, signés du président de la
Fédération. La Fédération forme elle-même ses maîtres.
M. Lemesle, homme de
volonté tenace, ne cessa de fortifier et d'élargir cette grande œuvre
fédérative. Il fonda et dirigea deux journaux, l'un à l'usage des sourds-muets,
l'autre à l'usage des aveugles. Son but était d'établir ainsi un trait d'union
entre les Institutions et leurs anciens élèves tant pour défendre les intérêts
de ceux-ci et de celles-là que pour maintenir et animer l'esprit religieux des
anciens. Il écrivit dans ces publications d'excellents articles, de pensée
nourrie et claire et de style incisif. Trois congrès, qu'il organisa lui-même
et dont il fut l'animateur, suivirent celui de la fondation. M. Lemesle avait
senti, dès le début, la nécessité d'attirer sur l'œuvre des sourds-muets
l'attention non seulement des spécialistes, mais du grand public. Cette
publicité intelligente, il sut l'orchestrer. Les plus hautes personnalités de
la région assistèrent au congrès, et M. Lemesle obligea à se produire les
maîtres habitués à ensevelir leur compétence et leur valeur sous leur humilité.
Ce qu'il voulait, c'était mettre en vedette non les hommes mais l'œuvre. Des Frères
professeurs lurent des rapports et l'on sut ainsi les immenses services rendus,
dans l'ombre, à la science et à l'humanité. M. Lemesle était quelqu'un. Le
prestige personnel qu'il acquit par la force de sa personnalité, par ses
ouvrages[69],
par son action créatrice, servit beaucoup la cause des sourds-muets et des
aveugles, et fonda solidement la Fédération[70].
Tels sont les faits vus
de l'extérieur, telle est la courbe générale de l'action des Frères de
Saint-Gabriel, dans ce domaine où, par le nombre, la valeur et l'expérience,
ils sont des maîtres incontestés[71].
Cette œuvre, c'est tout un monde dont il serait bien vain que je prétende
donner une idée suffisante, corseté comme je le suie dans les limites d'un
chapitre. Sur le rapport de l'intelligence et des sens, sur l'origine et le
développement des facultés, sur la psychologie et la physiologie, sur le rôle
du subconscient, sur l'immortalité de l'âme et ses aspirations foncières, la
pédagogie des sourds-muets et sourds-muets-aveugles ouvre des perspectives sans
fin. Quelles émouvantes révélations encore sur le monde de la souffrance, des
ascensions morales, sur le rôle prodigieux du dévouement, indispensable et
tout-puissant associé de la science en cette pédagogie subtile et complexe ! Du
moins ai-je repéré quelques poteaux indicateurs pour me guider sur cette terre
inconnue. Ma première enquête, je l'ai menée auprès du Frère Benoît du Pont
dont une sécularisation fictive, comme il on fut du Frère Benoît Lemesle, a mis
et gardé obstinément en lumière le nom patronymique : M. Coissard.
Voici donc, dans une
chambre minuscule de la vieille maison Supiot, que sa seule présence, si
personnelle, emplit toute, le Frère Coissard. A peine suis-je entré que, d'un
rapide et chaleureux mouvement auquel son rabat bleu, pointé en avant,
participe allègrement, il bondit sur moi. Archiviste, à titre provisoire, de
l'Institut, il me fait irrésistiblement penser, avec sa barbiche bifurquée, son
grand nez busqué, son arcade sourcilière puissamment embroussaillée, ce toupet
neigeux qui allume au sommet de son front une flamme cordiale, à quelque
docteur Faust parmi ses alambics. Mais non ! C'est bien un Frère de
Saint-Gabriel que j'ai devant moi, et, s'il a conservé à soixante-quinze ans
l'alacrité, la vivacité de réflexes et le teint chaleureux de la jeunesse, ce
n'est point par l'effet de quelque traité ténébreux, mais parce qu'il est de la
robuste race des montagnards d'Auvergne et surtout qu'il se renouvelle dans le
frais et profond amour de l'enfance malheureuse comme en une fontaine de
Jouvence. L'obéissance religieuse en a fait, pour quelque temps, et pour mon
plus grand profit, un archiviste qui a pourchassé jusqu'en de poussiéreux greniers
de bibliothèques municipales ou départementales toutes les énigmes
montfortaines. Dieu sait l'entrain qu'il y a mis, car il ne se donne pas à
moitié, mais son affaire, ce sont ses chers sourds-muets. Comme M. Lemesle, il
sortait à peine du noviciat — il avait dix-huit ans — quand il commença auprès
d'eux son apostolat pédagogique. Pendant plus d'un demi-siècle, il n'a vécu que
pour eux. Il a été successivement dans les Institutions de Lille, de Poitiers,
de Bordeaux: de Toulouse, de Currière... Mais c'est Nantes, avec son royal
établissement de la Persagotière, qui l'a gardé le plus longtemps — quarante
ans ! — et retient à coup sûr une préférence dont il se défend mollement...
Cependant, c'est avec un attendrissement visible qu'il se reporte à Currière,
cet ancien couvent, dépendant de la Grande-Chartreuse, fiché sur une prairie de
la plus âpre montagne alpine et que les six mois d'hiver recouvrent d'un tapis
blanc de haute laine. Cette solitude sauvage, qui est à plusieurs heures de
mulet du plus prochain village, enchante son souvenir.
En ces étapes diverses,
le Frère Coissard a gagné une expérience et une maîtrise de la question qui en
font un des meilleurs spécialistes de Saint-Gabriel. Il est actuellement
Inspecteur général des Institutions de la Fédération; pendant la guerre de
1914-1918, il fut chargé, avec le docteur Liébault, du centre de rééducation de
la neuvième région, sis à l'Institution de La Persagotière[72].
De cette collaboration est même née une monographie du plus grand intérêt : Les
Aphones pendant, la guerre. D'autres travaux du Frère Coissard ont été
publiés, fort appréciés des spécialistes[73].
Il est de ceux qui ont
redressé non seulement les surdimutités, mais les divers troubles de la parole
et qui souhaitent qu'une part, plus large soit faite dans les divers
établissements, par un personnel approprié, à cette pédagogie élargie. De fait,
il a obtenu, dans ce domaine, de surprenants résultats, rendant par exemple la
parole normale, en un temps record, à des bègues invétérés. Je l'entends qui
s'indigne : il ne veut pas qu'on le sache et m'en voudra de l'avoir dit.
Seulement, un enquêteur est, de sa nature, avide et impitoyable. « Enfin, cher
Frère, quoi que vous en ayez, vous êtes tout de même aussi l'inventeur d'une
bonne douzaine d'appareils divers qui sont de précieux auxiliaires à l'œuvre de
redressement de la parole, de rééducation de l'audition : ce thoracimètre qui
permet de mesurer le développement du périmètre thoracique pendant la
respiration et d'en suivre les progrès ; ce chrono-pneumomètre qui a pour objet
de mesurer la longueur et la puissance du souffle ; la règle creuse par
laquelle en est enregistrée la force croissante ; l'acoumètre qui détermine le
degré d'audition ; ce spiromètre surtout, si précis et si souple, qui mesure le
volume d'air expiré, et qu'un éminent laryngologiste adopta d'enthousiasme,
d'autres instruments encore... » Cette énumération met le Frère Coissard au
supplice ; il s'agite, lève les bras au ciel, et, comme son calot noir en perd
sa stabilité, il lui rend, d'un geste nerveux, son assiette crânienne, le reperd,
le rattrape ; puis il éclate d'un rire sonore à la pensée qu'on puisse
attribuer quelque importance à ces choses : ce sont bricoles ; il a fait cela
pour s'amuser ; il ne sait même plus où sont ces mécaniques ; les a prises qui
a voulu ; elles ont été fabriquées sur ses plans, à exemplaire unique, avec la
complicité d'un petit horloger de Nantes... Eh mais ! Ce dernier trait, par
quoi il prétend écraser ses propres inventions, sous le mépris le plus
justifié, quelle intéressante indication ! Nous sommes ici dans le royaume de
l'empirisme où, sans études scientifiques préalables, avec une extrême humilité
de moyens, les Frères de Saint-Gabriel, pédagogues des sourds-muets, sont arrivés
à des résultats, scientifiquement imbattables. Ces instruments du Frère Coissard,
dont je sais, par d'autres que lui, la valeur, brevetés par la seule
Providence, sont le fruit d'une observation constamment pensée et repensée et
aussi du don de tout l'être à une seule cause : libérer l'âme par la parole et
par le signe, pour la donner à Dieu. Le Frère Coissard, tout autant que ses
sens et son intelligence, a tenu son cœur aux écoutes. Et si je m'attarde sur
lui, c'est simplement qu'en sa personne, que j'ai eu l'honneur et la bonne
fortune d'approcher de près et longuement, se reflètent cinquante ans d'une
expérience collective, menée en cinq Institutions, avec le même esprit et des
méthodes sans cesse perfectionnées.
Ces méthodes, j'entends
: celles pratiquées par les Frères de Saint-Gabriel, quelles sont-elles ? Le
Frère Coissard me l'explique, ponctuant ses explications des mimiques et
procédés d'articulation qui, pour le profane que je suis, sont, à son exposé,
ce qu'est à la connaissance de l'histoire l'imagerie d'Epinal, pour l'enfant
émerveillé.
Trois grandes méthodes
ont successivement dominé : la Mimique
(les signes ou langage des gestes), de 1822 à 1854 — la Méthode mixte (signes et paroles), de 1854 à 1880, — et la Méthode orale, de 1880 à nos jours[74].
Une certaine mimique fut
de tout temps employée. Elle est le « langage » instinctif des sourds-muets.
L'abbé de l'Epée la mit au point et en fit une méthode systématique
d'enseignement que l'abbé Sicard perfectionna. Elle joignait au mouvement des
doigts, ou dactylologie, tout un ensemble de signes et de gestes. L'écriture
venait concurremment. La dactylologie reproduisait les lettres composant les
syllabes et les mots d'une phrase ; le langage des gestes qui lui était associé
traduisait, non plus les lettres d'un mot, mais l'idée elle-même dont ce mot
était l'expression. Ainsi le mot Dieu s'exprimait par le signe manuel
correspondant à la lettre D, et l'index, qui entre en jeu dans ce signe, était
pointé vers le ciel. Le tout sur la base du grand principe de toute éducation
de sourd-muet, valable quelle que soit la méthode : passer du connu à
l'inconnu, du sensible à l'abstrait. L'objet matériel, c'est la première notion
que transmet le signe. De cet objet et de ses qualificatifs — de grandeur, de
beauté, etc... — l'enfant était élevé, par analogie sommaire, à la connaissance
des choses invisibles. Des manuels spéciaux, imprimés à son usage, lui
présentaient des lettres sous lesquelles il devait retrouver les « idées »
ainsi acquises, avant de les exprimer en langage écrit. Laborieuse lecture,
chaque mot comportant un commentaire, une leçon par signes, ressassée plusieurs
fois, avec le souci de ne jamais laisser un mot incompris, sous peine de
condamner la phrase à rester un rébus. La répétition inlassable et
l'enchaînement constant sont la double nécessité de cet enseignement abrupt.
La mimique est indéfiniment
perfectible. Le P. Deshayes engageait les Frères spécialisés à la perfectionner
sans cesse. Chaque année, ils étaient réunis autour de lui et chacun d'eux
faisait connaître les signes qu'il avait trouvés. Soumis au jugement de
l'assemblée, ils étaient adoptés ou rejetés. Ainsi, du même coup, le P.
Deshayes inaugurait, au petit pied, les congrès de professeurs de sourds-muets,
suscitait et réglementait les progrès, tendait à l'unité de vues et de
méthodes.
En 1850, nouveau pas en
avant. Un travail était publié qui révélait une nouvelle méthode, imaginée par
le Frère Alexis : la Cheirologie, qui
allait à accélérer la transmission par signes, ceux-ci utilisant les deux mains
et traduisant, non plus les lettres, mais les consonances de chaque syllabe.
C'était en somme une manière de sténo du langage des doigts. D'autre part, un
congrès de professeurs de Saint-Gabriel, réunis à Loudun en 1854, émit le vœu
que fût rédigé un dictionnaire des signes. Il en chargea les Frères Anselme et
Louis. Leur œuvre devait rester manuscrite, mais l'abbé Lambert, premier
aumônier de l'Institution impériale de Paris, s'en inspira dans son ouvrage,
publié en 1865 : Le langage de la
physionomie et du geste.
Vers la même époque, une
profonde évolution se préparait dans la technique de l'enseignement des
sourds-muets. L'animateur en était le Frère Bernard, professeur à l'Institution
de Loudun. L'intrinsèque faiblesse de la méthode mimique étant de ne pouvoir
s'adapter à la syntaxe et à la parfaite tenue grammaticale, d'obliger ainsi
l'enfant à parler petit-nègre — « Professeur punir moi, moi craindre », par
exemple — et de fausser les idées abstraites en les concrétisant à l'excès, le
Frère Bernard cherchait autre chose. Dès 1852, il lui apparut que le langage parlé
était la formule de l'avenir. Il imagina donc et réalisa la lecture sur les
lèvres mais sans renoncer aux signes et gestes conventionnels. Par un reste de
timidité, il ne lui apparut pas qu'une articulation, judicieusement exagérée,
suffisait à la lecture, des consonnes et il la fortifia du signe fait par la
main à proximité des lèvres et correspondant à la syllabe articulée. Et ce fut
la phonodactylologie, bien nommée puisqu'elle est une méthode mixte, utilisant
la parole et les signes. Par elle, l'enfant démutisé possédait le son et la
parole. Il orthographiait convenablement. Comment, par une combinaison de
l'articulation et des signes, consonnes et voyelles étaient lues par l'enfant,
il est fort intéressant de s'en rendre compte, mais cela m'entraînerait au delà
de mon cadre. Toujours est-il que le congrès de Loudun, dont je viens de
parler, s'enthousiasma pour les résultats obtenus et décida que « la méthode
phonodactylologique du Frère Bernard serait adoptée et appliquée dans toutes les
Institutions ». Il souligna que cette méthode était adoptée en tant que mixte,
c'est-à-dire fortifiant le système oral par le système des signes que l'on
tenait absolument à conserver. Le procédé du Frère Bernard comportait des
lacunes : son adoption par la Congrégation n'en est pas moins une date
capitale. A partir de ce jour, les jeunes sourds-muets, étant en mesure de se
faire comprendre de quiconque, voyaient s'ouvrir devant eux les carrières
artistiques et industrielles qui, jusque-là, leur étaient fermées.
Or, en 1880, le congrès
international de Milan décréta la mort du signe et l'adoption de la méthode
orale pure. Il proscrivit jusqu'à l'alphabet manuel. L'abbé Tarra, directeur de
l'école de sourds-muets de Milan, menait le jeu. La décision fut prise avec un
enthousiasme où il entra, semble-t-il, quelque emballement. Certes, la méthode
orale constituait un immense progrès ; en particulier, elle rendait possible
aux sourds-muets tous examens pour l'obtention de tous diplômes. C'est dans
l'exclusion totale du signe, indispensable en nombre de cas et inné chez le
sourd-muet, qu'était l'excès. Quelle fut l'attitude des Frères de Saint-Gabriel
?
Ils étaient représentés
en nombre au congrès ; chacune de leurs Institutions avait délégué plusieurs
professeurs. Le Frère Bernard, notamment, était là : inventeur et metteur en
œuvre de la phonodactylologie, il était bien placé pour préconiser les nuances
et réserves nécessaires. Cependant, il ne dit mot, non plus que ses collègues
et se rangea modestement à l'avis de la majorité. Ce silence collectif des
Frères, s'il souligne une fois de plus la simplicité et le désintéressement qui
sont les marques de leur Institut, est regretté par beaucoup, dont, je crois
bien, le Frère Coissard. Un détail amusant est que les professeurs de Milan, en
arrivant au congrès, traçaient de la main les signes qui veulent dire pour les
sourds-muets : « Pas de signes ! » Ainsi, par une revanche ironique de la
nature des choses, le signe marquait-il, en se suicidant, son utilité... Mais
les Frères, sans doute, s'ils fussent intervenus, n'auraient pu grand'chose là
contre. On allait, dans ces milieux, à la méthode orale pure, comme, plus tard,
la France au général Boulanger. Le seul moyen de communication officiel du
sourd-muet fut la parole lue sur les lèvres et l'on ne voulut plus connaître
que le sourd-parlant.
Il n'est ni dans la
nature ni dans la surnature du Frère de Saint-Gabriel de bouder à une
innovation. Celle-là, d'ailleurs, ne pouvait leur déplaire à l'excès, puisque
de leurs rangs était sorti le meilleur précurseur de la méthode orale, le Frère
Bernard, et que de sa phonodactylologie ils avaient fait, pendant vingt-cinq
ans, leur règle pédagogique. Qu'elle ne fût plus mitigée et complétée par le
signe n'était pas fait pour les arrêter, et ils s'y donnèrent avec leur entrain
coutumier, obtenant dans cette voie nouvelle des résultats qui témoignent de
leur esprit d'adaptation. Quatre ans ne s'étaient pas écoulés depuis le congrès
de Milan que le Frère Médéric, directeur de l'Institution de Poitiers, publiait
une « Méthode d'articulation et de lecture sur les lèvres à l'usage des
Institutions de sourds-muets ». La partie du maître porte sur la physiologie de
la parole, la partie de l'élève sur la démutisation et sur la clé de la lecture.
C'était, à l'usage des débutants, un excellent guide dans la voie nouvelle où
s'engageait l'instruction des sourds-muets[75].
La pédagogie à l'usage
des sourds-muets ne se comprend bien que vue en action. Au reste, nul exposé,
si précis soit-il, ne peut rendre compte des impondérables dont le mécanisme
compliqué, subtil et souvent imprévu, de la physiologie et de la psychologie,
multiplie ici les souveraines interventions, ni du facteur moral qui, tant chez
les professeurs que chez l'élève, joue un rôle décisif. A la Persagotière de
Nantes, à l'Institution de Poitiers, j'ai pu voir des centres de sourds-muets
en pleine vie, assister à des classes, causer avec des professeurs et des
élèves.
L'établissement de
Nantes est une des plus importantes fondations des Frères. Elle a été faite du
greffage, en 1843, de l'école des sourds-muets d'Auray, transférée à Nantes,
sur une institution départementale de sourds-muets, alors fort modeste encore[76],
qui gîtait comme elle pouvait, et plutôt mal que bien, dans les sous-sols de
l'hospice Saint-Jacques. Le Frère Louis, celui-là même qui soutint si ardemment
les thèses du Frère Augustin mais qui a, fort heureusement, d'autres titres, et
fort beaux, à l'attention de la postérité, prit, dès 1844, la direction de
l'établissement. Il vit bien vite que l'éducation des sourds-muets ne pourrait
se développer convenablement en ces locaux étroits. Sur ses instances, le
conseil général de la Loire-Inférieure acquit le domaine de la Persagotière où,
en 1856, l'Institution départementale des sourds-muets s'installait. Il était
très populaire à Nantes par sa bonhomie, sa simplicité, sa charité surtout, et
cette popularité rejaillit sur l'école. Celle-ci bénéficia de la faveur
officielle et, agrandie, bien aménagée, dotée d'un bon corps professoral, prit
l'allure d'une école-type. Aujourd'hui, le buste du Frère Louis, dont la
mémoire est restée en grande vénération, orne les avancées du portail d'entrée.
Sa bonne figure, aux rides bienveillantes, sourit aux jardins. Ils furent son
œuvre de prédilection. Potagers plantureux, allées aux arbres bien taillés,
bosquets et charmilles, composent autour des sourds-muets de larges plans de
verdure, de lumière, une atmosphère sereine, paisible et riante. Le domaine
longeant la Sèvre nantaise, il a été possible d'appuyer la belle ordonnance
d'une terrasse à la française sur la grâce d'un cours d'eau.
Cependant, ce n'est pas
à la Persagotière que j'ai pu voir en action la pédagogie des Frères, mais à la
Louisière, domaine des Herbiers, où réquisitions d'une part, bombardements de
l'autre, avaient forcé les Frères à se réfugier. Ils s'y étaient entassés,
vaille que vaille, avec leurs élèves, aveugles et sourds-muets. Je n'en ai pas moins
en la vision très complète d'une journée de classes et de récréations.
J'ai été de salle en
salle. Contrairement à mon attente, ces enfants rangés en demi-cercle, face aux
professeurs, ne font pas figure d'êtres mornes et figés. La première impression
est au contraire d'extrême vitalité, qui s'exprime par l'intensité du regard,
la vue étant chez eux le seul sens par lequel passe l'enseignement. Le monde
des idées afflue du dehors dans leurs prunelles attentives. Le souvenir qui me
reste d'un enfant sourd-muet, ce sont ses yeux, comme celui que me laissera un
sourd-muet-aveugle, ce sont ses mains, ici et là instruments de la
connaissance.
Ma seconde impression
dominante, c'est l'absolue et candide confiance dont témoigne, à l'égard du
professeur, le regard de ces enfants. Je sais que je touche ici au tréfonds
d'une éducation fort particulière. Le sourd total, et plus encore le
sourd-muet, a tendance à se pelotonner dans la méfiance et la timidité parce
que son incapacité à s'exprimer, le silence où il est muré l'entraînent à
soupçonner partout quelque ironie toujours prête, quelque hostilité latente,
quelque péril soudain. Qu'on le laisse céder à cet instinct élémentaire, et
c'en est fait de la possibilité de le transformer en un être sociable. Ici, le
sourd-muet se sent aimé. Sans préjudice des sévérités nécessaires, distribuées
d'ailleurs avec circonspection et parcimonie, c'est d'une tendresse vraiment
maternelle et gentiment vigilante que les Frères l'entourent. Ils partagent
complètement la vie des enfants — travaux, jeux, sommeil, prières — ce qui
n'est pas le fait des autres établissements du même ordre. Us sont, pour le
sourd-muet, ceux qui l'éveillent à un monde magnifique qu'il ne pouvait que
pressentir douloureusement, ceux pour qui il n'est pas un monstre en marge, une
bouche inutile mais un être qui absorbe toutes leurs préoccupations, un être aimé[77].
Aussi, qu'un Frère l'invite, d'un signe, à venir auprès de lui pour accomplir
quelque exercice de classe, les yeux s'éclairent aussitôt d'une flamme rieuse
et c'est d'un joyeux fracas de galoches empressées qu'il répond à l'appel. Un
enfant normal peut échapper, échappe souvent de toutes parts, en tout cas pour
une plus ou moins grande partie de lui-même, à son professeur. Mais l'enfant
sourd-muet ! C'est par le Frère, et par le Frère seul, qu'il accède à ce qui fait
la joie et le prix de la vie. Aussi sa petite âme est-elle tout entière dans le
creux de sa main. Cette atmosphère de confiance totale, qui n'est pas un fait
de science, mais d'amour, est fort émouvante. Elle rend compte, en grande
partie, du succès obtenu.
La première classe est
celle de la démutisation. Le sourd-muet dispose de tous les organes de la voix ;
il n'est privé, avant son éducation, que de leur exercice. Il n'est muet que
parce qu'il est sourd. Il s'agit d'en faire un sourd-parlant. Son, tonalité,
sont pour lui des choses privées de sens ; il n'en a même pas l'idée. Pour le
faire accéder à la parole, il faut l'entraîner à faire jouer méthodiquement le
mécanisme des organes, concourant à l'émission de chaque élément de la parole.
L'expérience indique que, pour produire telle articulation ou telle autre, la
langue doit prendre telle ou telle position, les dents doivent être couvertes
ou découvertes, les lèvres serrées eu élargies. Il est ainsi trente-deux
éléments d'articulation, bien entendu associés au souffle, pour le langage
parlé, et donnant quinze images faciales différentes, pour la lecture sur les
lèvres. Le sourd-muet doit s'assimiler cette lecture par un effort de mémoire,
fort ardu, qu'un long exercice transforme peu à peu en habitude. Sur le tableau
figure l'articulation, émise en lettres, que l'enfant est formé à lire ou à
écrire lui-même. Ainsi, démutisation, lecture et écriture vont de pair. Il est
à noter que tout un délicat travail préparatoire a précédé l'action de
démutisation proprement dite. Il porte sur l'éducation de l'attention, des
organes respiratoires, des organes phonateurs. Je ne puis espérer, par ces
indications, affreusement sommaires, que donner quelque idée non seulement des
connaissances théoriques et expérimentales nécessaires au professeur, mais de
la patience et du dévouement qu'exige une telle tâche. Le résultat? En six
mois, ou un an — parfois même en trois mois — l'enfant est démutisé, sait lire
et écrire. Sans doute la voix est rauque, l'articulation souvent tâtonnante, la
tonalité inexistante, mais la merveille est accomplie : le muet parle, il se
fait comprendre. Et sur les lèvres de son interlocuteur il lit la parole.
Mais, ce qu'il articule,
le petit sourd-muet ne le comprend pas. Le langage lui est chose inconnue ; il
ignore jusqu'à son propre nom. On le lui apprend, on lui apprend ensuite le nom
des êtres et des choses qui l'entourent, en les lui montrant ou en les
dessinant. Par la méthode dite maternelle, car c'est bien ainsi que la mère
fait à son enfant, on lui enseigne les expressions du langage correspondant aux
besoins les plus courants de la vie. La méthode intuitive — ou, si l'on veut,
l'enseignement par l'action — lui permet de décrire les petites scènes dont est
faite la vie quotidienne. L'action de la marche, par exemple, accompagne
l'articulation de : je marche. Devenu
un élève conscient, le sourd-muet est entré en même temps dans le cycle de
l'enseignement de la langue française. Par étapes laborieuses, où le procédé
analytique, seul accessible ici, est poussé au paroxysme, où, pour chaque forme
du verbe, par exemple, l'écriture, l'action, l'exemple concret sont appelés à
la rescousse de la parole articulée pour la renforcer et l'éclairer[78],
le sourd-muet apprend, avec le nom, le genre, le nombre et la possession par
l'emploi du verbe avoir et leurs qualités avec le verbe être, enfin
l'utilisation des pronoms. Une fois mis à même de se servir des livres
scolaires établis à son usage, il rejoint les voies quasi courantes de
l'enseignement.
Parallèlement à ces
exercices, lui est donné l'enseignement de l'histoire, de la géographie, du
calcul. Son programme ? En gros, celui du certificat d'études primaires, non
pas absolument cependant celui de l'élève normal, qui n'est pas à la portée du
plus grand nombre, mais un certificat spécial, un peu moins poussé sur certains
points[79].
Il ne faut pas perdre de vue que les Frères de Saint-Gabriel font avant tout
œuvre populaire, que l'école primaire, particulièrement indiquée ici, est leur
objectif sacré, primordial. Ils suivent les traces de l'abbé de l'Epée, dont le
plus grand titre à la reconnaissance universelle, nous l'avons vu, est d'avoir
orienté l'enseignement des sourds-muets dans la voie d'un enseignement
largement populaire et désintéressé.
Leur but pratique étant
de rendre le sourd-muet apte à exercer une profession, à gagner sa vie, à
rentrer enfin, comme un élément utile et actif, non comme un boulet qu'on
traîne, dans le circuit vital et producteur de la société, ils donnent, à côté
de l'enseignement théorique, un enseignement professionnel. Les principaux
métiers, auxquels des ateliers spécialisés forment les sourds-muets sont : la
cordonnerie, la menuiserie-ébénisterie, la forge, la serrurerie, la reliure, la
couture, le dessin. Ceux dont la famille vit à la campagne sont formés à
l'agriculture. Le certificat délivré par les institutions est reconnu par les
entreprises qui embauchent du reste avec empressement les sourds-muets, ainsi
formés. Ils sont d'excellents ouvriers, habiles et consciencieux, que leur
infirmité même, en les gardant des distractions, concentre sur leur métier.
Souvent, les Frères
s'occupent de les placer ; ils les gardent parfois chez eux pour un emploi
simple, quand ils sont peu aptes à être utilisés au dehors. Ceux qui ont pris
métier, fondé famille, gardent avec les Frères un contact constant et
affectueux. Les sourds-muets, sortis de l'établissement, forment entre eux une
association fraternelle qui a son journal, trait de liaison entre eux et leurs
maîtres. Dans les moments difficiles, ils savent sur qui compter. Ils se savent
protégés, durant toute leur vie, par ceux qui les ont élevés.
Le but humanitaire de
l'enseignement professionnel rejoint celui poursuivi par les Institutions
officielles, mais répond aussi à une des grandes directions sociales de
l'Eglise qui veut l'homme soustrait à l'oisiveté avilissante comme au chômage
accablant et installé dans la dignité d'une profession, convenablement
rémunérée.
Les Frères de
Saint-Gabriel, cependant, dépassent ce but de toute la distance qui sépare le
fini de l'infini. C’est vers sa destinée surnaturelle, vers son Dieu qu'ils
conduisent le petit sourd-muet. L'enseignement d'un catéchisme commenté et,
autour de lui, vécu, l'introduit dans le divin royaume où ceux qui souffrent
sont bienheureux. C'est un fait d'expérience que l'enfant s'ouvre à ces
perspectives surnaturelles avec un extraordinaire abandon. Pour des raisons où
ont part sans doute conjointement les effets de sa psychologie particulière
d'enfant fermé aux appels du dehors et l'action mystérieuse de la grâce, il
entre en ces zones supra-terrestres comme en un lieu familier où il trouve ses
délices. Si saisissant est ce fait qu'on pense à la parole de Pascal : « Tu ne
me chercherais pas si tu ne m'avais déjà trouvé. » Ne serait-ce pas que le
silence, clé monastique de l'intimité divine, habite depuis toujours leur
cloître intérieur ?... Quoi qu'il en soit, l'éducation chrétienne, objectif essentiel
des Frères de Saint-Gabriel, est poursuivie ici avec une intensité au moins
égale à celle que connaissent leurs autres écoles et avec un succès peut-être
plus grand parce que plus rapide, plus constant, et plus préservé. Que
rêvent-ils, sinon cela ? La peine de tous les instants qu'ils se donnent et
dont j'ai été le témoin émerveillé, a trouvé, du jour où le petit sourd-muet a
souri à l'amour du Christ, sa récompense.
Sur les six Institutions
des Frères de Saint-Gabriel, quatre, celles de Marseille, Nantes, Bordeaux et
Poitiers, reçoivent et éduquent, outre les sourds-muets, des aveugles dont
l'effectif représente à peu près celui du tiers des départements français, soit
cinq cents aveugles environ sur mille six cents que compte la France. Cent
soixante aveugles, qui viennent de trente-deux départements, sont ainsi instruits
et formés à un métier, dont soixante-dix par la seule Institution de Nantes.
Ils sont surtout entraînés à la musique. Le seul diocèse de Nantes compte
soixante organistes, anciens élèves. Onze Frères sont voués à cette tâche.
Celle-ci ne comporte aucune particularité technique relevant de Saint-Gabriel,
au lieu, que dans le domaine de la surdi-mutité, les Frères ont fait progresser
remarquablement cette pédagogie particulière. C'est que, pour les aveugles, on
en est partout au Braille, et à des méthodes de calcul et d'écriture,
pratiquées depuis longtemps et qui, comme le Braille, ne semblent guère
perfectibles. J'ai pu seulement remarquer, à Poitiers comme à Nantes, que, si
on fait ailleurs aussi bien que chez les Frères, on ne fait pas mieux.
L'orientation professionnelle, la formation à un métier sont très poussées dans
les Institutions gabriélistes et j'ai vu le directeur de celle de Bordeaux, un
de nos meilleurs spécialistes dans la rééducation des aveugles, se préoccuper
beaucoup des formules les plus modernes de la post-scolarité, celles qui
tendent à rapprocher le plus possible les aveugles du standing normal. L'ordre
de supériorité des Frères est cependant ailleurs. Je le trouve et l'admire dans
le fait que le professeur des aveugles, comme celui d'ailleurs des sourds-muets
et des pensionnats, donne à son élève toute sa vie quotidienne. Dans
l'ensemble, il se trouve, comme éducateur, sur un terrain plus difficile et
plus complexe que le professeur des sourds-muets. L'aveugle ne veut pas être
considéré comme un infirme. — « Madame, je ne suis pas plus malheureux que vous
», disait l'un d'eux à une dame qui s'apitoyait à voix haute — et cependant il
est un infirme. Par surcroît, il est plutôt méfiant alors que le sourd-muet est
d'une confiance ingénue et totale. Le dévouement des Frères, l'amour surnaturel
dont ils entourent leurs enfants, leurs jeunes gens, leur fait trouver auprès
de ces âmes un peu ombrageuses les mots qui les attirent au lieu de les
rebuter. Par touches délicates, ils arrivent à provoquer, chez certaines
d'entre elles, d'admirables ascensions.
Un effort sérieux, mais
moins vaste et moins organisé, est fait également au profit de ceux qui sont
atteints de troubles de la parole : bégaiement, zézaiement ou autres. Certains,
s'ils sont des enfants, peuvent être, mais exceptionnellement, reçus dans les
Institutions. Les jeunes gens y peuvent suivre dans la période des vacances des
cours de phonétique. Tout cela est encore à l'état embryonnaire[80].
Mais la tendance, en haut lieu, va à organiser, sur de larges bases, cette
section intéressante. Cela est d'autant plus souhaitable que l'expérience de la
guerre 1914-1918 a fait d'excellents techniciens des Frères qui furent associés
aux spécialistes dans les centres de rééducation phonétique et auditive que
devinrent alors les Institutions de Saint-Gabriel.
Avant de pénétrer dans
ce monde, si nouveau pour moi, des Sourds-Muets et des Aveugles, je m'attendais
à une vision triste. Je me suis trouvé au contraire dans un climat d'optimisme.
Certes, le malheur de telles disgrâces physiques ne se laisse pas oublier, mais
il est comme recouvert et transformé par le double élan d'une action
pédagogique qui, jour par jour, poursuit son œuvre de libération et de la joie
confiante d'intelligences qui surgissent, chaque jour, à une lumière accrue. À
l'entrain souriant des professeurs répond un effort plein d'allègre avidité, et
tout cela dans une atmosphère familiale où l'âme s'épanouit, où l'esprit se
détend, où le cœur se livre sans contrainte. Cela est sensible à chaque détail
de la vie scolaire. Tel jour, j'assistais à une dictée. Celle-ci achevée, le
professeur réclama les ardoises pour me les montrer ; je me trouvai, en un clin
d'œil, environné d'une douzaine d'ardoises, brandies à bout de bras, tandis que
les jeunes visages s'éclairaient de l'ardente attente d'un compliment[81].
Le préau des récréations n'est pas moins vivant que celui d'un collège
ordinaire et la mimique rapide des élèves qui s'interpellent en leur langage de
gestes y ajoute je ne sais quelle note d'animation passionnée.
Il est cependant, à
l'Institution de Poitiers[82],
à côté des Sourds-Muets et des Aveugles, une section que l'on ne peut visiter,
sans que le cœur en reste douloureusement serré, malgré les merveilles de
résurrection qui s'y opèrent aussi. Elle comprend ceux-là qui ne peuvent plus
communiquer avec le double univers — celui de la matière et celui de l'esprit —
que par le sens du toucher : les Sourds-Muets-Aveugles.
Le Frère Louis-Auguste,
directeur de l'Institution, plus connu sous le nom séculier de M. Douillard,
fonda cette section, parallèle à celle des Sourdes-Muettes de Larnay,
qu'illustra la Sœur Marguerite. Elle est unique en France, en tant qu'œuvre à
l'usage des garçons, et ouverte à toute la France. Le premier sourd-muet-aveugle
admis fut, le 21 février 1925, Bernard Buez. M. Douillard entendit prendre à
charge lui-même cette rééducation. Il employa la méthode de Sœur Marguerite,
mais la perfectionna. Le résultat, on le verra, est saisissant. Il est tout à
la gloire de M. Douillard et de Saint-Gabriel. L'œuvre a traité vingt-et-un
sourds-muets-aveugles depuis sa fondation; elle en rééduque présentement sept.
Jamais ne me quittera la
première vision que j'en eus. Quand je pénétrai dans la salle, qui leur est à
la fois de récréation et de travail, un seul s'y trouvait, un Oranais qui
répond au nom de Trébès. Ce garçon de vingt ans, quelle loque ! Sur une chaise,
adossée au mur blanc, il reste assis, tassé sur lui-même, en une sorte
d'accablement morne. Quelques mouvements, qui semblent hantée d'une folie
calme, révèlent seuls le vivant. Tantôt il mordille sa main; tantôt ses bras,
en un geste qui fait mal, rament à vide comme s'ils cherchaient à appréhender
quelque chose qui le fuirait dans une implacable nuit. On dirait d'une silhouette
hallucinante de Goya. Entré dans l'Institution à neuf ans, on a pu, à grand
peine, éveiller en lui, par le langage des doigts, la connaissance et la
signification de quelques courtes phrases, puis son développement s'est
brusquement arrêté et tous les efforts sont restés vains d'une science
expérimentale consommée comme de la plus pitoyable charité. Il obéit à quelques
commandements, avec les trois ou quatre cents mots qu'il sait — et qu'il a
retenus, car en lui, inexplicablement, la mémoire a échappé au naufrage de son
être pensant : « Lève-toi !» Il se lève. « Marche. » Il marche. « Ouvre la
porte. » Il l'ouvre. « Rassieds-toi. » Il se rassied, il redevient l'être
informe, élémentaire, réduit à une vie végétative qui se traduit, aux repas,
par une voracité animale. L'idiotie est sans doute venue compliquer l'infirmité
initiale. A la question qu'il pressent en moi, le Frère Directeur répond qu'en
ce malheureux, la capacité de souffrance morale elle-même semble bien abolie.
L'âme, dans le corps toujours vivant, qu'est-elle devenue ? Les prospections
psychologiques et métaphysiques défaillent ici. Il n'est que de penser cette
nuit profonde habitée par la miséricorde de Dieu, en attendant que l'emplisse
l'éternelle lumière de la connaissance béatifique.
Mais voici qu'arrive,
aux côtés du Frère F..., seul actuellement à s'occuper de cette section,
Richard Schmitt, ce sourd-muet-aveugle dont le cas est aussi célèbre, dans les
milieux spécialisés, que celui de Marie Heurtin à l'Institution voisine de Larnay.
Dès le premier abord, je m'enchante de sa vitalité intelligente et affectueuse.
H savait que je devais venir, il m'attendait et aussitôt s'a main cherche ma
main, avec une cordiale curiosité ! Expansif, souriant, gentiment malicieux, il
m'impose une image qui contraste violemment avec celle du malheureux Trébès,
qui, à deux pas, dodeline toujours de la tête contre le mur blanc. Richard,
c'est l'expérience dans sa plénitude, le résultat péremptoirement victorieux,
le triomphe des efforts conjugués de la science et de la charité. Il a seize
ans. Il est sourd-muet de naissance et aveugle depuis l'âge de treize mois.
C'est dire que, pratiquement, nulle connaissance du monde extérieur ne lui a
été léguée par la mémoire visuelle ou auditive. Quand il arriva, à sept ans, on
vit bien vite qu'on avait affaire à une nature douée, trépidante et déjà
débrouillée. Il avait témoigné, dans la maison familiale, d'une grande
précocité, ayant beaucoup gagné à la compagnie de petits cousins, dont il était
l'inséparable et que, autoritaire, il voulait toujours faire plier. Avec eux,
il allait à la pêche, à la promenade, à la cueillette des noisettes, à la fête
du village où il montait avec ivresse sur les chevaux de bois. De tout son
instinct, il voulait vivre ; son intelligence alerte, curieuse, ne demandait
qu'à sourdre, à se manifester. Du signe à la chose signifiée, il percevait vite
le rapport. Lui prenait-on son couteau? Il faisait le signe de couper pour
qu'on le lui rendît. Nature ardente et même violente, quand il se fâchait, il
brisait tout. Apaisé, il faisait des lèvres le claquement du baiser, car c'est
un bon petit cœur, prompt à regretter d'avoir causé quelque peine.
Il fut démutisé en trois
mois par le Frère R... Ses progrès furent rapides. Une quinzaine de leçons,
d'une durée de dix minutes chacune, et il possédait son alphabet des signes.
Une bonne santé l'aida à progresser intellectuellement et aussi la curiosité,
lot commun des sourds-muets-aveugles intelligents, mais chez lui, poussée très
loin. A l'âge où je le rencontre, elle ne l'a certes pas quitté! Ayant pris en
main mon stylo, il n'a de cesse qu'il n'en ait démonté et remonté le couvercle.
Comme il sait que je suis venu en auto, il s'enquiert si j'ai conduit moi-même
et, sur une réponse négative, qui l'a conduite, d'où est le chauffeur. Tout
enfant, il cherchait, dans la cour qu'enveloppait la chaleur de l'été, à
toucher le soleil et, à cet effet, se haussait sur ses pieds. La vie extérieure
qu'il ne voit pas, il est sans cesse avide, à propos de tout, de se la figurer.
Palpait-il un radiateur, il cherchait à tâtons, dessus, dessous, d'où pouvait
venir la chaleur. Il réagit sur ce que ses mains lui livrent du monde avec une
célérité et une sûreté étonnantes. Durant l'occupation, il se trouva en tramway
avec le Frère Florentius. Près de lui vinrent s'asseoir des officiers
allemands. Sa main, d'un geste instinctif, palpa ses voisins ; tombant sur
l'épaule, elle perçut les épaulettes et, du même coup, le sursaut de
l'Allemand. Il retira prestement la main, mit un doigt sur sa bouche, puis
traça aussitôt des signes où le Frère lut : « Ce sont des Boches. » La concordance
ou la discordance d'un élément nouveau avec ceux qui lui sont déjà familiers le
frappe instantanément. Comme on lui dit que tel visiteur s'appelle M. Bureau,
il s'exclame : « Ce monsieur est fou : un bureau, c'est un meuble. »
Une intelligence aussi
agile et avide, le Frère F... en freine plutôt qu'en excite l'exercice. Avec
les sourds-muets-aveugles, il importe de ne pas aller trop vite. Les progrès
doivent se faire sur des étapes bien mesurées. Il ne faut pas encombrer la
mémoire, mais au contraire revenir sans cesse sur ce qui a été appris,
enchaîner, enchaîner sans trêve.
A l'âge où je le rencontre,
c'est un jeune garçon robuste, bien équilibré. Le visage n'est pas beau, mais
ouvert, sympathique et, malgré les yeux absents, très expressif. Il aime à
plaisanter. Sa prédilection pour la taquinerie, il l'exerce volontiers sur le
Frère F... qui le prend du même ton et ce sont, de l'un à l'autre, des parties
de rire interminables. Il a, me dit le Frère, un sens du commandement
extrêmement développé, une volonté de chef. Cela se traduit par des éclats, parfois
très violents, mais brefs et avec des retours charmants. Les traits de son
caractère qui se sont le plus vite éveillés, c'est le sens de l'émulation, la
générosité, le regret de ses caprices. Sa nature est aimante et expansive.
Avec une aisance remarquable
qui faisait dire à l'aumônier de l'Institution : « Richard a le sens du
surnaturel, Dieu lui donne des grâces particulières », Richard accéda à la notion
du bien, du mal, à la connaissance de Dieu. Au début, comme son professeur lui
dit que Dieu est partout : « Dieu a-t-il un avion ? » fait-il. Mais bien vite
ses conceptions religieuses se dématérialisent. A l'égard de Jésus, il arrive à
la ferveur, à l'amitié. Un jour qu'il s'est mis en colère, le Frère F... lui
dit : « Jésus n'aime pas Richard. » Et le voilà soudain triste et pensif. Il
monte dans sa chambre et, ayant décroché son crucifix, le pose sur une table,
et reste devant lui, immobile et les mains jointes, durant vingt bonnes
minutes, puis il embrasse le crucifix, le remet en place. Il dit ensuite au
Frère : « Jésus, maintenant, est-il mon ami ?» Sa première communion fut pour
lui un jour dont il comprit parfaitement le sens, le prix, la surnaturelle
portée.
Si saisissant que soit
le cas de Richard Schmitt, Bernard Ruez me permet de pénétrer plus avant encore
dans l'œuvre qui se fait ici. Jusqu'à sept ans, c'était un enfant normalement
constitué. Il n'échappait au commun que par une intelligence d'une si
extraordinaire précocité que son père, un homme fort distingué et un ingénieur
de valeur, disait de lui : « Oti ce sera un homme de génie, ou une méningite
l'emportera. » De ses sept ans, Bernard attendait comme la révélation d'un
monde enchanté. Quand il les atteignit, il s'écria, transporté de joie : « J'ai
mes sept ans. Papa me les a donnés. » Hélas ! ce fut aussitôt l'accident : un
instrument qui, d'une charrette, tomba sur le crâne de l'enfant, la terrible
méningite qui s'ensuivit et le laissa sourd et aveugle. Les organes de la
parole étaient eux-mêmes si atteints qu'à son entrée à l'Institution de
Poitiers — il avait dix ans — ils ne produisaient que des sons inarticulés. Il
fallut le rééduquer par les méthodes ordinaires de la démutisation.
La surdi-muti-cécité,
dans son cas, recule vraiment les limites de l'infortune. Jusqu'à sept ans,
Bernard a vu, il a entendu, il a parlé. Il fait la beauté de l'univers visible,
l'intérêt des découvertes visuelles, les douceurs ailées de la musique, la
chaleur de la voix humaine, l'intérêt et le charme des conversations. Doué
d'une intelligence que je crois supérieure et qui eût, peut-être en effet, tourné
au génie, si elle avait bénéficié de tous les moyens humains, d'une
intelligence du type spéculatif et méditatif sans cesse en activité, d'une sensibilité
très vive et d'un tempérament passionné, il est puissamment équipé pour
explorer, dans la nuit où il baigne tout entier, la nature et l'étendue de son
malheur et en souffrir jusqu'à l'exaspération. Si le cas de Richard pose de
façon plus complète, plus typique, le problème physiologique de sa triste
infirmité, le cas de Bernard, plus que le sien, en exprime le problème moral.
Par un surcroît de
misère qui confond, c'est un grand malade incurable. Lui-même écrivait à un ami
: « Ma personne est le domicile inclus d'infirmités multiples dont, pour
certaines, j'ignore même le nom. Mon entourage les appelle par exemple : mal de
Pott, tuberculose osseuse, décalcification, atrophie... » De fait, ce sont bien
ces terribles maux qu'évoque immédiatement à l'esprit la vue de ce corps
malingre, souffreteux, déformé, claudicant. Mais, bien vite, le visage s'impose
et l'on ne voit plus que lui : le front est vaste et la physionomie, privée
pourtant de la lumière des yeux, révèle l'intelligence et l'intensité de la vie
intérieure. En cet être, plus mal conformé pourtant que Trébès lui-même, une
distinction singulière s'obstine et s'impose, qui vient de l'esprit
tout-puissant. De fait, c'est par l'esprit qu'il trouve sa plus précieuse et
consolatrice évasion. Il dévore des bibliothèques de Braille. J'ai sous les
yeux la liste de quelques-unes de ses lectures : elles vont de Huysmans (Sainte Lidwyne de Schiedam) à l’Histoire religieuse de la Révolution
française de Pierre de la Gorce, de la Chanson
de Roland de Léon Gautier au Robinson
Crusoé, du Saint François-Xavier
de Bellessort à la Géographie humaine de
Bruhnes, du Renouveau catholique dans la
littérature contemporaine de J. Calvet aux Lettres de mon Moulin, de la Vie
du curé d'Ars, par Trochu, à la Vie
intérieure du P. Sertillanges...
De pair avec la lecture
va la conversation ; il est avide de l'échange d'idées, notamment sur la
dernière guerre mondiale dont il est informé à fond et dont, je le verrai tout
à l'heure[83],
il possède la géographie mouvante. Les thèmes intellectuels l'enchantent. Avec
le Frère F..., Bernard cause infatigablement. Je discerne mal son langage, la
voix étant rauque et volubile à l'excès, mais il est fort clair au Frère.
Celui-ci répond avec ses doigts qui, avec une incroyable rapidité, dessinent
les signes alphabétiques sur la main juxtaposée de son interlocuteur. C'est un
colloque animé, nourri d'informations, de connaissances, de vues personnelles.
Mais voici qu'ils décident de faire une partie d'échecs ; les échecs, la
troisième porte favorite de la bienheureuse évasion, les échecs, le plus
intelligent des jeux !...
Les cases du damier sont
en saillie et percées de trous, les pions munis de pointes qui s'enfoncent dans
les trous pour que le geste des mains ne les bouscule pas. Ceux de Bernard sont
en outre pourvus à leur sommet d'une tête de clou ronde qui les lui fera
distinguer de ceux de son partenaire. Le» voilà, face à face. « La bataille
commence », fait Richard, car Richard est là qui s'intéresse au jeu. Il n'en
voit rien, mais il sait qu'on joue, et cela l'intéresse. Tout le long de la
partie, il restera auprès des joueurs, immobile. Sa pensée travaille et je le
verrai parfois qui rit et se frotte les mains joyeusement. Une image agréable
l'a traversé. Laquelle ? « Il sait qu'il est entouré d'amis, me dit le Frère,
il y pense : alors il est heureux. » Et les mains, sur les pions, de poursuivre
leur ronde, celles du Frère, celles de Bernard, qui semblent se poursuivre, en
un fantastique chassé-croisé. Par le toucher, Bernard discerne le coup de son
partenaire, tâte les pions adverses, repère ainsi leur position, dont il garde
étonnante mémoire. Puis, à son tour, il risque sou coup, fort bien calculé...
Ah ! ces mains, ces mains agiles, longues et nerveuses, par lesquelles tout est
reçu, tout est transmis, ces mains qui s'allongent, se rétractent et jouent des
doigts comme sur un clavier invisible, ces mains auxquelles on pourrait
appliquer tous les qualificatifs de l'esprit, ces mains qui pensent, qui vivent,
qui écoutent, qui se souviennent, qui calculent, ces mains intelligentes, ces
mains par quoi se reconstitue et s'anime un univers éteint...
Ces deux êtres —
Bernard, Richard — que leur affreuse infirmité semblerait devoir réduire à une
morne passivité, sont au contraire deux personnalités fortes, actives,
exigeantes. Même compte tenu de la différence d'âge — Richard a seize ans, Bernard,
près de trente — celle de Bernard est nettement d'un intellectuel, celle de
Richard, d'un garçon intelligent, doué, maie sensible surtout à ce qui est du
monde extérieur. Des traits communs les marquent, comme d'ailleurs tous les sourds-muets-aveugles.
Et d'abord, une extrême nervosité ; elle s'exprime en gestes saccadés, rapides,
on dirait volontiers « volubiles », tant le geste, chez eux, s'apparente au
langage. C'est par là encore qu'ils traduisent une joie dont l'intensité nous
surprend, nous déroute. On en vient à se demander si les manifestations
passionnées de cette joie sont bien au diapason du sentiment intérieur. Mais
oui ! Il en est bien ainsi. Richard, Bernard et leurs pareils vivent dans une
nuit perpétuelle et silencieuse, que rien ne distrait venant du dehors. Aussi,
vienne une joie, elle emplit démesurément leurs solitudes intérieures. Mais la
consolation des consolations, Bernard la trouve dans la vie religieuse qu'il
pratique, comme il fait toute chose, en profondeur, avide là encore de
comprendre ce qu'il aime, d'en nourrir non seulement son cœur, mais son
intelligence. Ce raccord à l'éternité, où leurs sens retrouvée baigneront en
Dieu, c'est la suprême espérance dont leur nuit s'illumine[84].
Un besoin continuel,
presque fébrile, d'occupation les possède. Inoccupés, ils deviennent sombres,
car ils sont alors happés aussitôt par la conscience de leur infortune, par le
tourment que l'action seule fait oublier, action de lecture, de conversation,
d'étude ou de jeu. Qu'on leur parle de « faire quelque chose », leur figure
aussitôt se détend. D'où la nécessité de les entretenir sans cesse, de les
distraire, de les sortir d'eux-mêmes, de ne jamais les laisser seuls. Astreinte
à peine imaginable ; elle suppose l'abnégation d'un professeur qui soit un
religieux, totalement renoncé, dont l'amour de Dieu et des âmes est le royal
secret. Certes, il est, pour Je professeur des sourds-muets-aveugles comme pour
celui des sourds-muets, des compensations admirables. Leur travail pédagogique
est d'un intérêt puissant; il fait surgir un enfant des limbes maladifs de la
subconscience à la pleine lumière d'une intelligence formée ; à leurs élèves,
ils donnent plus que la connaissance : l'instrument de la connaissance; ils les
soustraient à une solitude sauvage pour les rendre à l'activité de la vie
sociable et productrice, et cela, non selon un formulaire figé, mais par des
méthodes sans cesse perfectibles, par un empirisme personnel qui les mène à des
découvertes incessantes, à des observations neuves. C'est une science que l'on
peut bien, pour la commodité, codifier dans un livre, mais ce n'est pas une
science de manuel, c'est une science en pleine vie, qui se fait tous les jours,
et prend avec chaque individu un caractère particulier, réclamant à chaque instant
les ressources combinées de l'observation, de l'expérience, de l'intuition. Il
y a encore, consolation très douce, l'attachement immense de l'enfant pour son
professeur, véritable père pour eux puisque — et ils en ont conscience — il les
engendre à la véritable vie. Un petit sourd-muet confiait au Frère professeur :
« J'ai pleuré cette nuit. — Pourquoi ? — Parce que j'ai rêvé que vous étiez
parti. » Enfin, il y a, je l'ai dit, la joie qui passe toute autre et qui est
d'éveiller ces âmes qui, sans eux, resteraient matérialisées, à la connaissance
et à l'amour de Dieu. Ils sont par là les véritables missionnaires d'un no man's land pathétique, d'une
terre vierge, inconnue, d'une véritable brousse, qu'ils transforment en un beau
parc à la française, empli des images du ciel. Mais tout cela est payé d'une
patience, d'une mortification, d'un don de soi, dont la tension continue laisse
rêveurs les passants légers que nous sommes.
Cela est deux fois vrai
du Frère chargé des sourde-muets-aveugles. Celui-là a sa vie littéralement
identifiée à la leur ; il est pour eux le père, la mère, le frère, l'ami et
plus encore : l'irremplaçable, puisque par lui, et par lui seulement, ils ont
accès au monde. Qu'il-vienne à leur manquer, par impossible, ce serait pour eux
le désespoir et comme la chute, sur leur vie misérable, de la pierre du
tombeau. Le don que le Frère leur fait de lui-même se hausse, de façon sublime,
à la mesure de cette exigence totale. Il sait qu'on les prend par le cœur plus
que par l'esprit. Alors il leur donne tout son cœur. Leur joie est sa joie ; et
sa tristesse, leur tristesse qu'il guette sans cesse et disperse, sitôt perçue.
Je sais un de ces Frères qui jamais ne prend de vacances pour ne les point
quitter : « Ils seraient trop malheureux, dit-il simplement, si je n'étais
pas là. » Car je ne dois pas, je le sais, m'abuser sur leur gaîté dont j'ai été
le témoin ; elle est sincère, jaillissante et, grâce au Frère, alimentée tout
au long du jour, mais sans cesse menacée. Les plus profonds, les plus doués,
tel Bernard, connaissent, en certaines introspections douloureuses, de
véritables révoltes. « J'ai souvent, écrit l'un d'eux, des moments sombres,
des idées noires, des crises d'impatience et de fureur où j'accuse la
Providence de n'être pas favorable, Dieu de trop m'éprouver et comme de
m'oublier, où je m'en prends à tout, même à souhaiter n'avoir pas été créé,
d'être resté dans le néant ou qu'une autre destinée m'eût été octroyée, voire
même que la mort m'ait déjà fauché. »
Et cependant ces crises,
où tout semble devoir sombrer, sont surmontées avec un succès où il faut voir
sans doute l'effet d'une magnifique énergie, mais aussi d'une grande vertu.
Celui-là même, dont je viens de citer l'aveu émouvant, se hausse, dans
l'ordinaire de sa vie intérieure, jusqu'à cette idée de rédemption de soi-même
et des autres par la souffrance, qui est bien le sommet du christianisme, celui
du Golgotha. Il ne m'est pas permis de transcrire ici tout ce qui m'a été conté
par le Frère F..., dans une conversation intime, la veille de mon départ de
l'Institution de Poitiers, tandis que la maison était déjà rentrée dans le
grand silence de la nuit. J'en dirai simplement que j'ai entrevu, à travers „
ses propos, à quelles profondeurs admirables atteint, avec sa simplicité coutumière,
l'esprit de Saint-Gabriel en son œuvre des sourds-muets et des sourds-muets-aveugles.
Il en a fait le plus beau témoignage qui soit de l'existence de l'âme
immortelle.
De l'âme, non « en
prison », comme il a été dit, mais délivrée.
II - UN PENSIONNAT RÉGIONAL : A
SAINT-LAURENT-SUR-SÈVRE
Bien que l'objectif
spécial des Frères de l'Institut de Saint-Gabriel soit de s'occuper des enfants
du peuple dans les écoles primaires, ils n'en doivent pas moins se dévouer, aux
termes des constitutions, à l'éducation et à l'instruction chrétiennes de la
jeunesse en général. A cette tâche, ils n'ont pas failli. Sans parler de leur
effort scolaire à l'étranger, ils dirigent actuellement en France dix-sept
établissements, d'importance inégale, où leur enseignement dépasse largement la
zone du primaire pour atteindre et englober le secondaire moderne.
Ils en comptaient bien
davantage avant la loi de proscription de 1903 parmi lesquels, notamment à
Lille, à Nogent-sur-Marne et dans le Midi, des pensionnats florissants. Et si,
actuellement, sur dix-sept pensionnats ou externats qu'ils ont en France, dix
affectent les seules régions de Bretagne et Vendée, cette forte proportion est
due à la ferme attitude de la Maison-Mère, sise à Saint-Laurent-sur-Sèvre, au
cœur de la Vendée militaire et qui, en sauvant son propre pensionnat, sauva du
même coup les maisons des pays de Sèvre et de Loire, avec celles de Bretagne.
La région du Nord conserve deux établissements, le Centre quatre, la région
parisienne un.
Voilà pour la répartition
géographique. Dans l'ordre des études, ces collèges sont, dans l'ensemble, de
primaire et primaire supérieur. En cinq d'entre eux, est professé
l'enseignement technique qui leur donne rang d'écoles professionnelles. Un
autre est voué à l'enseignement agricole : la notoire école d'agriculture de la
Mothe-Achard. Enfin, il en est trois — mais ce chiffre sera très prochainement
dépassé — qui comportent l'enseignement secondaire moderne : celui de la
Mothe-Achard à l'usage des scolastiques de l'Institut, celui de
Saint-Laurent-sur-Sèvre, enfin celui de Bagneux-sur-Seine.
J'ai visité avec
ravissement le collège de Bagneux. C'est un fier bâtiment, battant neuf, qui
chante au soleil de tous ses murs de briques roses où s'ouvrent de haut en bas
de larges baies vitrées. Sa situation corrige ce qu'a d'exagérément standardisé
et géométrique l'architecture moderne. Il se dresse sur le bord d'un plateau,
d'où la vue s'élance, enchantée, au long des sinuosités bleutées de la vallée
de Chevreuse ; par larges plans, des collines composent, associées au ciel
lumineux et léger, un des plus beaux paysages de l'Ile-de-France. Celles du
premier plan sont coiffées de ces villas de Fontenay-aux-Roses, à demi
dissimulées par les arbres, qui abritent ce type de bonheur paisible et un peu
engourdi, parmi les potagers et les lilas, où se complaisent les Français
moyens, atteints par la soixantaine. Le collège est flanqué d'un beau parc et
d'un château qui sont la propriété de campagne des archevêques de Paris. Il est
d'ailleurs bâti sur cette propriété même ; il est diocésain, né d'une heureuse
pensée du cardinal Suhard qui a voulu un pensionnat d'enseignement secondaire
pour cette banlieue parisienne et des Frères de Saint-Gabriel pour le diriger.
Ainsi s'est constitué un des collèges les plus florissants de l'Institut : il
compte 250 élèves et ainsi fait son plein. Pensionnat, demi-pensionnat et
externat, il prépare au certificat d'études primaires, au brevet et au
baccalauréat. J'ai vu s'ébattre les élèves en récréation. Comme ils diffèrent
des petits gars de Vendée et des pays de Loire tels que je les ai surpris dans
leurs jeux à Saint-Laurent-sur-Sèvre ! Intelligent et vif, le jeune Parisien
est aussi très frondeur, indiscipliné, et peu prodigue des « marques
extérieures du respect », à l'inverse des petits Vendéens, formés, par une
forte tradition familiale, au sens de l'autorité et de la hiérarchie des
valeurs. Cependant, dans l'ensemble, les professeurs, venus des pays d'Ouest,
se sont acclimatés. Ils s'accommodent à leur petit peuple, sympathique et
turbulent.
Mais, c'est au
pensionnat de Saint-Laurent-sur-Sèvre que j'entends chercher la caractéristique
de la pédagogie des Frères. Il m'a été donné de l'observer de près pendant plus
de quinze mois, et l'on ne parle justement que de ce qu'on connaît le mieux.
J'ai bien d'autres raisons, d'ailleurs, de le détacher de la série. N'est-il
pas lié aux origines du stade autonome de l'Institut, étant né sous le Frère
Augustin? N'est-il pas le plus important de Saint-Gabriel et, d'ailleurs, un
des plus importants de tout l'enseignement libre, avec ses huit cent soixante
internes ? Enfin, j'allais dire : surtout, ne réalise-t-il pas le type du
pensionnat, recevant de la région même, si profondément caractérisée, ses
traits majeurs, et se prolongeant dans la vie régionale, bien au delà du temps
de scolarité ? A mon sens, les Frères de Saint-Gabriel ont réalisé là une
expérience pédagogique vraiment originale, et riche en perspectives d'avenir
comme en résultats acquis.
L'ambiance y joue un des
grands premiers rôles. Qui a vécu quelque temps à Saint-Laurent-sur-Sèvre le
comprend sans peine. Il y faut, à vrai dire, quelque ascétisme, un certain
détachement des valeurs mondaines et le sens des fins dernières. Saint-Laurent
est un bourg tout en coulée sur un des coteaux qui bordent la Sèvre nantaise à
peu près au centre d'une région signifiée au nord par Cholet, au sud par Les
Herbiers, à l'ouest par Mortagne, à l'est par Châtillon. Le bourg serait de la
plus médiocre importance, s'il n'était — phénomène unique en France — du moins
en un lieu si modeste — le siège des Maisons-Mères de trois puissantes
congrégations. Leurs domaines respectifs enserrent de leurs bâtisses, de leurs
jardins, de leurs prés, de tous leurs hectares pressés, les maisons particulières,
aux jardins exigus, qui mènent une vie anémiée et discrète à l'ombre de ces
féodalités ecclésiastiques. Sur les 2.000 habitants de Saint-Laurent, 800 sont
des religieux et des religieuses. La paroisse elle-même n'échappe pas à
l'emprise, le curé et le vicaire y étant traditionnellement des missionnaires
de la Compagnie de Marie. L'église paroissiale a des proportions de basilique
et elle est en effet un monument de portée universelle puisque le grand apôtre
de l'Ouest, Grignion de Montfort, y repose sous la dalle de son tombeau. Bien
que ce lieu soit de pèlerinage et appelé à le devenir de plus en plus, il ne
s'y trouve et ne pourra jamais s'y trouver quelque chose qui ressemble aux
caravansérails et déploiements de pieuses boutiques dont Lisieux ou Lourdes
sont encombrés. Où donc pourraient jeter leur dévolu les entrepreneurs de ces
kermesses permanentes sans se heurter à quelqu'une des possessions
territoriales des Filles de la Sagesse, des Frères de Saint-Gabriel ou des
Pères de la Compagnie de Marie ? Rien donc ne vient altérer l'austérité du
lieu. C'est la Ville sainte de la Vendée. Je ne la prétends point soustraite
aux entreprises des sept péchés capitaux, mais la foi robuste des habitants,
leur assistance massive aux offices, leur vie sacramentelle intense, jointes à
la présence muette d'un millier de religieux, et d'un millier d'enfants internes
lui donnent un cachet unique. Des clochers pointent de toutes parts vers le
ciel et égrènent, sur les maisons, humblement tassées dans l'humilité de leur
condition séculière, leurs sonneries joyeuses ou mélancoliques. Il semble que
la vie des laïcs s'accorde instinctivement au rythme de la vie monacale. Nul
jour de fête ici qui ne soit répercussion ou de la vie liturgique ou d'une cérémonie
conventuelle — prise d'habit, profession à la Sagesse, par exemple — ou d'une «
sortie », d'une représentation théâtrale à Saint-Gabriel. Ainsi les élèves du
pensionnat ne voient-ils rien qui ne soit le concentré de la Vendée
traditionnelle, dont ils ont déjà recueilli en leurs foyers les images, plus
dispersées, mais à peine moins austères. Il n'est à peu près rien, dans la vie
extérieure du bourg, dont les éducateurs de Saint-Gabriel aient à défendre
leurs enfants, et il s'y trouve tout ce qui les peut maintenir dans la
tradition familiale.
Il est dans la destinée
de Saint-Laurent-sur-Sèvre d'être immuable. De fait, le bourg était tel quand
l'essaim des Frères enseignants, conduits par le Frère Augustin, s'installa à
la maison Supiot. Or le pensionnat naquit peu de mois après cette installation
: on prit d'abord un enfant, payant pension pour suivre les leçons de l'école
primaire de Saint-Laurent, puis deux. On se trouva de la sorte en avoir bientôt
une douzaine. La question d'un pensionnat en règle était posée. « Faut-il aller
de l'avant ? » demanda le Frère Augustin au P. Deshayes. Et celui-ci, toujours
entreprenant, de répondre : « Continuez. » Le Frère Augustin se donna la
charge de directeur titulaire qu'il garda jusqu'à la fin de son généralat en
1852. Mais il était pris par trop de tâches à la fois ; le directeur effectif
fut le Frère Michel, une belle figure d'éducateur à l'autorité ferme et au
grand cœur. Le Frère Abel, le Frère François-Marie, le Frère Ildefonse se
distribuèrent l'enseignement qui correspond à peu près au brevet simple
d'aujourd'hui. Le Frère Siméon, alors premier assistant, est chargé des
exercices de piété ; sa bonté, sa sainteté rayonnent ; son âme candide et
charmante, emplie d'une dévotion tendre à l'Immaculée, est comme une
cassolette, d'où s'échappe un encens perpétuel ; le pensionnat en est tout
embaumé. Belle équipe qui donna dès le début à Saint-Gabriel son trait
essentiel qui est d'être une vraie famille, de piété solide et limpide, et dont
les rapports sont empreints de franchise et de simplicité. La Vierge sourit aux
enfants. Depuis le 8 décembre 1842, elle est officiellement la patronne de la
maison.
Quand, en 1852, le Frère
Michel prend la direction officielle du pensionnat, celui-ci compte 187
pensionnaires. En 1860, il en abrite 220, tous fils de paysans, de commerçants,
d'artisans. L'enseignement s'adapte au milieu, tendant à faire de ces enfants,
plus tard, une élite dans leurs bourgs, dans leur profession. Dessin, tenue des
livres, géométrie, sont introduits au programme ; ainsi l'on pense au métier.
Mais aussi on ajoute, aux humbles matières du début, de la littérature, de la
philosophie, l'histoire de la Grèce et de Rome. Le souci de la culture générale
se manifeste par là. Un cours supérieur est constitué qui correspond assez bien
à notre brevet supérieur. D'année en année, des terrains sont achetés, les
bâtiments s'agrandissent, de nouvelles constructions s'élèvent. La réputation
du pensionnat s'accroît dans toute la région. Les anciens commencent à former
un peu partout, en Vendée, de solides cohortes d'amitiés. L'esprit des élèves
est parfait. Quant aux Frères professeurs, ce sont d'excellents religieux,
fermés au bruit du dehors, tout à leur affaire qui est le collège et les
enfants. Ils forment par ailleurs un corps de pédagogues éprouvés, haussant
sans cesse leur équipement intellectuel, très modeste au début ; plusieurs
d'entre eux, pour remédier à la rareté des manuels, composèrent toute une
collection de classiques, adaptés au mode d'enseignement de la maison.
Et voici qu'en 1868, le
Frère Hormisdas prend la direction du pensionnat qu'il gardera jusqu'en 1880.
C'est, dans une galerie où nul ne démérite, un des directeurs dont
Saint-Gabriel garde le plus jalousement le souvenir. Un ancien élève disait
que, à Saint-Gabriel, le rôle du Père de famille est dévolu au Frère directeur.
Nul n'a davantage confirmé cette définition que le Frère Hormisdas, à condition
d'entendre la fonction du Père de famille dans un sens malheureusement caduc
aujourd'hui ou à peu près. Cet Angevin du nord de la Loire en avait l'autorité
ferme et indiscutée, la tendresse qui se manifeste dans toute la mesure, et
dans la mesure seulement, où l'autorité n'en pâtit pas. Comme professeur, il
s'était déjà signalé, douze années durant, par sa valeur pédagogique. Lettré
qui nuançait ses jugements de façon charmante et avait l'esprit de finesse, il
était de ceux dont les gens disent avec admiration : « Il cause bien. » Il
causait même abondamment et il lui arrivait au réfectoire d'arrêter d'un coup
de clochette la lecture pour ponctuer le texte d'un opportun et savoureux
commentaire. La note dominante de son règne aura été de répondre à merveille à
l'impulsion vigoureuse du Frère Eugène-Marie, alors supérieur général, touchant
l'extension et l'approfondissement des études. Il décida qu'on affronterait les
examens du brevet ; il organisa des laboratoires de physique, il poussa
vivement la culture des Beaux-arts : chant, piano, musique instrumentale,
dessin, aquarelle... Il ne perdait pas, pour autant, le sens de l'avenir professionnel
des enfants, car c'était une intelligence complète et bien équilibrée. C'est de
lui que datent ces leçons d'arpentage qui ouvriront à un nombre croissant
d'élèves la carrière d'expert-géomètre. Les classes se passionnaient pour la
théorie et la pratique de l'arpentage et rivalisaient d'émulation. Le Frère
Hormisdas était un animateur puissant de l'espèce méthodique. L'impulsion
qu'il donnait procédait de l'expérience et de la réflexion et il réglait
soigneusement le mouvement qu'il avait déclenché. L'homme apparaît tel dans un
portrait que j'ai sous les yeux : grand sans raideur, un visage aux traits
énergiques mais que l'on sent prêt à se détendre pour le sourire de la bonté,
des yeux pleins d'intelligence, au regard direct et scrutateur. Enfin, un chef
et le plus bienfaisant des chefs. Le rayonnement de sa personnalité accroît celui
de l'institution. Le nombre des élèves monte en flèche : 380 maintenant. Les
fêtes de la distribution des prix rassemblent jusqu'à quatre et six mille
spectateurs venue du dehors. Tout cela est le fait, non du seul Frère Hormisdas,
mais d'une formation déjà solidement traditionnelle, jamais pourtant en retard
sur son temps, le précédant parfois, progressant toujours et dont le Frère
Hormisdas a exprimé un des plus heureux sommets.
Il appartenait au Frère
Apollinaire, qui devint directeur en 1890, après dix-sept ans de professorat,
de pousser aux examens du baccalauréat où de brillante succès furent obtenus.
Il ne devait occuper ce poste que trois ans, mais son passage marqua fortement,
comme en tous les postes d'importance qu'il occupa. D'intelligence vive,
pénétrante et joyeuse, qu'exprimait, à travers les paupières plissées, un
regard cordial et rieur, c'est un être de franchise, de compréhension, d'intuition,
de bonne humeur dont l'aura est au plus haut point tonique. Une de ses
initiatives mémorables a été la fondation de l'académie Saint-Louis de
Gonzague, cercle littéraire qui rassemblera les meilleurs élèves. La fête
académique annuelle deviendra un des rassemblements de choix à Saint-Gabriel.
Le Frère Apollinaire
était un Auvergnat de la plus profonde Auvergne. Ainsi du Frère Hermogène qui
lui succéda. Il s'adapta lui aussi à ce milieu, si caractéristique des pays
d'Ouest, avec un tel bonheur qu'il fut un des plus Vendéens des directeurs, et
que nul n'a été plus avant que lui dans la compréhension et l'amour de la
Vendée. C'est un des honneurs de ce pays d'avoir conservé ce qui fait le prix
de la vie si fidèlement que tout homme attaché à la foi catholique et aux «
grandes mœurs », s'il aime par surcroît la terre et les terriens, pousse
aussitôt en Vendée de profondes racines. C'était déjà le cas du Frère
Apollinaire ; ce le fut plus encore du Frère Hermogène, en ce sens que celui-ci
sublimait de poésie et d'enthousiaste ferveur tout ce qu'il touchait. Le Frère
Hermogène était un poète et qui faisait des vers. L'on a de tout temps écrit
beaucoup de vers à Saint-Gabriel et l'on continue d'en écrire beaucoup. C'est
une inclination déplorable, si on n'y a point de talent. Le Frère Hermogène,
bien que d'un métier un peu hâtif, n'en était pas dépourvu... Mais la poésie
était plutôt en lui que sur ses papiers. Elle lui était comme une grâce intime
et toute personnelle par quoi sa vision du monde était constamment frémissante
et dorée, l'essor même de son âme, fraîche et impétueuse comme une source; la
poésie, c'était son âme ailée. La formation de ce lettré ne se distinguait
point par la méthode; elle suivait plutôt les mouvances d'une imagination qu'enchantaient
toutes les formes du beau. Ses études, à Lille, sous la direction des Pères
Jésuites, n'en furent pas moins sérieuses. En 1881, il rencontra le Père
Delaporte. On dit que ce fut une bonne fortune. Je n'en disconviens pas, bien
que vouant à l'œuvre poétique du Père Delaporte une phobie tenace et fort
ancienne. Du moins, le Père Delaporte était-il un authentique humaniste, qui
connaissait ses lettres et savait en communiquer le culte amoureux. De quoi le
Frère Hermogène a bénéficié. Mais surtout, il a découvert au pensionnat le plus
beau clavier qui soit pour des mains de poète épris des beautés divines,
puisque chaque touche en est une âme d'enfant. Pendant dix ans, le pensionnat,
dans ses études comme dans ses jeux, va vivre des heures d'enchantement.
Prenons garde qu'un
rêveur de la qualité du Frère Hermogène ne déforme pas la vie, mais la
transpose sur le plan de réalités supérieures qui ne s'ouvrent pas au
cheminement commun des hommes. Les fêtes religieuses du pensionnat sont
rehaussées par une figuration splendide, une ornementation symbolique. L'été,
en de longues processions à travers le parc, les torches illuminent la nuit.
Les grandes figures de l'histoire de France deviennent pour les enfants autant
d'idéaux vainqueurs, de patrons tutélaires. Ils s'éprouvent des croisés qui
continuent la geste chrétienne et française. Saint Louis occupe la douceur de
l'aube et Jeanne d'Arc surgit de la splendeur du couchant. Les jeux ? C'est la «
petite guerre » que le Frère Hermogène n'a pas créée, mais développée. Deux
camps : les « Croix », les « Lys » qui s'affrontent en des combats épiques et
savamment organisés auxquels doivent sourire les ombres de Lescure et de
Bonchamp. Les promenades ? Le Frère Hermogène les transforme en randonnées où
l'Histoire associe ses fastes aux incantations des saisons. Les enfants se
rendront, tel jour, aux ruines du château natal de La Rochejacquelein, et y
joueront une pièce où le héros très pur revit par les soins du Frère Hermogène.
Le pensionnat, devenu officiellement, en 1896, établissement d'enseignement
secondaire, a sa revue : L'Echo de Saint-Gabriel. Une salle de théâtre, une des
plus belles et vastes que j'aie jamais vues en un collège, accueille désormais
les solennités littéraires dont la vogue s'accentue. L'effort créateur du Frère
Hermogène tend à garder les élèves de Saint-Gabriel à leur terre natale, à les
enraciner dans leur province dont ils doivent constituer l'élite. C'est dans
cet esprit qu'il stimule l'enseignement traditionnel, qu'il crée les cours d'agriculture.
C'est sous cet angle surtout qu'il convient de considérer sa fondation
magistrale : l'Amicale des Anciens Elèves. Son idée, c'est que la vie ne doit
pas séparer les anciens de ce milieu où a été formée leur jeunesse. Une vaste
association doit les souder les uns aux autres et tous à Saint-Gabriel. Le
comité d'organisation fut vite sur pied. Le 13 février 1896, se tenait à
Saint-Gabriel la première assemblée, le 25 mai la grande réunion où deux cents
anciens élèves fraternisèrent dans l'enthousiasme. Aujourd'hui, ils sont trois
mille quatre cents. C'est une des plus puissantes sociétés de ce genre existant
en France. A la voix du Frère Hermogène, les pierres elles-mêmes se fussent
mises en mouvement.
Il va de soi que ce poète,
qui accordait le chant perpétuel de son âme aux trilles éperdus de l'alouette,
était un administrateur médiocre. Peu l'intéressait ce qui n'était pas de plein
ciel. Mais d'autres accomplissaient discrètement à ses côtés la nécessaire
besogne pratique pour laquelle il n'était point fait. Son physique suffisait à
avertir que la comptabilité n'avait pas barre sur lui. Le regard enthousiaste
et lointain semblait toujours suivre l'envol du cygne dans un ciel de légende.
Mais voilà précisément qui souligne l'intelligente politique des supérieurs
majeurs gabriélistes dans l'utilisation des hommes. Ils constataient que le
Frère Hermogène dotait Saint-Gabriel d'une atmosphère morale unique où les âmes
grandissaient, s'enflammaient et ils tenaient cela pour un bienfait qui
surpassait tous les tours de force administratifs. Au reste, les puissances de
rêve qui habitaient le Frère Hermogène aboutissaient à des réalisations
fécondes, à des résultats positifs d'envergure. Aussi fallut-il la pression
brutale de la persécution, en 1903, pour le chasser de son poste et lui faire
gagner le pays du Cid.
La nomination par Mgr
Catteau, évêque de Luçon, d'un supérieur diocésain, ayant sauvé le pensionnat,
deux cents élèves se présentèrent à la rentrée qui suivit la grande dispersion.
Il y en eut le même nombre en 1914, quand le tocsin de la mobilisation eut
ébranlé les clochers. Mais cette fois, il avait été imposé par la direction du
pensionnat, en raison du départ de nombreux professeurs. La rentrée de 1919
amena quatre cents élèves. En l'année où j'écris, ce chiffre est plus que
doublé, et faute de place, que de demandes restent insatisfaites ! Le
pensionnat est aujourd'hui toute une cité où vivent professeurs, Frères
d'emploi, élèves, personnel divers — plus d'un millier de personnes. L'esprit
de Saint-Gabriel le féconde.
Cet esprit, quel est-il
au juste ? Une vue cavalière de l'histoire du pensionnat m'en livre quelques
éléments, surtout si je les confronte avec certaines impressions, rapides et
profondes à la fois, qui m'ont assailli dès mon premier contact avec ce milieu.
Ces enfants, quand je les voyais passer, partant pour la promenade ou se
rendant aux classes, m'ont frappé dès l'abord par leur sérieux, leur
discipline, ou, les rencontrant dans la maison, soit individuellement, soit en
petits groupes, par leur politesse, par ce respect qu'ils ont pour les valeurs
de la hiérarchie, de l'âge, de l'autorité, par la franchise et l'honnêteté de
leur regard. Comme tous les élèves de tons les collèges du monde, ils sont, en
récréation, joyeux, ardents, tout à leurs jeux, mais, jusqu’'en cette détente
sans contrainte, persiste en eux une tenue où un certain ordre intérieur, fruit
de l'éducation, se révèle. En maintes circonstances, où je le pouvais faire
sans qu'ils me remarquassent, je les ai dévisagés un par un. Je n'ai jamais
surpris, comme en d'autres collèges, où elles sont monnaie courante, telles
allures obliques, telles expressions sournoises, telles moqueries équivoques
par quoi le mauvais esprit se manifeste et aussi le besoin de s'évader d'une discipline,
sinon détestée, du moins subie ! Ici la discipline est visiblement consentie.
L'impression d'ensemble est d'une vaste famille où les professeurs font figure
de grands frères respectés. Cela, et bien d'autres traits, m'entraînaient à
pénétrer dans l'âme de la maison, dans ses méthodes pédagogiques, bref en tout
ce qui doit rendre compte d'un résultat si complet et si éclatant. Pour en
avoir l'esprit informé et le cœur net, je sais où aller. Qui donc me pourrait
mieux renseigner eue le Frère G.-M...
La chambre où il
travaille est une vaste pièce oblonge aux murs chargés de livres. Une table
démesurée dévore toute la pièce. Dans un coin, un petit lit de fer semble un
meuble inutile et méprisé. A peine entré, je reçois l'accueil d'un sourire
cordial et spontané. Petit, vif, carré, le cheveu en brosse, le Frère G.-M...
dénonce aussitôt une extraordinaire vitalité intérieure. Le regard des yeux
noirs, mobile et direct à la fois, amical et curieux, reflète dès la première
question, le passage rapide des idées, des sentiments, des impressions, dans un
cerveau en magnifique effervescence. C'est un intellectuel que la vie des idées
passionne, et qui a passé par plusieurs disciplines ; les mathématiques, la philosophie,
la littérature. Il les a successivement enseignées. Actuellement, il est
sous-directeur du pensionnat et professe la première-lettres. A Saint-Gabriel,
on ne classe pas rigoureusement, sous des titres déterminés, les fonctions. On
n'y connaît ni préfet de discipline, ni préfet des études. Un directeur, un
sous-directeur, des professeurs, c'est tout. Le Frère G.-M... a pratiquement,
je crois, pour attributions tout ce qu'il lui est possible de faire. Que ne
fait-il pas, en effet ? Les solennités littéraires, théâtrales sont de son
rayon. Tandis qu'il s'affaire parmi les tréteaux des coulisses, ou qu'il va
d'une cour à l'autre, se composent en lui des cantates, des chants héroïques,
des complaintes qui, mis en musique par l'excellent compositeur qu'est le Frère
Jean-Sébastien, feront frémir d'aise la salle des fêtes. C'est chose frappante
chez lui que l'harmonieuse alliance du lyrisme intérieur et d'un sens très sûr
des réalités. Quoi encore ? Il dirige l'académie, réunit les jeunes professeurs
en des conférences pédagogiques où l'on suit de très près toutes les
publications spécialisées et l'évolution des études scolaires en France. Bref,
sa chambre, c'est un laboratoire en continuelle fermentation. Tout autre que
lui serait la pitoyable victime d'une pareille surabondance, mais son esprit
clair et méthodique ne se laisse pas submerger : il excelle au désemmêlement
des idées, la plus pénible, à mon avis, des opérations intellectuelles, la plus
nécessaire dans le cas du Frère G.-M... J'ai tenu ferme sous l'avalanche; elle
passe; elle est passée. Et maintenant, je puis trier ces trésors.
La dominante de
Saint-Gabriel, c'est d'être un apostolat pédagogique de l'école, très conscient
en tant que tel et avec tout ce que ce mot d'apostolat comporte de dynamique et
de conquérant. D y a toujours en une idée batailleuse autour de l'enfant parce
que c'est sur lui que la partie suprême d'une nation se joue. Montfort, qui l'a
si bien compris, a passé la consigne à ses fils. H voulait que les écoles
fussent, comme le désirait Bourdoise, « des pépinières de l'Eglise ». Il les
tenait pour des « postes avancés du christianisme ». C'est aujourd'hui deux
fois vrai. Le vieux Clemenceau disait : « La guerre n'est plus dans les chemins
creux, elle est à l'école. » Les Frères de Saint-Gabriel ne rusent pas avec
cette réalité pathétique : ils vont droit devant eux, à la vendéenne, vers un
but franchement avoué : la conquête des esprits et des âmes par l'éducation de
la jeunesse. Ils ont voulu et réalisé ici l'école institutionnellement
chrétienne. Un des résultats typiques de leur action, c'est qu'il est
actuellement dans la Vendée militaire, trois cents maîtres d'école qui sont
d'anciens élèves de Saint-Gabriel.
Cette action de conquête
est si efficace parce que Saint-Gabriel est une institution essentiellement
régionale. C'est le pensionnat de la Vendée militaire. Tous les maîtres en
sont, sauf quelques unités de Bretagne bretonnante. Quant aux élèves, ils sont,
pour un tiers, de la Vendée départementale, pour un quart de Maine-et-Loire,
pour un cinquième des Deux-Sèvres, pour un dixième de la Loire-Inférieure, pour
un dixième d'autres départements, ce qui donne à la seule Vendée militaire 87%
de l'effectif total[85].
Le pensionnat est né spontanément, on l'a vu, d'un besoin du pays. Au temps du
Frère Augustin, ce n'est pas Saint-Gabriel qui a fait appel à la clientèle, ce
sont les élèves qui y sont venus et l'ont occupé, constituant, avant toute
décision officielle, un pensionnat de fait. En somme, le peuple vendéen a exigé
des maîtres d'école et les a mis à la tête de ses enfants, comme, en 1793, les
paysans soulevés ont forcé les hobereaux à être leurs chefs. Le pensionnat est
resté longtemps très pauvre, à l'image de la terre et des terriens d'alors. Les
premières années, professeurs et élèves couchaient dans les galetas. Une foi
ardente tenait lieu de tout. On suivait la Providence pas à pas. En 1914
encore, la pension ne coûtait pas plus de 500 francs par an. Le progrès
matériel de l'école a suivi exactement la courbe ascendante de la prospérité
agricole. L'épopée vendéenne de 1793 a de tout temps puissamment animé l'esprit
de la maison. Quoi d'étonnant ? Les premiers maîtres n'ont-ils pas été élevés
sur les genoux de « ceux de 93 » ? Nombre de leurs parents ne furent-ils
pas massacrés sous leurs yeux ? Au reste, pour que l'histoire sacrée ne
s'estompe pas avec le temps, dans les jeunes mémoires, on en entretient avec
ferveur le souvenir. Le Frère Hermogène, on l'a vu, était passé maître en la
matière. Les promenades avaient souvent pour objectifs les hauts lieux des
guerres de Vendée ; celles-ci étaient évoquées sur place, d'une évocation non
scientifique mais lyrique. En route, on disait le chapelet, comme faisaient,
dans leurs marches et contremarches, les gars de Lescure et de Cathelineau. En
l'année 1944, le Frère G.-M... lui-même n'a-t-il pas fait de la grande
solennité littéraire de l'Académie une journée à la gloire de la Vendée, dont
je fus le témoin très ému ? La cantate qu'il composa à cette occasion sur une
musique du Frère Jean-Sébastien et dont, de tous leurs poumons, de toute leur
âme, huit cents enfants reprenaient le refrain, prolonge en moi ses échos
fervents.
Nobles aïeux, chevaliers en sabots,
De l'honneur du bon Dieu vivantes citadelles...
Sur la scène, un acte
émouvant ressuscita l'héroïque et simple départ de Cathelineau pour la croisade
des temps modernes. Un tableau vivant, d'une émouvante valeur de symbole,
rassembla autour de la Croix les « chevaliers en sabots ». Mais le plus beau, c'était
l'assistance, cette jeunesse pressée qui emplissait la vaste salle et les
tribunes, figée dans l'admiration, dans l'attention émerveillée, formant un
seul bloc de fidélité ou se déchaînant soudain en applaudissements frénétiques.
Un puissant sentiment collectif héréditaire était éveillé et porté au comble.
Il y entrait de la fierté : n'étaient-ils pas tous de jeunes gars des Mauges ou
du Bocage, du Loroux ou du pays de Retz, de la Gâtine ou du Marais ? Jamais je
n'oublierai, dans ces jeunes faces, graves et tendues, ce regard intense où se
reflétait la geste des aïeux. Jamais je n'ai éprouvé, comme en ces heures
supérieurement orchestrées et imagées, quels étonnants animateurs d'âmes sont
les Frères de Saint-Gabriel, et le caractère exaltant, ennoblissant de leur
éducation. La vie de ces jeunes, elle ne pourra plus être comme si cette
journée n'avait pas été[86].
C'est ainsi que les
Frères fournissent à la région ses cadres. En somme, ils forment, sur le
terrain des luttes pacifiques, des capitaines de paroisse. Presque tous les
postes importants de la Vendée militaire sont occupés par leurs anciens élèves.
Paysans, commerçants, industriels grands et petits, artisans[87],
ils tiennent les principaux carrefours, les centres d'influence. Pour le
rayonnement de leurs principes et de leur esprit, les Frères ont beaucoup fait
en introduisant dans leur programme les cours d'arpentage. Les
experts-géomètres dont j'ai dit qu'ils sortaient nombreux de Saint-Gabriel,
sont les conseils naturels, très consultés, très écoutés, du monde agricole qui
ne peut se passer d'eux.
Les anciens, c'est la
famille gabriéliste qui a essaimé et fondé des foyers dans la bonne terre
natale : leurs enfants seront, de même, élevés à Saint-Gabriel, et il en va
ainsi, de génération en génération. La famille est un mot qui, en Vendée, prend
un sens extraordinairement plein. Expression fidèle de la région, Saint-Gabriel
l'est encore par cet esprit familial qui imprègne les relations de maître à
élève. Il n'y a pas de surveillant : le professeur lui-même en remplit les
fonctions. A toute heure du jour et de la nuit, sa vie est fondue dans celle de
l'élève. Il n'a pas de chambre, couchant toujours dans les dortoirs ; il prend
ses repas à la table des élèves. Celui avec lequel les enfants jouent ou vont à
la promenade est celui-là même qui leur fait la classe. L'effet heureux de
cette disposition — dont aucun collège, je crois, n'offre l'équivalent — est de
neutraliser cette hostilité latente contre le maître qui est, dans les pensionnats
en général, l'instinct collectif normal et qui rend l'esprit de famille
impossible... L'écueil serait la familiarité. Le Frère G.-M... ne me conteste
pas qu'elle existe, mais m'assure qu'elle est de bon aloi. Je le crois sans
peine, l'ayant vue en action. C'est que la discipline générale n'en est pas
moins exigeante : dans les familles du pays, on dit couramment à l'enfant qui
n'est pas sage : « Je vais t'envoyer à Saint-Gabriel. » L'obéissance
respectueuse est obtenue, c'est un fait ; c'en est un autre que le respect des
enfants pour leurs maîtres va, plus qu'à l'autorité dont ils sont revêtus, au
dévouement qu'ils ont pour eux. Il reste que le système serait dangereux à
appliquer en dehors d'une tradition longue et éprouvée. Un élève, venant d'un
autre collège à Saint-Gabriel, est difficilement assimilable. Une formule aussi
hardie n'est viable et bienfaisante que dans une expérience régionale
traditionnelle comme celle-ci. Elle n'est enfin applicable que par des
religieux qui ont décidé d'aller jusqu'à l'extrême — je dirais, s'il pouvait y
avoir excès dans l'amour surnaturel, à l'excès — du dévouement. Pour le professeur
gabriéliste, il n'est, en dehors des vacances, et de la prière commune, aucune
de ces reprises intérieures où l'esprit se retrouve, se décante, se permet des
cheminements lents et reposants, aucune de ces concentrations dans la
méditation solitaire qui sont un besoin de l'âme, aucune détente où il soit
seul à seul avec lui-même. Hors quatre ou cinq heures de liberté par jour, il
appartient à l'enfant inexorablement.
Tout cela indique
suffisamment qu'un des grands principes gabriélistes est celui de l'équipe.
L'individualisme est ici en horreur. On n'y entend pas critiquer un maître par
un autre maître. Une unité profonde de convictions, de méthodes, d'idéal, les
soude les uns aux autres. Pas de francs-tireurs : partout joue la loi de
l'équipe ; une ligne de conduite une fois convenue, arrêtée, doit être suivie
par tous. Et voilà qui est bien montfortain. Partout où il allait, Montfort
constituait, avec des êtres d'élite — Amis de la Croix, Vierges... — des élites
et lui-même faisait équipe missionnaire avec les premiers Frères...
Parallèlement, la plus grande importance est donnée, côté élèves, à l'ambiance,
au facteur collectif ; on joue ensemble, on travaille ensemble, on prie
ensemble, par masses (l'expression se justifie pour un collège de huit cents
élèves). On se fait ainsi un esprit commun, une âme commune. Si forte est
l'action de l'ambiance qu'elle en devient un des plus actifs facteurs de formation
morale. Il arrive qu'un jeune homme en faute demande lui-même qu'on le reprenne,
tant il est gêné de détonner par là sur le milieu. Si l'ambiance est si
agissante, c'est que l'esprit de famille est grand et la personnalité n'en est
pas étouffée ; la plus grande liberté est laissée dans l'organisation des jeux,
dans les mouvements catholiques spécialisés ; l'esprit d'initiative peut s'y
développer. Et puis obéir, se plier au coude à coude perpétuel est formateur au
premier chef. Enfin, ne perdons jamais de vue que cette jeunesse n'est pas
disparate, qu'elle provient d'une même région, qu'elle est animée d'une même
conception de la vie. La tradition familiale et régionale introduit l'enfant
d'une seule coulée dans la tradition pédagogique de Saint-Gabriel. Ce qui
réussit merveilleusement ici échouerait peut-être lamentablement ailleurs.
Des méthodes si originales
ne dérivent d'aucune théorie, d'aucune pédagogie préconçue et c'est là encore
une originalité. Le pensionnat Saint-Gabriel est le fruit d'un empirisme
intelligent. Au long d'un siècle, l'intuition, l'observation, l'expérience ont
déterminé et perfectionné peu à peu la substance et la forme de cette
pédagogie, qui n'est nulle part codifiée en un manuel quelconque.
Les expériences du
dehors n'ont agi que faiblement ; jusque vers 1890, Saint-Gabriel, qui vivait
en vase clos, ne s'est guère préoccupé de les connaître. L'initiative de
l'enseignement technique appartient aux Frères des écoles chrétiennes, mais son
introduction à Saint-Gabriel est simplement le fait du recrutement régional et
des besoins de la région. Certes, les Frères se tiennent au courant ; ils ont
tous lus les œuvres pédagogiques importantes de ce temps, ils en sont même très
curieux et friands, mais leurs idées sur l'éducation n'en ont pas été changées.
Tout au plus ces ouvrages les ont-ils conduits à moderniser telle formule de
surface, mais à modifier l'essentiel, jamais. Us ont pour eux d'avoir
supérieurement réussi. Pourquoi s'encombreraient-ils des théories d'à côté ?
Les problèmes intérieurs, si graves, d'un collège : autorité, discipline,
emploi de la douceur ou de la fermeté, ils les ont résolus par la pratique, non
par la dissertation. J'entends bien que leur formule régionale et l'esprit des
pays d'Ouest les y ont aidés. Il y a là cependant, à mon sens, une indication
générale du plus grand prix. Si intéressant que, soit un système comme celui de
Montessori, par exemple, je me méfie de son caractère théorique si accusé et, à
son sujet, d'une telle crue de commentaires pédagogiques. Ici l'adaptation à la
vie s'est faite avec aisance par un certain esprit.
Cet esprit est partout
ici saisissable. J'ai retrouvé chez les professeurs et chez les élèves, ce que
j'ai déjà noté de l'Institut dans son ensemble : simplicité, franchise,
loyauté, parler direct et visage ouvert. D'afféterie, de coquetterie, de
manières contournées, pas l'ombre. C'est, pour une part, un effet du primat
donné au facteur collectif. Loin de fuir le maître, les enfants se le
disputent, notamment pour les promenades. Nul formalisme dans la piété, qui est
sincère, solide, simple. L'idéal religieux prend même facilement l'allure d'un
absolu catégorique, d'une logique intransigeante. Cela tient au pays qui n'est
pas celui de Tartufe: on n'y aime pas l'hypocrisie, les vies doubles. Les
manifestations solennelles de la vie du collège polarisent les jeunes enthousiasmes
et chacun apporte, à les préparer, un zèle débordant. Quant à l'attachement des
élèves comme des anciens élèves de Saint-Gabriel, il est proprement inouï et
j'en ai vu cent traits impressionnants. Le départ, à la fin de l'année
scolaire, de ceux qui ont terminé leurs études est chose émouvante. Dans le
beau soir d'été qui s'achève, tandis qu'aux pieds de Notre-Dame de la Salette,
haut-lieu du parc, résonne le cantique à Marie, le cantique du départ, la joie
des vacances proches s'ombre pour eux de mélancolie. Et quand les grands lundis
de Pentecôte ramènent la foule des anciens, mêlés aux jeunes, cette migration
joyeuse draine vers Saint-Gabriel, une autre foule, venue de tous les coins de
la Vendée militaire. Si surprenant que cela puisse paraître, certain grand
lundi a rassemblé, dans l'immense parc, jusqu'à vingt mille personnes, certain
banquet mille quatre cents couverts. Telle est l'intensité du foyer commun.
Et les études ? Je note
d'abord que la culture classique latine est absente de Saint-Gabriel. Pas de
latin, a fortiori de grec. Sur ce point, nous avons quelque peu ferraillé, le
Frère G.-M... et moi, à épées mouchetées d'ailleurs. J'incline à croire qu'il
surestime la valeur d'un humanisme sans latin. Il pense qu'il peut conduire à
des résultats équivalents à ceux d'un humanisme classique. Je lui concède
facilement d'ailleurs qu'il sort de Saint-Gabriel de bons humanistes « français
», parce que j'ai pu le constater. Au reste, ce n'est pas un parti pris qui a
entraîné jusqu'ici l'exclusion du latin. Ce sont les circonstances, le milieu
qui en ont décidé, l'empirisme encore une fois. Jusqu'en 1875, la matière était
le primaire et le primaire supérieur. Quand on se décida au baccalauréat, on ne
voulut pas, jusqu'en 1890, présenter les élèves aux examens. C'était le temps
de « La Terre qui meurt », du Vendéen René Bazin. Par un scrupule fort noble,
on craignait de détourner les gens de la campagne. En 1890, quand on s'engagea
à fond dans la voie du baccalauréat, on s'arrêta au secondaire moderne.
Plusieurs fois, de 1902 à 1940, la question se posa d'aborder le classique.
Trois considérations surtout firent conclure à la négative : la région comporte
des collèges ecclésiastiques assez nombreux pour ceux qui désirent des
humanités classiques ; créer une section classique obligerait à accepter trois
cents élèves de plus et Saint-Gabriel est déjà débordé ; et surtout l'on
craignit qu'un afflux d'élèves préparant les humanités latines n'altérât l'esprit
de Saint-Gabriel et les principes fondamentaux de sa pédagogie. Là, je m'en
persuade, a été, de beaucoup, l'argument le plus déterminant. Dans une
formation humaniste proprement dite, à l'usage de la clientèle (paysanne,
commerçante, de petite bourgeoisie) de Saint-Gabriel, le Frère G.-M... voit
quelque chose de contraire à l'esprit de simplicité et de service social, un
risque grave de culture snob et je crois bien qu'ainsi il exprime plus ou moins
une réaction instinctive de Saint-Gabriel. On redoute de l'humanisme un
éloignement du réel, on penserait volontiers que l'humanisme fait oublier
l'humanité. Je ne puis ne pas m'insurger là contre. Il est bien vrai que
l'humanisme du XVIe siècle était tout gonflé de l'orgueil païen de
la vie; mais l'ivresse de la découverte en est cause. Les trésors de l'antiquité
grecque et latine ont joué dans les cerveaux des lettrés le rôle du vin nouveau.
Depuis, Dieu merci ! nous avons digéré tout cela ; certes, comme il v a dans
l'homme le risque inné du péché, il y a dans l'humanisme le danger constant de
dégénérer en mandarinat. Mais nous sommes devenus assez maîtres des richesses
de l'antiquité pour les dominer et orienter l'humanisme dans un sens
bienfaisant, largement humain. L'humanisme d'un saint François de Sales n'est
tout de même pas inhumain. Là-dessus, je suis prêt à discuter avec le Frère
G.-M... jusqu'à la fin des temps, si Dieu me prête vie. Cependant, réserve faite,
et forte réserve sut le jugement dont il me semble frapper l'humanisme en soi,
je me sens d'accord avec lui, et avec l'ensemble des professeurs de
Saint-Gabriel sur leurs conclusions pratiquée. Le programme actuel s'adapte à
merveille au recrutement spécial de Saint-Gabriel. Très rares sont les élèves
qui visent aux professions libérales ; l'immense majorité s'intégrera dans
l'agriculture, la petite industrie, l'artisanat et le commerce, qui représentent
la quasi-totalité de l'activité régionale[88].
Ce programme de
Saint-Gabriel, quel est-il ? Il comporte, à partir du certificat d'études,
quatre ordres d'enseignement : le primaire supérieur, l'école professionnelle
(un an de préparation, trois ans de cours), le cours commercial (trois ans de
cours), enfin le secondaire moderne. A ces quatre branches maîtresses s'ajoute
un enseignement facultatif qui, lui aussi, s'inspire de la volonté d'équiper
l'enfant en vue de 6on rôle futur dans le cadre régional. La musique est très
poussée et c'est une des justes fiertés de Saint-Gabriel que la belle
organisation, remarquablement conçue, des locaux qui y sont consacrés. Il y a
quatre cliques, une par division. L'enseignement, à la fois théorique et
pratique, est donné à près de quatre cents instrumentistes, par trois professeurs.
Ces jeunes musiciens seront d'une précieuse ressource aux groupes paroissiaux,
et ceux qui ont appris à jouer de l'orgue ou de l'harmonium, aux églises de
leurs paroisses. Le cours de dessin comporte deux professeurs pour le dessin
industriel, un pour le dessin d'art.
Des ateliers forment des
forgerons, des ajusteurs et des tourneurs; d'autres préparent des menuisiers,
des charpentiers, des ébénistes; et déjà un atelier de chaussures est ouvert en
vue de donner à l'industrie de la chaussure, très développée dans la région
depuis la grande guerre (il y a 85 industriels autour de Cholet), les bons
contremaîtres qu'elle réclame. Ces petites industries, groupant quarante à
cinquante ouvriers au plus, sont du type familial. Un rôle social des plus intéressants
peut y être joué et c'est là, outre les considérations d'ordre purement
professionnel, ce qui a décidé la direction du pensionnat à cette fondation
nouvelle.
Nous sommes ici dans une
maison d'éducation institutionnellement chrétienne. S'il en était autrement,
Saint-Gabriel perdrait tout son sens. La conception chrétienne de l'homme et de
la vie sature les études, les récréations, les promenades, les fêtes, les plus
humbles détails de la vie du collège, bref, informe tout, au sens thomiste du
mot. Comme dans l'ensemble des pensionnats chrétiens, l'assistance quotidienne
à la messe, la confession mensuelle sont de règle. La dose des exercices de piété
y est plus considérable qu'ailleurs. Si l'on vient du dehors, on serait tenté
de la trouver excessive et elle le serait assurément en telles autres régions,
mais ici elle est bien portée. L'enfant y est entraîné par l'intensive pratique
religieuse des paroisses de la Vendée militaire et par une certaine patience
naturelle qui est dans la race. J'ai vu à l'église de Saint-Laurent des offices
se poursuivre couramment deux heures d'affilée sans que craque une chaise, sans
que la masse des assistants, à genoux, assis ou debout, se départe de son
immobilité. Aussi, prière du matin, méditation, messe, prière avant et après
les classes, prière de l'heure — chaque heure étant ponctuée d'un Ave collectif
— retraites au commencement et à la fin de l'année, ne lassent-ils pas l'enfant,
non plus que les cinq heures d'enseignement religieux hebdomadaire, n est des recollections
trimestrielles facultatives : les trois quarts des élèves y prennent part avec
les professeurs. L'ambiance joue ici son rôle : c'est le climat de la maison;
on le respire tout naturellement; le contact constant avec des religieux, des
prêtres dispose aussi les jeunes âmes à se concentrer dans la prière.
Mais prenons garde qu'il
n'y a pas ici l'ombre de formalisme. Chez les élèves comme chez les
professeurs, mutatis mutandis, la foi
est profonde, ardente, trouve partout, dans la terre natale, des sucs
nourriciers et des étais puissants. Ces âmes d'enfants sont, dans l'ensemble,
d'une fraîcheur, d'une pureté ravissantes, et la piété n'y est pas routinière
et mécanique, mais fervente. Certes, l'antique serpent est toujours là, qui
sait bien s'insinuer jusque sous les fleurs des cérémonies religieuses ;
seulement les éducateurs y veillent de près. Sur la pureté par exemple, ils ne
transigent pas. Les éducateurs sont aidés là-dessus par la traditionnelle délicatesse
de la conscience chrétienne dans les foyers vendéens ; l'enfant s'alarme vite
du trouble qui naît en lui, et la confiance profonde qu'il voue aux Frères et
aux aumôniers le fera s'en ouvrir sans tarder. Pour remédier aux désordres des
sens, les Frères de Saint-Gabriel ne recourent jamais à la manière tatillonne
et inquisitoriale dont ils ont horreur. Us créent plutôt le climat contraire,
ils intensifient le caractère collectif de la vie qui oblige l'individu à
refréner continuellement son tempérament et son caractère, à dissoudre ses
rêves dans une action virile et constante. A cette santé morale contribuent
puissamment les vastes espaces vivifiants du parc et de la campagne immédiate,
les longues randonnées pédestres des jeudis et des premiers mardis du mois. Il
y a, dans la pédagogie de Saint-Gabriel, une politique du grand air.
Une des forces
religieuses du pensionnat était, jusque vers 1930, comme chez les Jésuites, les
congrégations d'élèves. Les mouvements spécialisés de l'action catholique — ici
la J.E.C. et la J.O.C. — les ont remplacées. Il serait vain de dissimuler le
regret qu'a causé leur disparition. Comment, par exemple, cette cité de mille
âmes, centrée sur la Vierge Marie, sa patronne insigne et très aimée,
n'éprouverait-elle pas douloureusement le vide qu'a laissé, en se dissolvant,
la congrégation mariale qui était la fine fleur de la piété gabriéliste et
avait fondé la dévotion à Montfort, apôtre de la Mère de Dieu ? Aussi a-t-elle
été reconstituée, à la demande instante de plusieurs grands élèves, le 25 mars
1946. Les Frères, toujours soucieux d'articuler leur action apostolique sur les
grandes directives de l'Eglise, n'en ont pas moins provoqué les élèves à
former, ceux de l'école professionnelle, des groupements de J.O.C, ceux des
autres programmes, des groupements de J.E.C. et les plus petits un
rassemblement de Croisés. Ils leur ont laissé pour cela pleine initiative et
constatent que celle-ci se traduit, avec le temps, par un travail en profondeur
fécond. C'est là, en somme, pour cette jeunesse, une préparation à l'action
catholique qui l'attend, et aussi, je pense, un ferment propre à galvaniser
plus tard la masse vendéenne, religieuse sans doute, mais peut-être trop
passive, trop confiante dans l'immutabilité de ses traditions.
Le rôle des aumôniers de
Saint-Gabriel est exclusivement d'ordre sacerdotal. La direction spirituelle,
la confession, la prédication, l'instruction religieuse, tel est leur domaine,
nettement séparé du reste de la vie du collège. On l'a voulu ainsi en raison de
la très haute conception que l'on se fait, au pensionnat, de leur caractère
sacerdotal et de leur ministère, que l'on ne veut pas livrer à la familiarité
de la vie ordinaire. D'où un respect du prêtre dont on trouverait difficilement
l'équivalent dans les autres collèges. Et voilà qui est bien de la « Vendée
militaire » où le prêtre est vénéré pour ce qu'il est en effet : le ministre de
Dieu. En cela encore, le pensionnat Saint-Gabriel est un décalque de la
tradition chrétienne de la région. On y voit dans l'aumônier non M. l'abbé Un
Tel, mais le Prêtre. C'est ce qu'exprimait, en une heureuse formule, un ancien
du collège : « A Saint-Gabriel, on ne change pas d'aumônier, c'est seulement
l'aumônier qui change de nom. » A ce rayonnement proprement sacerdotal,
s'ajoute généralement celui d'une âme chaleureuse et d'un caractère
sympathique, car l'aumônier est soigneusement choisi parmi les jeunes prêtres
les plus appréciés du diocèse. Consulté par la direction en tout ce qui
concerne la vie religieuse collective, informé des qualités et des défauts de
l'enfant par la famille ou le curé qui le lui amène à la rentrée, son influence
est éminente, son rôle capital dans la formation spirituelle des pensionnaires,
qu'il s'agisse des mille petits cas suscités par la vie de collège, ou des
problèmes plus graves posés par l'orientation de la vie, par la vocation
parfois. Toujours à la disposition des élèves pendant les récréations ou les
temps libres, il en voit plus de la moitié venir à lui chaque semaine. Les
aumôniers, au nombre de trois — qui sont toujours sur la brèche — vivent en
communauté, à l'intérieur du pensionnat, sous la présidence d'un supérieur.
Entre eux et les Frères, c'est plus qu'une parfaite entente ; une collaboration
active pour le plus grand bien de l'enfant.
Saint-Gabriel réalise,
sans que la discipline ait à en souffrir, bien au contraire, la formule d'une
vie intense, épanouie, où l'esprit, le cœur, l'âme trouvent pleine
satisfaction. Son grand secret est de ne pas partir d'un formulaire rigide ;
les méthodes d'enseignement s'adaptent avec souplesse aux désirs des familles
et aux besoins de la région ; ils ne tiennent pas seulement compte des examens
mais de l'avenir de l'enfant ; et, pour ce, on n’hésite pas à amalgamer les
programmes, à les compléter, s'il le faut, par des données qui vont au delà de
l'examen ou de la classe. L'absence de toute théorie préalable, de toute routine,
le primat du principe apostolique ont rendu possible ce fait saisissant,
unique, je crois bien, et riche de conséquences heureuses : le maître vivant
avec l'enfant, partageant toute sa vie. Etant toujours avec ses élèves, il peut
s'adapter à leurs possibilités, user de son temps de classe à volonté, situer
leçons et devoirs aux moments qu'il juge les plus propices. Les enfants, il les
connaît à fond, étant souvent leur confident, toujours leur grand ami, il sait
les petites faiblesses, les lacunes, les ressources de chacun ; dès lors, il
leur parle en classe la langue qu'ils comprennent, il sait ce qui les frappera,
retiendra leur attention, les fera réfléchir. Cette intimité du maître avec les
élèves entraîne l'esprit de famille, et par suite, la docilité et la confiance,
et aussi l'intérêt porté au travail, tel en vérité que, si quelque menu
désordre vient à déranger une classe, les enfants sont les premiers à s'en
plaindre. Discipline et enseignement en sont du coup simplifiés[89].
Le succès de Saint-Gabriel aux examens[90]
dépend pour une bonne part de cet état d'esprit qui bonifie singulièrement le
rendement de l'enseignement.
En bref, on ne brutalise
pas la vie pour la faire rentrer dans une formule. Les formules naissent de la
vie elle-même, appréhendée par l'intuition, serrée de près par l'observation,
utilisée par l'expérience. Et ces formules elles-mêmes sont, à l'usage,
contrôlées sur la vie, sur la mise en œuvre, sur la psychologie de l'enfant.
Cela n'implique aucune anarchie, ni même aucune dispersion, parce que la
tradition orale, règle en action, qui s'est formée par l'expérience de
plusieurs générations de professeurs, est très solide et très respectée. Et
puis, la loi de l'équipe joue parmi les professeurs comme parmi les élèves.
Dans cette grande famille, les jeunes Frères écoutent les anciens, les
regardent faire ; des conférences pédagogiques les rassemblent sur un thème
précis. Un même esprit est familier à tous les maîtres puisqu'ils sont tous ou
des Frères ou d'anciens élèves. D'où cette impression, si forte, à la fois de
continuité et de renouvellement, qui est précisément l'image de la vie.
Tout cela cependant
n'est rendu possible que par un dévouement porté au comble ; on ne s'en peut
faire une idée que si l'on en a été comme moi, le témoin quotidien pendant
longtemps. Cette fusion de la vie du maître avec celle de l'élève demande an
maître une abnégation qui, très mortifiante pour l'esprit, ne l'est pas moins
pour le corps. L'usure nerveuse qui en résulte est telle qu'elle n'est guère
praticable pour des hommes qui ont passé quarante ou cinquante ans. C'est en
quoi surtout resplendit la beauté spirituelle de l'Institution. A sa base, et
l'animant toute d'une flamme inapaisable, il y a un grand amour.
III - L'INSTITUT A L'ÉTRANGER. LE
CANADA
Les lois persécutrices
de 1901-1903 ont jeté une grande partie des Frères de Saint-Gabriel hors de
France. Leur esprit missionnaire y trouva son compte. Au reste, les supérieurs
généraux n'avaient pas attendu M. Combes pour envisager un apostolat
pédagogique lointain. Le Canada, dont je vais parler, en témoigne. Seuls, les
besoins des écoles en France freinaient l'élan. L'exil fut l'occasion de
satisfaire largement une aspiration ancienne. Il permettait de reconstituer la
vie communautaire, impossible en France, et libérait les puissances de conquête
spirituelle qui agitaient l'âme de l'Institut.
La Belgique d'abord,
terre d'élection pour toutes les congrégations religieuses. Le petit
pensionnat, mal dirigé, que prirent en main les Frères à Boechout, en 1903,
devint vite un établissement florissant qui groupe aujourd'hui plus de cinq
cents élèves mi-internes, mi-externes, au lieu des quinze pensionnaires et des
soixante externes d'autrefois, sur le programme des humanités modernes, avec
large part donnée aux études commerciales... En 1919, la maison de Liedekerke,
qui était, depuis 1913, le noviciat de la province du Nord, devenait un grand
pensionnat, rivalisant avec Boechout ; d'ailleurs, celui-ci, comme celui-là,
devaient leur prospérité au Frère Jean Climaque. Il convient de saluer au
passage cet animateur de qualité ; il devait une part de son succès à certaine aura de sa personne physique ; bien
qu'authentique Auvergnat, il avait une de ces rondes figures enluminées qui
abondent dans les « fêtes au village » des tableaux flamands et cette gaîté
joviale, épanouie, dont les Belges sont fort amateurs. Mais surtout,
circonspect à se décider, il était ferme dans la décision une fois prise et
énergique dans l'action.
A Bruxelles, à
l'Institut Saint-Antoine, cinq cents enfants de la bourgeoisie reçoivent
l'éducation gabriéliste dans le quartier neuf d'Etterbeck. Une école gratuite
paroissiale, que subventionne le gouvernement (heureuse et intelligente
Belgique !) double l'externat payant. L'Amicale des anciens élèves est tout un
monde répandu en des œuvres catholiques multiples qui en sont allègrement et
efficacement animées.
A Péruwels, se trouve le
noviciat de Belgique et le juvénat, à Braine-le-Comte le scolasticat dont les
sujets prolongent leurs études pendant quatre ans au moins à la sortie du
noviciat. Ils se rendent capables ainsi d'enseigner avec aisance dans les deux
langues du pays. Près de ces étudiants, une école professionnelle fait, des
jeunes gens qui suivent ses trois années de cours, de bons techniciens très
appréciés dans la région. C'est encore la Belgique qui a le privilège, tous les
deux ans, de rassembler les Frères en un second noviciat. A Boechout, en effet,
à côté du pensionnat, dont le sépare une simple clôture, un joli château,
entouré d'un parc, y est spécialement affecté.
Le 10 août 1903, les
Frères de la province du Centre prenaient pied en Espagne, à Gérone. Bien vite,
la fondation nouvelle se développa. Ecole primaire de Castillo de Ampurias,
collège de Bandas, dans la province de Gérone ; école primaire, collège
secondaire de Valls dans celle de Tarragone, ces étapes réussies menaient les
Frères dans la province de Barcelone qui allait ouvrir à l'apostolat
gabriéliste ses plus beaux débouchés. Le vaste et bel établissement de San
Adriau de Besos ouvrit ses portes à la population enfantine des faubourgs
ouvriers. Une soixantaine de juvénistes, une trentaine de novices, réunis, à
douze kilomètres de la ville, dans le beau domaine de Caldetas (San Vicente de
Llavaneras), où se trouvait aussi le scolasticat, assuraient la relève et le
renfort. Le recrutement progressait d'année en année, les postulants affluant
de provinces plus chrétiennes que la Catalane, Castille et Navarre surtout,
l'espérance jaillissait de toutes parts, quand soudain, tout fut jeté bas. 1936-1937.
La hideuse passion révolutionnaire s'acharna, à Barcelone, sur les prêtres, les
religieux, les lieux saints. Les roses sanglantes du martyre couronnèrent
l'Institut de Saint-Gabriel, en la personne de quarante-neuf de ses enfants,
parmi lesquels le provincial, admirable religieux, les directeurs du juvénat,
du noviciat et du scolasticat... Mais, le cyclone passé, les Frères rouvrirent
quatre maisons sur huit. De nombreux projets s'élaborent : établissement de
sourds-muets et d'aveugles à Barcelone, essaimage en Amérique du Sud. Le sang
des martyrs fructifie dans le secret. La province d'Espagne refleurit, comme le
marronnier à son second printemps.
En Angleterre,
Saint-Gabriel n'a qu'une maison, mais d'un type particulier et intéressant. «
Oaklands », à Londres, entouré d'un beau jardin, bien à l'abri des tristes
fumées de la capitale anglaise, proche des parcs de Wimbledon et de Richmond,
est un home pour les étudiants, universitaires ou non, Français ou étrangers,
qui y trouvent jeux de plein air et d'intérieur ; les Frères y enseignent
l'anglais, le français et l'espagnol. Et surtout, là séjournent quelque temps
les scolastiques destinés aux écoles gabriélistes des pays de missions ; ils y
apprennent l'anglais, langue coloniale indispensable el y conquièrent leurs
titres.
Hors l'Europe, c'est aux
Indes que Saint-Gabriel possède ses plus beaux établissements : dix postes dont certains de première
importance. A Yercaud sont la maison provinciale et le Montfort High School
avec 215 pensionnaires et 40 externes, fils de planteurs de café, au début
surtout, et auxquels se mêlent, dans la proportion légale de 15 %, des Hindous.
A trente kilomètres de Pondichéry, l'école professionnelle et l'orphelinat de
Tindivanam assurent à 120 jeunes orphelins l'apprentissage du métier de
menuisier. Apprentissage très poussé, puisqu'il n'englobe pas moins de quatre
années. Une cinquième retient les apprentis pour qu'ils acquièrent ce tour de
main et cette rapidité dans l'exécution qui en fait des ouvriers. Ainsi sont
formés des techniciens, faisant de la « bonne ouvrage », à la manière française
et, but essentiel des Frères, de bons chrétiens.
A Coonoor, sont le
juvénat avec vingt juvénistes, le noviciat avec huit novices ou postulants, le
scolasticat, qui est aussi école normale officielle, avec dix scolastiques. Ces
chiffres, qui sont de fin 1944, ouvrent de belles perspectives sur l'avenir de
la mission. Tous les ans arrive au juvénat une dizaine de recrues nouvelles
bien sélectionnées. A côté de la maison de formation est la High School, avec
460 élèves, dont le directeur est un Frère hindou. Encore une High School à
Ootacamund avec 430 élèves ; une autre, qui n'en compte pas moins de 900, à
Hyderabad ; le directeur, là aussi, est un Frère hindou ; une troisième, à
Secunderabad, avec 310 élèves. Les Frères, en outre, dirigent un orphelinat à
Pondichéry ; dans cette même ville, ils professent les cours français au petit
séminaire. A Trichinopoly, deux Frères hindous sont étudiants au collège des
Jésuites. Enfin, comme le plus ingénieux esprit d'entreprise ne manque jamais
aux Gabriéliste», l'un d'eux est régisseur à Honey Rock d'une belle plantation
de café dont les bénéfices couvrent en partie les frais de la maison de
formation de Coonoor. Si rapide que soit ce tour d'horizon, il donne quelque
idée de la puissante vitalité de la mission des Indes. Elle avait eu à sa tête,
aux moments difficiles, le fondateur et le chef qui s'imposait : le Frère
Denis.
Si belle que soit la
mission des Indes, c'est au Siam que s'épanouit le plus puissant collège de
Saint-Gabriel. Les Frères furent appelés à Bangkok par les Pères des Missions
étrangère». L'un d'eux, le Père Colombet, avait fondé en 1885 le collège de
l'Assomption. Il souhaitait que des Frères enseignants s'en occupassent, l'affaire
des Pères n'étant point la pédagogie. Son vœu fut entendu. Saint-Gabriel
délégua en 1901 le Frère Martin de Tours et quatre autres Frères. Ils
trouvèrent au collège deux cent cinquante à trois cents élèves. Six ans après,
ce nombre était passé à mille huit cents ; un tel chiffre dit tout. Cette
population scolaire se composait en majorité — soixante-dix pour cent environ —
de Chinois... En 1923, le Frère Martin de Tours ouvrait un nouveau collège, dit
de Saint-Gabriel, à l'autre extrémité de la ville (qui s'allonge sur dix
kilomètres). Sept cents élèves le fréquentent actuellement qui sont, ceux-là,
de recrutement siamois prédominant. Une école primaire d'une centaine d'élèves
à Petriu, non loin de Bangkok, une autre, de près de deux cents élèves, à
Chieng-Mai, dans le nord du pays, complètent la mission gabriéliste du Siam, où
de nombreux Frères de la province d'Espagne collaborent avec les Frères
français. On ne peut admirer tel succès sans saluer la mémoire du Frère Martin
de Tours. Il n'était de premier ordre, ni comme administrateur, ni comme
bâtisseur, mais le religieux était parfait d'humilité, de piété, de
mortification, et l'homme témoignait d'une belle intelligence aux conceptions
larges et hardies. Un zèle tout paulinien le soulevait pour le salut des âmes
et sans doute brûlait-il par trop les étapes en ce milieu bouddhiste, si
difficile à gagner à la Croix et dont les susceptibilités doivent être
ménagées. Mais, dans l'apostolat missionnaire, la noble imprudence
d'aujourd'hui peut demain germer en conversions inattendues. En tout cas, le
seul exemple d'une telle vie était bien fait pour mener sinon à la foi
chrétienne, du moins au respect des choses saintes que le Frère Martin
incarnait si bien.
La mission gabriéliste
de Madagascar ne représente, par le nombre des Frères ou des écoles qui s'y
trouvent, qu'un poste modeste mais il s'y est fait de belle besogne chrétienne ;
le dévouement, le courage qu'y ont déployés quelques Frères isolés, les
souffrances, amères entre toutes, qu'ils y ont portées d'un cœur magnanime, la
rendent très chère à l'Institut. J'ai eu l'honneur de connaître l'un d'entre
eux, le Frère Brillaud, qui fait la classe, et fort bien, aux petits garçons de
Saint-Laurent, mais reste, en son vieux cœur, un broussard impénitent et
nostalgique. Puissé-je quelque jour avoir place pour raconter son histoire et
ses histoires ! Comment ne pas marquer du moins ici qu'il fut, en même temps
qu'un père et un maître très aimé pour ses petits bonshommes noirs, un
défenseur acharné et efficace de l'influence française contre les intrigues
germaniques. Il eut à passer par de cruelles épreuves, du fait surtout, comme
Mère Javouhey, de certaines autorités ecclésiastiques. Quand il quitta
Madagascar en 1935, il y laissait quatre Frères dans les deux postes de Majunga
et Nossi-Bé.
La mission d'Abyssinie
n'est plus qu'un souvenir, et c'est grande tristesse, car elle donnait de beaux
résultats ; de grandes âmes d'apôtres — telle celle du Frère Félix de Noie,
fondateur de l'école d'Addis-Abbeba, qui rassembla quatre cent cinquante élèves
— s'y donnèrent avec une magnifique générosité à l'œuvre scolaire. Des
circonstances pénibles et complexes mirent le point final à cet effort de
trente-quatre ans.
Pour combien de temps ?
Peut-être, à la faveur du remaniement de l'échiquier mondial, la mission
d'Abyssinie renaîtra-t-elle. En tout cas, les compensations ne manquent pas, on
l'a vu, et l'on ne saurait oublier de mentionner encore les deux missions
africaines de la province gabriéliste du Nord : Libreville, fondée en 1900 sur
la demande des Pères du Saint-Esprit (fils de Claude Poullard de» Places), où
l'enseignement primaire est donné, en dix-sept classes, à huit cents enfants ;
Bondo, dans le Congo Belge, où l'école primaire, avec ses quatre cents élèves
se double d'une école normale pour instituteurs indigènes. De Bondo, chaque année,
vingt instituteurs nouveaux — dont on a fait de bons chrétiens et des apôtres —
gagnent quelque poste de la brousse. La tâche, pour les Frères, n'est pas légère.
Ils doivent apprendre le lingala, langue du pays, et professer dans cette
langue, deux heures seulement par semaine étant consacrées à l'étude du
français. A Bondo comme à Libreville, il fallut tout concevoir et tout créer de
toutes pièces, sous un climat accablant qui fait de pareille dépense vitale un
supplice physique continu. Si, débouchant de son tombeau, Montfort faisait
l'inspection des écoles africaines de ses fils, cet amoureux des croix serait
tout joyeux de si cruelles et saintes délices.
La perle de l'Institut,
hors la mère-patrie, reste la province du Canada. Par une lointaine aspiration
montfortaine. Par sa primauté de fondation. Par son importance intrinsèque. Par
le lien spirituel qu'elle établit entre la France d'Europe et cette autre
France qui, là-bas, s'obstine magnifiquement.
M. de Montfort, sitôt
ordonné prêtre, rêva de terres vierges et son imagination franchit les mers.
Ses deux premiers historiens font état de ce vœu dont il était tout brûlant : «
Il souhaita même, dit Grandet, d'aller prêcher l'Evangile aux infidèles du
Nouveau-Monde et il disait quelquefois aux ecclésiastiques qui demeuraient avec
lui : « Que faisons-nous ici, mes chers amis ? Pourquoi sommes-nous des
ouvriers inutiles, pendant qu'il y a tant d'âmes qui périssent dans le Japon et
dans les Indes, faute de prédicateurs et de catéchistes qui les instruisent des
vérités nécessaires au salut ? » Sur quoi, apprenant que M. Tronson devait
faire partir plusieurs ecclésiastiques pour Montréal en Canada, Montfort, redisons-le
ici, demanda à être agréé dans l'équipe. M. Tronson, dont le conseil avait pour
l'Eglise de France de ce temps valeur oraculaire, en dissuada Montfort, « persuadé
que Dieu le demandait ailleurs », en quoi il voyait juste. M. Leschassier opina
dans le même sens que M. Tronson, mais pour les raisons médiocres que l'on
sait. Montfort, qui se faisait une loi de la plus stricte obéissance,
s'inclina. C'est bien une des singularités les plus notables et émouvantes de sa
vie que ses plus chère desseins n'aient connu que des réalisations posthumes.
Il fallut plus de deux siècles pour que celui-ci germât. C'est en 1888 que le
Frère Hubert, alors supérieur général, envoya des Frères au Canada. Cette date
situe, d'autre part, la fondation canadienne au premier rang des essaimages de
Saint-Gabriel en Europe ou en terres lointaines. Très vite, elle acquit une
importance considérable, au point d'absorber, comme elle fait aujourd'hui, près
du tiers des effectifs gabriélistes. D'elle à la Maison-Mère, les échanges
spirituels sont intenses et féconds. Tout conjure à lui assurer une place hors
de pair dans le développement de l'Institut.
Disons les noms des
premiers pionniers qui brillent à l'origine du mémorable exode : à la tête de
la caravane, un religieux d'élite et qui allait prouver son savoir-faire, le
Frère Louis Bertrand ; comme sous-directeur, le Frère Augustin, professeur
remarquable et remarqué au pensionnat de Mées ; un Frère connaissant l'anglais,
le Frère Sylvère ; deux autres, actifs, débrouillards et entraînants, les
Frères Raoul et Jean de Prado, enfin un bon cuisinier, dévoué entre tous les
Frères d'emploi : le Frère Herbland. Bientôt un nouveau renfort devînt
nécessaire. Il arriva en juin 1890, composé de deux novices et de trois
scolastiques.
Or, j'ai eu la bonne
fortune de connaître l'un de ceux-ci, le Frère T..., qui devint par la suite
provincial du Canada. Par lui et â travers lui, j'ai découvert la province
gabriéliste du Canada et même, dans une large mesure, le Canada lui-même.
Comment ne pas m arrêter ici â sa personne en qui s'incarne près d'un
demi-siècle de la fondation canadienne et toute l'histoire des origines ? Il
est le type accompli du Gabriéliste français profondément canadianisé, qui a
fait la transition du Français à l'état pur, fraîchement débarque à Montréal en
1890, au Canadien gabriéliste qui, maintenant, tient tous les postes de
commande et, à peu d'exceptions près, absorbe les effectifs de Saint-Gabriel
dans le Nouveau-Monde.
A l'heure que voici,
après avoir passé quarante bonnes années de sa vie au Canada, il égrène, en la
Maison-Mère de Saint-Laurent, des jours dégagés du souci des hautes charges que
longtemps il assuma. Bien qu'il ait franchi le cap des soixante-dix ans, on ne
saurait parler à son propos de vieillesse, tant s'est maintenu en lui cet
équilibre heureux des facultés qui, de continent en continent, d'année en
année, de charge en charge ou en décharge, l'a laissé dans un optimisme calme
et souriant, tant son cœur est resté jeune, affectueux et attentif. L'âge n'a
fait qu'y ajouter une longue et riche expérience des hommes et des choses et la
couronner de ce qui est la fleur des vies bien menées sous le regard de Dieu :
la sagesse. Tel que je le vois, j'imagine que cette sagesse, qui imprègne ses
propos, sa jeunesse était déjà toute prête à la recevoir, le bon sens et le
jugement étant visiblement son climat naturel. Elle n'a d'ailleurs rien, chez
le Frère T..., d'austère ni de pesant. Elle est telle que la dépeignent les
Saints Livres « se jouant en tout temps devant le Seigneur, se jouant sur la
surface de la terre ». Dans les récits du Frère T..., débités d'un ton tout
uni, la malice passe soudain en éclair, sans que la physionomie en trahisse
rien, une malice faite d'un humour indéfinissable qui révèle que beaucoup plus
de choses et de gens l'ont amusé et l'amusent encore, qu'il ne veut bien le
laisser paraître. Quand vous le voyez taciturne, les yeux baissés et la
physionomie au repos, au milieu d'une conversation, tenez-vous en garde. Sa
faculté d'observation, toujours en alerte, est embusquée dans ce silence, non à
la façon d'un chasseur malveillant, mais d'un bon connaisseur du cœur et de ses
détours, dépourvu d'illusions mais très humain, extrêmement avide de la seule
vérité, non pour en accabler quiconque, mais pour situer au juste point une
charité dont il abonde. Voilà une
disposition qui dut fort lui faciliter au Canada l'exercice de la supériorité
et la maîtrise du noviciat. C'est elle encore — faut-il le dire ? — qui lui a
inspiré certain ouvrage, encore hélas ! à l'état de manuscrit, sur les examens
particuliers dont la sûreté de dissection fait pâlir celle de M. Tronson. Voilà
bien une opération de chirurgie spirituelle propre à faire gémir certains
patients, oublieux des aspics qui gîtent sous les roses de leurs vertus. Au
reste, quelque chose d'essentiel échapperait à jamais du Frère T... à quiconque
ignorerait qu'il a vécu au Canada le meilleur de son temps. Le pays qui jamais
n'oublia Montcalm s'est emparé de ce Vendéen de Saint-Hilaire-de-Talmont au
point de lui devenir consubstantiel. J'entends le Canada de la vieille France,
avec sa magnifique santé morale, sa bonhomie, sa fraîcheur et son ingénuité de
sentiments, son sens pratique, son charme, suranné et qui cependant nous
renouvelle comme un secret de jeunesse, son absence de complications
intellectuelles et sentimentales, sa rondeur et son franc parler, cette vieille
France, d'une distinction simple et sans apprête, ce vieux Français dont le
Frère T... garde un souvenir obstiné, j'allais dire incarné, jusque dans son
style et sa syntaxe. C'est par là que, tout en étant de là-bas, il reste de
chez lui. Le Canada lui était devenu son pays, sa terre, et je n'offenserai
pas, je pense, les délicates pudeurs de son âme, en disant que, le jour où,
sans transition aucune qui l'y préparât, il fut invité à regagner pour toujours
la vieille Europe, il eut, des sacrifices et des déchirements qu'impose l'obéissance
religieuse, la connaissance la plus âpre qui soit... Maintenant, il va et
vient, dans la vieille maison Supiot, secrétaire particulier du supérieur
général, remplissant par ailleurs des fonctions indéterminées, toujours
provisoires et d'ailleurs nécessaires, amoureux des besognes obscures, se
multipliant en mille de ces petits services qui rendent au prochain la vie plus
légère. Si, dans tel poêle, le feu ronfle, si tel paquet fait, par son emballage
exact, l'admiration du receveur des postes, ne cherchez pas : le Frère T... a
passé par là. Rien ne semble subsister en lui d'un passé dont je vais dire trop
rapidement quelques-unes des œuvres qu'il a réalisées, des images dont il
s'enchanta. Cependant, on apprend bien des choses à la façon dont un homme fume
sa pipe. Il est des pipes allègres, des pipes insolentes, des pipes combatives.
La pipe du Frère T... n'est pas triste mais elle est pensive. Les volutes en
sont pareilles aux douces fumées qui, vers un ciel chargé de neige, montent des
toits, au pays de Maria Chapdelaine.
Ce pays, si différent de
sa Vendée, l'a conquis tout entier et il ne s'en cache pas. La succession de
nos printemps aux longues incubations, de nos étés et des tièdes automnes qui
les prolongent, ne lui paraissent pas valoir la magnifique et brutale irruption
d'un printemps qui est déjà l'été et, presque sans transition, les premiers
flocons de neige et les mois interminables, ouatés de blanc. Ces mois-là sont
attendus par les Canadiens, pendant la très brève saison chaude, avec la même
impatience qui nous fait guetter, à la fin de l'hiver, le premier bourgeon. Les
maisons sont si bien équipées là-bas pour résister au froid ! Dehors, les
fourrures épaisses, d'où seul le nez pointe, défient les cruelles atteintes du
blizzard. La saison hivernale, c'est celle des jeux et des fêtes dont la neige
et la glace alimentent les péripéties joyeuses.
Et puis l'esprit
familial, qui sature le Canadien, au point d'être l'âme de «on âme, y trouve
son compte. Autour du poêle chaleureux, la famille éprouve puissamment son
unité morale. Tout s'oriente, dans cet Etat modèle qu'est l'Est canadien, par
rapport à elle. Le jeune homme ne s'attarde pas à fixer son destin. Un élève
d'un collège gabriéliste du Canada disait au Frère T... : « Papa est allé deux
ans au collège, puis il c’est marié avec maman. » Formule naïvement elliptique
assurément, mais qui signifie qu'on se marie jeune. Tôt constituée, la famille
est solide et durable. C'est à la campagne qu'elle prend sa plus haute
signification spirituelle. Le droit d'aînesse joue au Canada, sans qu'il soit
besoin de tourner la loi, comme au pays basque, en un réflexe de conservation.
Le frère aîné fait le nécessaire pour que ses frères et sœurs puissent s'établir.
Il pourvoit aux besoins de ses parents et ceux-ci, dès qu'ils ne peuvent plus
rendre service, se retirent au village. Isolés ? Abandonnés ? Non pas. Vienne
le matin du 1er janvier. L'air gelé s'emplit de sonorités cristallines. Les
carrioles roulent sur les chemins neigeux, convergeant vers la maison des
ancêtres. Celle-ci s'illumine de toutes ses fenêtres. Bientôt, aux pieds des
grands-parents sont leurs enfants et les enfants de leurs enfants. Et l'aîné
dit : « Mon père, vos enfants sont à vos genoux, bénissez-les. » La famille
ouvrière, pour être moins patriarcale, ne s'en défend pas moins. La mère ne
travaille pas au dehors ; le père lui remet chaque semaine son gain. Elle a la
charge du budget. Ici et là, le mariage est un sacrement reconnu comme tel, et
donc sacré, par l'Etat qui ne s'en mêle pas. Bienheureux pays !
Familles chrétiennes,
familles peuplées d'enfants, qui trouvent à l'école la même formation qu'au
foyer. Il n'est pas surprenant que les instituts religieux y puisent largement,
pour leur recrutement. Nul doute qu'une telle atmosphère n'ait aidé, dès les
débuts, au développement rapide de Saint-Gabriel au Canada. Au reste, les
équipes de 1888 et 1890 y arrivaient en invitées. La cause occasionnelle de
leur établissement fut la conversion de M. Baudry, homme d'affaires,
prodigieusement enrichi par ce genre de transactions dont le marché noir
d'aujourd'hui donne assez bien le type. Parvenu à l'âge où les plus débauchés
font souvent oraison, ce nouveau riche revint à Dieu et décida, en réparation
des scandales dont il était l'auteur, de faire bâtir, de son argent, une
institution charitable. Ainsi s'éleva l'orphelinat Saint-François-Xavier, assez
vaste pour assurer le logement de cinquante à cent orphelins et flanqué
d'ateliers de forge, menuiserie, couture et imprimerie, dont la location, jointe
à celle de maisons annexes, devait assurer leur subsistance. Mais qui
dirigerait cette œuvre ? La question était encore pendante quand Baudry mourut.
Le curé de Notre-Dame de Montréal et le juge Jette, ses exécuteurs
testamentaires, la prirent en main. Sur le conseil du curé de Saint-Jacques, un
Sulpicien, et du Père Fleurance, de la Compagnie de Marie, ils firent appel aux
Frères de Saint-Gabriel.
Quand le Frère T...
arriva à Montréal, l'orphelinat comptait déjà une cinquantaine d'enfants et,
alertés par le succès, plusieurs curés demandaient déjà aux Frères des maîtres
pour leurs écoles paroissiales. Ce fut cependant vers un collège classique et
commercial — celui de l'Assomption — que les Frères s'orientèrent d'abord. Deux
des leurs y furent détachés[91].
Peu après, le supérieur général de Saint-Gabriel, ayant constaté sur place que
les vents gonflaient les voiles du jeune navire, lui envoya un troisième
équipage en renfort : deux Frères chevronnés — Savin et Dioscore — et quatre
novices. Une fondation fut décidée à Saint-Johnsbury, aux Etats-Unis, où furent
envoyés deux Frères[92].
Dans la ville de l'Assomption, tandis que les Frères Raoul et T... professaient
au collège classique et commercial, le Frère Savin assurait, aidé du Frère
Jean-Marie, la direction de l'école paroissiale, la première échue à
Saint-Gabriel dans le Nouveau-Monde. A l'orphelinat Saint-François-Xavier de
Montréal restaient le Frère Louis Bertrand, provincial, avec quatre Frères. La
fondation prenait forme. Le Canada avait définitivement adopté Saint-Gabriel[93].
Un événement devait
cependant assombrir ces allègres origines. Il fallut, en juillet 1894, fermer
Saint-François-Xavier. Une fausse manœuvre des administrateurs civils de la
maison amena des difficultés financières. Elles eussent pu être facilement
résolues par l'appel au crédit ; mais, pour être de pratique courante dans le
Nouveau-Monde, le crédit, sous le nom de dette, fait figure d'épouvantail en
notre vieux pays. L'administration générale de l'Institut, jugeant de Saint-Laurent,
ne crut pas devoir entrer dans cette voie. Le cœur en deuil, les Frères du
Canada virent les petits orphelins s'en aller. Mais à leur apostolat une autre
voie s'ouvrait aussitôt,
Depuis septembre 1892,
dans une rue voisine, végétait un patronage. Les Conférences de
Saint-Vincent-de-Paul en avaient pris l'initiative. Le mot patronage n'a pas
ici le sens que nous lui donnons habituellement. Il s'agissait d'un pensionnat
ouvert aux jeunes gens de quatorze à dix-huit ans, isolés dans la vie et soucieux
d'apprendre un métier. En grande majorité, ceux qui sont dans ce cas viennent
de la campagne. Us sont donc guettés par tous les dangers d'une grande ville ;
ils y risquent leur vie religieuse et même leur vie morale tout court. Par
l'éducation chrétienne et par le travail, par le métier, le patronage les
sauve. C'est aux Frères de Saint-Gabriel que les Conférences et les messieurs
de Saint-Sulpice en confièrent la direction. Nul témoignage ne pouvait mieux
rendre compte de la profonde et affectueuse estime où le Canada tenait déjà les
Frères.
Or, dès 1893, le
patronage, bénéficiant de l'appui de puissants bienfaiteurs, put s'installer
dans un vaste immeuble. Belle compensation à la perte de Saint-François-Xavier,
le patronage Saint-Vincent-de-Paul se développa à merveille. Œuvre originale et
intelligemment charitable. Sitôt entré à l'Institution, le jeune homme est
orienté vers le métier qui paraît le plus en rapport avec ses aptitudes et ses
goûts : menuiserie, forge, typographie, reliure, couture, pharmacie, etc...
C'est en ville qu'il travaillera et les Frères n'ont aucune difficulté à le
placer. Sur son salaire hebdomadaire d'apprenti, ils ne prélèveront que deux
piastres, prélèvement qui reste immuable, quelle que soit l'élévation du salaire
(et celui-ci atteint jusqu'à quinze et vingt piastres). Sur la différence, ils
remettent en toute occasion à l'apprenti ce qu'il lui faut pour ses achats
indispensables qu'il fera le plus souvent au magasin de la maison où tous
articles de première nécessité sont au meilleur compte. Après son travail,
l'apprenti regagne aussitôt le patronage, qui lui est un vrai foyer familial,
où il trouve instruction générale en des cours du soir, jeux variés, nourriture
excellente, sollicitude affectueuse ; un vaste terrain sur les bords de la
rivière des Prairies permet aux équipes de football et base-ball de
s'affronter, les jours fériés. Le dimanche, les apprentis sont conduits aux
offices de la paroisse Notre-Dame. Les prières du matin et du soir sont faites
en commun à la chapelle. Un aumônier est à leur disposition tous les jeudis. Et
surtout, ils baignent dans ce climat chrétien qu'excellent à composer les
Frères de Saint-Gabriel. Cette centaine d'enfants, laissés à eux-mêmes, que
fussent-ils devenus ? Un certain capitaine de police de Montréal l'imaginait
bien quand il disait au Frère T..., alors directeur de la maison : « Vous
faites la plus belle œuvre de Montréal. »
La plus belle ? Une
autre allait, une dizaine d'années plus tard, rivaliser avec elle, en reprenant
ridée-mère de l'orphelinat Saint-François-Xavier, grâce à la générosité d'un
curé de Montréal. Bénéficier de l'active protection d'un curé canadien est,
pour une œuvre, la plus heureuse aventure qui lui puisse arriver. Le curé,
là-bas, est le chef de sa paroisse à un degré que nous imaginerions mal chez
nous. Il manœuvre ses paroissiens avec autant d'autorité et d'aisance que fait
un joueur des pions sur son échiquier. Son presbytère est une manière de petit
ministère où il règne et le fait savoir. Rond et cordial, «on accueil à
l'emporte-pièce, truffé de saillies inattendues, suffoquerait un Français
moyen, mais là-bas ne déroute personne. Il est au centre de toutes les
préoccupations familiales de ses paroissiens, arbitre et conseil écouté[94].
Ainsi trônait M. le chanoine Arsène Dubuc, en sa paroisse du Sacré-Cœur qu'il
avait fondée. A son originalité peu commune, il joignait les qualités d'un cœur
très tendre et en perpétuelle effusion. Or, il avait en grande amitié le Frère
Pierre Gaver, alors directeur du patronage Saint-Vincent-de-Paul, et le Frère
Pierre Claver n'ignorait pas que le bon curé était aussi généreux que riche. M.
Dubuc possédait un vaste terrain au nord de la ville, qu'il avait offert gracieusement
pour l'érection d'une église. Son don n'ayant pas été agréé, le terrain restait
vacant. Le Frère Pierre Claver s'en proposa l'apostolique invasion. Il obtint
d'abord sans peine d'y conduire jouer ses apprentis le dimanche. Or, un jour,
un gros orage creva et les enfants rentrèrent, ruisselants d'eau. Cela posa la
question d'un hangar, puis d'une petite maison pour le gardien et sa famille. A
ceci comme à cela, Mgr Dubuc consentit avec joie, car tout don lui était une
joie. Le jour vint où le Frère Claver posa la grande question : « Pourquoi les
Frères de Saint-Gabriel ne bâtiraient-ils pas sur ce terrain une grande maison
pour y recevoir des orphelins ? » Mgr Dubuc pleura ; il avait ce que le
vocabulaire mystique appelle le don des larmes ; il les prodiguait à tout
propos et même, je crois, hors de propos. Cette fois, elles avaient leur
justification profonde : « Un orphelinat ! s'exclamait Mgr Dubuc, un logement
pour mes « petits », chez moi !... J'y rêve depuis longtemps... »
Et bientôt, une belle
maison, qui se nomma, du prénom de son fondateur, l'orphelinat Saint-Arsène, se
dressa, construite pour recevoir soixante orphelins. Il en vint cent qu'on
logea comme on put. En 1906, il fallut envisager un considérable
agrandissement. Les Frères proposèrent à Mgr Dubuc de se porter acquéreurs de
la propriété. Elle valait un million. Mgr Dubuc la vendit pour cinq piastres et
le revenu spirituel quotidien de trois Ave Maria récités par les orphelins. La
nouvelle construction fut aussitôt mise en train. Elle abrite aujourd'hui
quatre cent trente enfants, répartis en dix classes où professent une vingtaine
de Frères. Les enfants y sont reçus de sept à quinze ans, les orphelins de
préférence mais aussi des enfants de ménages séparés ou, exceptionnellement,
ceux qui sont pour leurs parents une trop lourde charge. L'instruction qui leur
est donnée est celle des écoles catholiques de Montréal.
Mgr Dubuc, qui était
encore, aux débuts de l'orphelinat, M. le chanoine Dubuc, fut pendant de
nombreuses années l'aumônier de l'Institution. En face de l'orphelinat, une
résidence lui avait été bâtie. Au vrai, il y était, bien plus qu'un aumônier,
le fondateur, le bienfaiteur, le père, entouré de l'enthousiaste et
reconnaissante affection des orphelins et des Frères. Ceux-ci lui ménageaient
une bonne surprise : sur leur demande, Mgr Bruchesi, archevêque de Montréal,
sollicita du Saint-Père la prélature pour M. Dubuc. Elle lui fut conférée le 4
avril et ce fut, depuis, une joie pour le délicieux vieillard de se montrer
comme il disait « vêtu de toutes ses plumes » à ses « petits lapins ». Cette
pourpre violine, il la portait fort bien, car, s'il était de taille exiguë, il
avait une belle tête, aux nobles traits, encadrée de longs cheveux d'argent et
ses « petits lapins » étaient fiers d'un si décoratif aumônier. Il repose
maintenant au milieu de ceux qu'il avait tant aimés. Sa tombe, en effet, a été
creusée dans le jardin de l'orphelinat et surmontée d'un beau mausolée. Ainsi
en avait-il été décidé de son vivant, et ce fut une de ses dernières joies.
Le noviciat, espoir de
la jeune fondation, s'accroissait, d'une progression lente mais constante. Dès
1895, il comptait douze novices et postulants canadiens, ce qui faisait
entrevoir le moment où la province ne dépendrait plus de France pour son
recrutement. Les premiers novices étaient logés à l'orphelinat
Saint-François-Xavier, mais il y manquait cet isolement dans le silence où se
fait le bon novice. En l'année 1891, Saint-Gabriel acquérait une belle
propriété au Sault-en-Recollet, sur les bords de la rivière des Prairies. La
maison pouvait contenir quarante personnes. Aménagée, remaniée, exhaussée, elle
répondit aux besoins jusqu'en 1908 où juvénistes, postulants, novices, tous
alors logés sous le même toit, habitèrent un établissement trois fois plus
vaste, que Saint-Gabriel avait fait bâtir sur un nouveau terrain, attenant à
l'ancien et récemment acquis. Quatre-vingt-dix arpents de terre l'entouraient.
Outre le parc d'agrément où, au long d'une belle allée, de majestueux érables
chantaient sous le vent, cette propriété fournit, grâce au travail acharné de
tous, une terre cultivée de façon si remarquable qu'on la venait admirer de
toute la région.
Mais, bientôt, la ville
ravageuse étendit ses tentacules vers cette solitude agreste. Montréal, qui
comptait quatre cent mille habitants, atteignit le million aux environs de
1914. Des tramways déversèrent une foule tapageuse là où les novices avaient
accoutumé de se promener en paix. Il fallut de nouveau émigrer et ce fut
l'origine du juvénat de Saint-Bruno. Saint-Gabriel, ayant acquis la propriété de
sept cents hectares qu'y possédaient les Pères Jésuites, avait eu d'abord
l'intention d'y transférer tant les novices et postulants que les juvénistes.
Les plans dressés à cet effet parurent de réalisation trop dispendieuse. Les
novices restèrent au Sault-en-Récollet[95]
et l'on se contenta, à Saint-Bruno, d'un juvénat, belle construction haut bâtie
sur la colline. Quant aux vastes terres qui l'entourent, elles furent mises en
exploitation. Une vingtaine de Frères s'en occupèrent ; sous la très capable direction
du Frère A..., ils en firent un domaine prospère. Les résultats furent à
l'échelle, pour nous géantes, de la production américaine. Les ruches
produisaient vingt tonnes de miel par an. Le poulailler signifiait plusieurs
milliers de volailles classées par race. Des incubateurs de plusieurs centaines
d'œufs donnent chaque année dix-huit à vingt mille poussins, dont les quatre
cinquièmes vont aux éleveurs. Quant au lait, chargé sur des camions, il est
expédié aux hôpitaux, hôtels, collèges de Montréal, où il est fort apprécié
pour sa pureté. Certaines étendues pierreuses sont elles-mêmes d'un beau
rendement, étant couvertes de milliers de pommiers. Sur quoi un Père jésuite
dit un jour au Frère T... : « Je ne crois pas que les Frères s'élèvent bien haut
en spiritualité à la queue des vaches. » Ce n'est là qu'une boutade. Les Pères
jésuites, grands amis des Frères de Saint-Gabriel d puis Montfort, savent bien
à quel degré de vertu s'élèvent tant de Frères d'emploi, dans leur tâche
obscure, menée avec humilité et dévouement sous le regard de Dieu. Et puis, du
juvénat, que l'on put soutenir, grâce à l'exploitation, ne sortaient pas
seulement des tonnes de miel, mais, de plus en plus nombreux, des jeunes gens
avides d'apostolat scolaire et qui, après avoir reçu au noviciat une solide
formation religieuse, étaient happés par les écoles qui, de toutes parts,
demandaient des Frères.
L'organisation scolaire
au Canada, quant à l'enseignement primaire, porte la marque de ce souci des
affaires qui caractérise les Etats du Nord-Amérique. L'enseignement comporte
trois cours : le cours élémentaire, qui prend l'enfant de six à onze ans, plus
une année préparatoire et quatre années d'étude; le cours modèle qui fait
suivre à l'enfant, pendant, deux ans, le programme qui aboutit chez nous au
certificat d'études; enfin, le cours commercial. Deux ans encore, l'enfant qui,
au cours modèle, a déjà étudié l'intérêt, l'escompte et la comptabilité, se
perfectionne ici en comptabilité et dactylographie. L'enseignement de l'anglais
est très poussé en troisième cours. Un diplôme commercial couronne le succès
aux examens à la fin de la huitième année. Pour passer du coure élémentaire au
cours modèle, il avait déjà fallu à l'enfant un diplôme sanctionnant les
examens.
Cette organisation de
l'enseignement primaire s'entend des villes ou des gros bourgs. L'école de
campagne ne comporte que le cours élémentaire. Enfin, les écoles supérieures,
nécessitant quatre années d'études, sont, soit des collèges classiques, où
l'enfant est en mesure de faire du latin, sitôt après le cours modèle, soit des
écoles commerciales supérieures dont le programme est analogue, en très gros, à
celui de notre enseignement secondaire
moderne.
Au début de la
fondation, les Frères ont tenu des écoles élémentaires dans les campagnes.
Aujourd'hui, ils ne s'occupent que des écoles comportant le cycle complet. Pour
des raisons diverses, ils ont abandonné onze postes d'importance inégale. Ils
dirigent une école commerciale supérieure, huit écoles commerciales, cinq écoles
modèles, quatre pensionnats-externats; neuf, sur ce nombre, sont situés dans le
diocèse de Montréal, dont quatre dans la ville même. Les autres postes se
répartissent entre les diocèses de Juliette, de Trois-Rivières, de Québec et de
Hallebury. Très vite, ils se sont imposés, comme professeurs et comme
éducateurs.
Dans le fonctionnement
des écoles canadiennes, le rôle du gouvernement est très indirect. Pas de
ministre de l'Instruction, du moine dans la province de Québec, mais un
surintendant de l'Instruction dont les conseillers sont les évêques de la
province et quelques laïcs qualifiés dans l'enseignement. La politique et
l'école s'ignorent mutuellement.
Les Frères au Canada ne
connaissent pas les difficultés et les amertumes qui sont le lot des Gabriélistes
français dans notre vieux pays, devenu, par provinces entières, terre de
mission. Chez nous, le prêtre et le religieux s'efforcent, par des élites,
d'ailleurs nombreuses et très ferventes, de reconquérir la masse; là-bas, ils
n'ont qu'à maintenir la masse dans sa foi qui est robuste. La pratique
religieuse, fort régulière, s'épanouit surtout dans le dimanche et la communion
pascale. En province de Québec, nul ne manque au devoir pascal non plus qu'à la
messe les dimanches et jours d'obligation, cela par le fait non d'une routine
grégaire, mais d'une conscience avertie. Le dimanche canadien est un jour
faste, plein d'allégresse. Les offices font nefs combles. On y entend des
sermons qui, m'assure le Frère T..., ne sont pas toujours aussi vulgaires que
semble l'insinuer Louis Hémon dans sa Maria Chapdelaine. Ils sont surtout
pratiques ; c'est une manière de catéchisme de persévérance, parfois très bien
fait... Hors l'église, le dimanche garde son caractère sacré. Cafés, cabarets
sont fermés. La joie liturgique se prolonge surtout dans les foyers où l'on se
visite entre amis. Les saines distractions du dehors sont le hockey en hiver,
le base-ball ou le football en été. Tout s'ordonne par rapport au clocher. La
veille des fêtes d'obligation comme des dimanches de première classe, à
l'angélus du soir, toutes les cloches entrent en folie. Or, il y a bien cent
clochers à Montréal. On imagine ce joyeux tumulte et son retentissement dans
les cœurs chrétiens.
Les Frères de
Saint-Gabriel, grâce à leur allant et à leur souplesse d'adaptation, se sont
remarquablement faits au climat religieux et moral canadien. L'écueil serait la
facilité. Us s'en sont gardés jusqu'ici par un généreux esprit d'apostolat, qui
ne s'accommode pas de la médiocrité. Ils De boudent pas à la peine et se
dévouent corps et âme. Ils bénéficièrent, dès les débuts, de chefs excellents
qui créèrent une tradition. Comment ne pas mettre en vedette, avec le Frère
T..., le Frère Louis-Bertrand et le Frère Elzéar ?
Le frère Louis Bertrand,
l'homme des origines canadiennes de l'Institut, Provincial à trois reprises, fut,
dans la plénitude du terme, un homme de gouvernement. De tempérament
autoritaire, s'il péchait par quelque point, c'était par une volonté trop
minutieuse de discipline. N'allait-il pas remarquer, se promenant dans le
jardin, que, sur deux fraises mûres qu'il avait vues la veille, une avait
disparu le lendemain et n'or-donna-t-il point incontinent une enquête ? Mais
ces minuties n'empêchaient point qu'il fût un religieux de vraie valeur et de
solide vertu, de grand prestige aussi au Canada. Il était certes bien secondé,
car les équipes gabriélistes qui se succédèrent dans le Nouveau-Monde, furent
de première qualité, mais il savait les former à leur tâche dans ce pays neuf.
Avec cela, beaucoup de distinction naturelle, de charme, d'entregent, sans
parler de l'esprit religieux qui l'animait de pied en cap et parachevait en
profondeur les conquêtes qu'avait commencées son amabilité.
Le Frère Elzéar, fut, de
1923 à 1935, le premier Provincial canadien. Avec lui, la province devenait « majeure
». Elle ne pouvait mieux inaugurer son majorât. Religieux exemplaire, apportant
même quelque rigidité dans l'observation de la règle, il s'était signalé à l’orphelinat
Saint-Arsène comme un directeur éminent. La conquérante gentillesse du Frère
Louis-Bertrand n'était pas son fait ; d'abord sévère et même roide, il s'imposait
par la seule valeur. Il parlait rarement et brièvement, mais toujours pour dire
quelque chose qui en valait la peine. Sous son impulsion énergique, qui
procédait d'un jugement sûr et d'une pensée mûrie, la province connut la
prospérité intellectuelle et matérielle. Continuant l'effort amorcé, il poussa
les Frères à des études prolongées ; nombre d'entre eux préparaient au
scolasticat leur brevet supérieur. Certains prenaient leur licence en
agriculture à l'école d'Oka affiliée à l'université de Montréal ; d'autres leur
licence en lettres ou en philosophie, après avoir suivi, tout en professant,
les cours de l'Université. Notons que la licence canadienne est loin
d'équivaloir à la licence française. Le gouvernement du Frère Elzéar n'en est
pas moins marqué du plus bienfaisant caractère, par cet effort vers la haute
culture.
C'est par là, me semble-t-il,
que la province gabriéliste du Canada me paraît appelée à jouer un rôle
insigne, dans les rapports réciproques entre le Canada français et l'ancienne
mère-patrie, à laquelle il est resté si noblement, si passionnément attaché. Si
nous avons beaucoup à apprendre, pour l'organisation pratique de la vie, d'un
pays où tel enfant de quinze ans, obligé par la mort de son père de diriger une
grande ferme, s'en tira fort bien, où tel autre du même âge, et pour une cause
analogue, dirigea avec le même bonheur l'usine paternelle, le Canada, sur le
plan de la culture, s'ouvre à nous comme un étudiant avide et insuffisamment
comblé. Les Frères de Saint-Gabriel peuvent beaucoup pour activer et organiser
cette liaison féconde. Ce sont presque tous aujourd'hui des Canadiens
autochtones et leur administration provinciale vient d'être entièrement
canadianisée. C'est dans l'ordre normal des choses et il y faut applaudir comme
au couronnement naturel de l'œuvre magnifique et rapide d'un demi-siècle. Mais
comment un grand ami français de Saint-Gabriel n'exprimerait-il pas ici le vœu
que les relations intellectuelles avec cette belle province religieuse du
fraternel Canada n'en soient pas détendues, mais au contraire fortifiées ?
Un Frère R...-M...,
Canadien du Canada, ne m'en-tendra-t-il pas, lui qui, bon écrivain, lança un
journal pour Jécistes, dont il était le directeur et principal rédacteur ? Et
tel et tel autre encore ? De la France au Canada, par les mille moyens qui
s'offrent à l'ingéniosité humaine, il importe de créer un courant culturel,
puissant et continu. Ce beau, ce grand pays d'au delà des mers, qui a la
croissance vigoureuse du chêne, qui sait rivaliser avec les plus puissants pays
industriels, tout en gardant le primat aux valeurs spirituelles, jusque dans sa
structure politique, ce Canada, cher à nos cœurs, doit connaître les multiples
témoignages de notre vitalité intellectuelle et non pas ceux-là seulement que
consacre chez nous le snobisme. Je me persuade notamment que notre magnifique
renaissance littéraire catholique, si mal connue, si mal soutenue, même en
France, est loin de l'être au Canada comme il conviendrait. Dan3 l'ensemble de
la production française, et à égalité de valeur littéraire, elle représente
pourtant, sans conteste possible, par son inspiration première comme par sa
haute tenue religieuse et morale, ce qui s'adapte le mieux, en profondeur comme
en étendue, au climat spirituel du Canada français. L'Institut de
Saint-Gabriel, si fermement établi au Canada comme en France, peut, s'il le
veut, jeter d'un pays à l'autre, par delà l'Atlantique, ce pont d'or.
CONCLUSION
J'avais mis à ce livre
le point final, quand me vint la nouvelle de la démission, pour raison d'âge et
de santé, du Révérend Frère Benoît-Marie, qui succéda, en 1936, au Frère
Sébastien, comme Supérieur général de l'Institut. Me voici libre pour en
parler.
Le Révérend Frère
Benoît-Marie a gardé le gouvernail de l'Institut jusqu'en janvier de l'année
1946, où j'écris ceci. Durant tout son généralat, le beau navire a été
fortement secoué. La révolution de 1937 dévasta la province d'Espagne ;
quarante-neuf Frères fuient exterminés par les Rouges, et, parmi eux, tous les
chefs. Du même coup, il fallut renoncer à un établissement dans l'Amérique du
Sud, déjà préparé, mais qui ne pouvait être le fait que des Frères espagnols.
La seconde guerre mondiale rompit toutes relations entre les religieux de
France et ceux de l'étranger ; partout où elle sévit, elle détruisit ou
paralysa les œuvres. D'ores et déjà, elle a hypothéqué l'avenir, en dispersant
les sujets des maisons de formation ou en les réduisant à un nombre infime.
Elle a empêché la formation, en Fiance, d'une province nouvelle de l'Institut,
freiné l'expansion missionnaire. Le départ des déportés en Allemagne, l'absence
des Frères prisonniers gêna considérablement le fonctionnement des écoles. Une
situation aussi troublée a, de plus, comme il était inévitable, causé des
défections dans les rangs des Frères. Et ce fut encore sons le gouvernement du
Révérend Frère Benoît-Marie que la mission d'Abyssinie sombra.
Les circonstances
m'avant fait vivre, pendant un an et demi, dans l'intimité du foyer
gabriéliste, m'ont permis d'avoir avec lui de longues conversations, en ce
bureau net et lumineux où affluaient, de tant de coins du monde les nouvelles
de ses Fils dispersés... De ces nouvelles, il vibrait, se désolait ou se
réjouissait. Ce n'est pas assez dire : ces lettres où s'épanchaient tant
d'espérances et tant de peines, c'était sa vie même. Quelque chose, par-dessus
tout, frappait en lui : un grand amour pour sa famille religieuse, amour qui,
si surnaturel qu'en soit l'origine, restait délicieusement sensible. J'imagine
que l'homme de gouvernement, qu'il fut par devoir, dut avoir souvent fort à
faire, contre ce cœur-là. Le bienfait infini de l'Incarnation est d'avoir
rapproché Dieu de nous. Jésus pleura sur Lazare. Nous aimons à sentir le cœur
de chair en la vertu de charité.
Le Révérend Frère
Benoît-Marie est de Beaupréau, dans la région d'Angers. La douceur angevine,
dont s'enchantait Du Bellay, n'a pas supprimé en lui une vivacité de réaction
et d'impressions qui me semble plutôt des bords de mon Adour et de ma Nive. Ses
soixante-dix-sept ans l'ont laissée intacte et frémissante. Tout au long de son
généralat, elle maintenait ses collaborateurs immédiats en état d'alerte et,
mettant l'accent sur des détails que la paresse de l'esprit humain submergerait
aisément, elle incitait à une activité continue. Le regard l'exprime où domine
d'ailleurs une bonté toujours en éveil.
Un jour, je
l'interrogeai sur l'œuvre de son généralat: « Mon généralat, me dit-il, n'est
que l'histoire de mes projets. Ma première préoccupation était d'une formation
ascétique plus forte pour nos religieux. Dans ce but, j'aurais voulu d'abord
ajouter quelques mois au second noviciat institué par mon prédécesseur. Dans la
période où je me trouvai chargé de cette institution, j'ai été à même d'en
apprécier les avantages considérables. Ce second noviciat, un peu plus
prolongé, étendu à de plus nombreux sujets, moins âgés par ailleurs que ceux
qu'on y avait admis précédemment, eût certainement produit les plus heureux
fruits et formé des religieux d'élite. »
Le Révérend Frère me
livrait ainsi la préoccupation dominante de son gouvernement : former de
parfaits religieux-éducateurs. Ses circulaires rappelaient constamment les
devoirs du gabriéliste, les vertus dont il doit s'armer et provoquaient à une
vie intérieure sans cesse approfondie. Dans cet esprit, le Révérend Frère
souhaitait fonder en Espagne, en Italie, au Canada, en Belgique, un noviciat
doublant celui qui y existait déjà. Il en voulait également pour sa mission de
l'Inde, au pays de Coonoor, chrétienté très ancienne, et aussi en France, dans
la Lozère ou l'Aveyron, en Auvergne... Quand il s'agissait des juvénistes, son
âme entrait en ébullition. L'avenir de l'Institut n'est-!' point en eux ? Sa
meilleure joie était de se trouver au milieu de ces enfants au cœur pur, à
l'âme généreuse, à la piété fervente, pépinière de Saint-Gabriel. Ouelque temps
qu'il fît, s'il avait décidé de se rendre de Saint-Laurent au juvénat de La
Tremblaye, nul ne l'en aurait pu empêcher. Neuf bons kilomètres ? N'importe !
Au point du jour, il prenait sa canne et s'en allait. Je pense au cantique de
Montfort : « Le démon crie et la chair
dit : restez au feu, restez au lit. » Le Révérend Frère n'en avait cure et
allait où le menait sa paternité.
A l'entendre, on
croirait qu'il n'a pu faire et n'a fait que pleurer sur des ruines. Sa modestie
lui dissimule que, appuyé sur ses assistants, il a fait face à l'orage, sauvé
tout ce qui pouvait l'être et maintenu, contre vents et marées, ce qui devait
être maintenu. Aujourd'hui, où son âge et son état de santé l'ont obligé à se
démettre de sa charge, il pourrait notamment, jetant un regard en arrière, se
rappeler qu'avec son conseil il a provoqué, pour le plus grand bien de
l'Institut et de l'histoire de l'Eglise, une étude méthodique de la filiation
montfortaine des Frères, faite selon les bonnes règles de la critique
historique; du même coup, la biographie de Montfort s'est enrichie de chapitres
inédits.
Comment ne pas associer,
dans mon souvenir; au nom du Révérend Frère Benoît-Marie, ceux de ses trois
assistants embarqués avec lui pour le meilleur et pour le pire ? La sagesse,
vertu essentielle de qui participe au gouvernement religieux, est répartie sur
eux trois, avec une aimable abondance. Elle se nuance de l'un à l'autre, selon
le tempérament de chacun.
Le Frère A.-J...,
premier assistant, est un Vendéen de Vendée, j'entends de la vieille Vendée
militaire, qui tient fortement sur les tranchées traditionnelles et ne se
laisse pas entamer. Son bon sens, qui répand un rare sentiment de sécurité,
l'avertit infailliblement de ce qui fait l'honneur d'une nation et d'un homme,
de ce qui les fait croître ou décroître et le défend die céder quoi que ce soit
aux divinités dévorantes d'un illusoire progrès. Nulle roideur en cela, mais
une santé morale solide et équilibrée, comme son être physique lui-même, car il
n'est pas de santé, comme il aime à dire lui-même, sans réaction; seul vit
celui qui réagit. Et puis, si bien assis que soit son ferme jugement sur
d'immuables principes, il a, dans l'appréciation — d'une imperturbable
franchise — qu'il porte sur les hommes et sur les choses, cet esprit de
finesse, qui est une des douceurs de la civilisation et la flexibilité que
donne une expérience bien dirigée. La sienne est riche et transparaît en ses
propos. Il est poète, je l'ai dit, et de l'école de Ronsard, mais ses pieds
restent calés sur la terre natale. Le regard de ses yeux bleus semble bien
parfois dépasser son interlocuteur et se perdre en ces nuées irisées où se font
et défont les rythmes et les rimes. Mais, dans ce même temps, l'observateur
pénétrant qu'il porte en lui s'est approprié, sans qu'il y paraisse, du fort et
du faible de quiconque pour en enrichir sa connaissance des hommes, et savoir
mieux les aimer, c'est-à-dire d'un plus lucide amour. Alors que l'immense
majorité des Anciens Combattants paraît s'être à jamais tue sur la guerre de
14-18, lui, il en parle sans cesse. C'est que, précisément, le chasseur à pied
qu'il fut a su voir, dans cette misère des misères, l'homme mis à nu par
l'impitoyable « cafard » et la détresse physique. L'expérience de la guerre lui
fut, on le sent, décisive. Elle n'est pas étrangère, notamment, à sa largeur de
vues. En ce temps-là, il fumait la pipe. Je la vois, sur une photo, pointée en
avant, en posture de combat; comme le regard net et direct, elle prend la ligne
d'horizon.
Le Frère Al...,
troisième assistant, écoute plus volontiers les savoureuses histoires du Frère
A.-J... qu'il n'en raconte lui-même. Mais nul doute que les silences où il se
complaît ne soient fort meublés. Lui aussi a sa belle expérience humaine ;
seulement, au lieu de fuser en propos abondants, elle mijote en lui doucement,
longuement, sous le couvercle de son silence, comme au bain-marie. Son
jugement, qu'il n'exprime qu'à bon escient, est également marqué au coin du bon
sens. De la prudence aussi et même j'imagine volontiers qu'en ce moteur
complexe qu'est l'administration générale d'un Institut religieux, il se
chargerait plus volontiers, si on' lui en donnait le choix, du frein que de
l'accélérateur. Le don d'un cœur généreux s'exprime chez lui par une amabilité
qui, depuis qu'il fut directeur du pensionnat de Saint-Gabriel, est, à
Saint-Laurent, légendaire.
Ces deux Vendéens, le
Frère A..., second assistant, et « homme du Nord », les complète au sein du
Conseil. Les fonctions de secrétaire général, qu'il assume, en sus de celles de
second assistant, trouvent en lui un écrivain au style direct, à la phrase
souple, déliée, ornée comme une lettrine de missel. Il parle comme il écrit et
il a le don, fort rare, de mener ses phrases, impeccablement bâties, jusqu'au
bout, quel que soit le nombre de parenthèses dont il lui a plu de les émailler.
Et voilà qui me plaît à souligner, face à nos contemporains qui, trop souvent,
avalent la moitié des mots et déshonorent l'autre moitié. Poète délicat lui
aussi, excellent à débanaliser dans ses vers les thèmes religieux, poète comme
le Frère A...-J..., comme le Frère G... M..., mais, comme eux aussi, trop pris
par les devoirs de sa charge pour sacrifier à la Muse chrétienne de longs
instants. C'est à l'occasion de quelque solennité qu'ils y emploient une plume
absorbée par de tout autres écrits, mais, précisément, la formule très
difficile, et généralement exécrable, des « vers de circonstance », j'admire
comme ils la réussissent, chacun dans un genre très différent. La conversation
du Frère A... révèle une charmante ironie, qui est un sourire de
l'intelligence, et que surveille de très près la parfaite urbanité de l'esprit.
Tel est le visage que prend, chez lui, cette sagesse qui, avec l'esprit
gabriéliste, fait de simplicité, de dévouement, d'abandon confiant en la
Providence, est bien le trait commun des trois assistants.
... Je pense à eux, à
tant d'autres de leur Institut, en ces dernières heures de mon séjour à
Saint-Laurent, qui fuient comme l'eau d'entre les doigts. Je n'ai jamais quitté
des lieux qui me sont chers sans avoir rêvé, solitaire, dans leurs méandres
familiers. Au pensionnat Saint-Gabriel, j'ai passé et repassé, éprouvant que le
présent prenait déjà la forme du souvenir, riche de ce que j'ai gagné ici,
pauvre de ce que je vais quitter, empli d'une pénétrante et reconnaissante
mélancolie. En cette cour d'entrée, dont le Frère T..., mon introducteur à
Saint-Gabriel, me décrivit les fastes et que longent, intacts, les murs du
premier pensionnat, l'ancienne chapelle, devenue garage pour les bicyclettes,
qui en débordent comme le foin de greniers trop pleins, la vieille maison
Supiot, surélevée d'un étage mais,
pour le reste,
pareille à elle-même,
que de vieux souvenirs dressés partout comme pour exorciser la galerie
trop neuve des parloirs ! Passée une voûte, quel éblouissement toujours
nouveau devant cette cour d'honneur qui, sur trois côtés, aligne des bâtiments
rectilignes où s'encastre la chapelle romano-gothique, dont la patine se marie
à merveille à l'ardoise bleue des toits ! Des parterres de fleurs et de plantes
font chanter à la belle saison leurs couleurs vives, savamment orchestrées par
un jardinier, fils spirituel de Le Nôtre. La belle statue de Montfort, œuvre de
Guéniot, domine, bienveillante et massive. Au delà, une rumeur emplit les
vastes cours de récréation. C'est la jeunesse des pays d'Ouest qui mène entre
deux classes le joyeux tapage de ses jeux. Je franchis une seconde voûte. Je
dépasse à ma droite la cour du juvénat, à ma gauche les bâtiments de l'école
professionnelle ; je m'engage sur la colline de la Salette. C'est le haut lieu
de Saint-Gabriel d'où les élèves de dernière année, à la veille de quitter
définitivement le pensionnat, élèvent le fervent cantique dei adieux. Moi-même,
ne suis-je pas un partant qui arrache avec peine de ce vieux sol les racines
que j'y ai poussées ? C'est bien ici qu'il convient que je rassemble mes
pensées éparses. Je suis au pied du tumulus où se dressent les statues de
Notre-Dame et de ses pâtres. Tout le parcours « gabriéliste » de la Sèvre est
sous mes yeux, j'en caresse du regard les rives : moulin, cascade, potagers et
prairies. Comme à Massabielle, au long du Gave, une grotte s'ouvre, au long de
la Sèvre, dans un massif naturel d'énormes rochers. La statue de Notre-Dame de
Lourdes est bien à sa place, en ce domaine où le ronronnement des ave accompagne constamment le murmure
des eaux. Passée la grotte, la Sèvre fait un coude brusque puis, entre les
collines escarpées, resserrées, s'en va vers le pays nantais. Là-haut, autour
du clocher, les choucas poursuivent leur ronde en criant...
De ces lieux monte
invinciblement une leçon de féconde stabilité. Si le joyeux dynamisme des Frères
de Saint-Gabriel m'assure qu'ils sauront s'adapter aux besoins vrais et sains
des temps nouveaux, comme aussi défendre efficacement leur œuvre scolaire admirable,
je me persuade aussi qu'ils sauveront de leur tradition ce qui doit être sauvé.
La spiritualité de Montfort, dont ils se pénètrent de plus en plus, sera leur
axe indéfectible. Quelque développement que prennent dans l'avenir leurs
provinces autres que celles de l'Ouest, et si puissante que devienne, pour le
plus grand bien de leur Institut, la collaboration du Nouveau-Monde, puisse
leur origine vendéenne, marquée d'un sceau sacré par leur fondateur, imprégner
leur développement futur ! Ce collège de Saint-Laurent-sur-Sèvre, où je promène
mes pas, c'est le conservatoire du plus pur esprit vendéen. Qu'il reste pareil
à lui-même ! Il ne sera jamais un anachronisme parce qu'il représente des
valeurs éternelles, et qu'à ces valeurs le monde, aujourd'hui en folie, reviendra
un jour, s'il veut vivre.
TABLES
TABLE DES ILLUSTRATIONS
I. —
Nantes Ancestral. Gravure du xviiie siècle. (Musée d'archéologie de Nantes.)
II. — Une Sortie d'Ecole
au
xviii
e
siècle.
Dessin d'Edouard Garnier d'après Augustin de Saint-Aubin. (Musée d'archéologie
de Nantes.)
III. — La Maison «
Providence » de Grignion de Montfort a Nantes, située cour Catuy, rue des
Hauts-Pavés.
IV. — Calvaire de
Pont-Château au temps de Grignion de Montfort. (Cliché Coissard.)
V. — René Mulot,
Missionnaire. Gravure du
xviii
e
siècle.
Louis-Marie Grignion de Montfort, d'après une gravure du temps.
VI. — Testament de
Grignion de Montfort, écrit au bas de quatre feuillets de l'opuscule « Pour
bien mourir ».
VII. — La Maison ou est
mort Grignion de Montfort (actuellement transformée en chapelle), ancien
parloir des Filles de la Sagesse. (Photo Coissard.)
VIII. — Le Révérend Père
Deshayes, Restaurateur des Frères de l'Instruction chrétienne du Saint-Esprit.
IX. — « La Providence »
pour les garçons, fondée par le R. P. Deshayes, occupait le Petit-Saint-Esprit
sur la rue oui est en face de l'église paroissiale.
X. — Frère Augustin,
Premier Supérieur Général des Frères de Saint-Gabriel. Frère Siméon. Second
Supérieur Général (1852-1862).
XI. — Château du Rois
Tissandeau, Noviciat des Frères de Saint-Gabriel. Le Scolasticat et l'Ecole
d'Agriculture de La Mothe-Achard.
XII. — Le Juvénat de La
Tremblaye (M.-et-L.). Le
Pensionnat de Saint-Laurent-sur-Sèvre. Cour d'honneur.
XIII. — Etablissement
des Sourds-Muets et Aveugles de la Persagotière a Nantes. (Photo Studio-Rex.)
XIV. — Un Frère de Saint-Gabriel faisant la classe aux sourds-muets.
(Photo Studio-Rex.) Bernard Ruez faisant une partie d'échecs avec son
professeur, à l'Institution des Sourds-Muets, Aveugles et Sourds-Muets-Aveugles
de Poitiers. XV. — Image imprimée par la postulation à l'occasion de la
Béatification de Louis-Marie Grignion de Montfort.
XVI. — Le Tombeau du
Père de Montfort dans la nouvelle église de Saint-Laurent-sur-Sèvre. (Photo de
Lizardry.)
TABLE
DES MATIERES
Avertissement 7
Introduction 9
Première Partie
LE FONDATEUR
I. — Vie de Grignion de
Montfort 15
II. — L'Apôtre de
l'Ecole 70
Deuxième Partie
HISTOIRE DES FRÈRES DE
L'INSTRUCTION CHRÉTIENNE DU SAINT-ESPRIT DITS AUJOURD'HUI DE SAINT-GABRIEL
I. — De la mort du P. de
Montfort à la mort du P. Deshayes (1716-1841) 115
II. — La Crise
intérieure (1841-1875) 148
III. — Développement de
l'Institut (1842-1935) 174
Troisième Partie
L'ESPRIT DE
SAINT-GABRIEL
I. — La Règle 213
II. — Formation
religieuse et culture intellectuelle 240
Quatrième Partie
LES ŒUVRES EN FRANCE ET
A L'ÉTRANGER
I. — Les âmes délivrées
(Institutions de sourds-muets, aveugles et sourds-muets-aveugles). 269
IL — Un pensionnat
régional à Saint-Laurent-sur-Sèvre 307
III. — L'Institut à
l'étranger. Le Canada 335
Conclusion 359
Achevé d'imprimer
sur les presses de l'imprimerie moderne,
177, avenue Pierre
Brossolette, à Montrouge (Seine),
le cinq juin
mil neuf cent quarante-six.
(c. o. :
31.2348)
Dépôt légal
: 2e trimestre I 946
N° d'édition
: 230 –
N° d'impression 343
Nhil Obstat
Feria quinta
in Cœna Domini die 18a Aprilis 1946
J. Calvet, censor delegatus.
Imprimatur :
Luteti
æ
Parisiorum Feria tertia
die VIIa
Maii 1946,
A. Leclerc,
V. g.
[1]
Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge.
Edition du Centenaire, pp. 41, 99.
[2]
Une charmante légende pavoisait ce vieux
bourg breton. Les vieilles gens contaient d'âge en âge qu'en 1386, une jeune
fille, belle évidemment comme le jour, fut enfermée au château de Montfort par
le seigneur du lieu. Dans sa détresse, elle promit à saint Nicolas, s'il la
sauvait, d'aller fin remercier publiquement, en l'église qui lui était dédiée.
De fait, elle parvint sur le soir à s'évader, mais pour tomber dans les mains
des soldats du guet qui tentèrent aussitôt d'assouvir sur elle, pour leur
propre compte, la basse passion de leur maître.
Jetant autour d'elle un regard désespéré, elle aperçut deux canes sauvages qui s'ébattaient dans un étang proche. De tout son pauvre cœur affolé, elle conjura saint Nicolas de lui obtenir que, si elle venait à mourir, ces oiseaux, témoins de son innocence, accomplissent à sa place son vœu. Par miracle, elle put se soustraire aux brutalités des forcenés. Mais la grande frayeur qu'elle ressentit la fit trépasser peu après. Or, comme on célébrait cette même année la fête de «on saint préféré, voici qu'une cane entra dans l'église, suivie de ses canetons.
Ayant salué le Saint Sacrement, puis la statue de saint Nicolas, elle se posa avec sa couvée au milieu des fidèles émerveillés. A la fin de l'office, laissant au plus populaire des saints l'offrande d'un de ses petits, elle repartit, on ne sait vers quels mystérieux marais. Presque chaque année, à la même date, affirme la tradition, il en fut ainsi, jusqu'en 1744, où elle quitta l'église pour n'y plus jamais revenir. Louis Grignion, que nous sachions, n'a jamais parlé de cette légende, dont son enfance dut être bercée. Elle est aujourd'hui oubliée, évanouie, ainsi que les enceintes crénelées de la vieille ville, son château-fort, son prieuré, ses douves profondes. Au cœur d'un paysage frais et confidentiel où le Meu et le Garun joignent leurs eaux lentes, Montfort-la-Cane est devenu Montfort-sur-Meu.
Jetant autour d'elle un regard désespéré, elle aperçut deux canes sauvages qui s'ébattaient dans un étang proche. De tout son pauvre cœur affolé, elle conjura saint Nicolas de lui obtenir que, si elle venait à mourir, ces oiseaux, témoins de son innocence, accomplissent à sa place son vœu. Par miracle, elle put se soustraire aux brutalités des forcenés. Mais la grande frayeur qu'elle ressentit la fit trépasser peu après. Or, comme on célébrait cette même année la fête de «on saint préféré, voici qu'une cane entra dans l'église, suivie de ses canetons.
Ayant salué le Saint Sacrement, puis la statue de saint Nicolas, elle se posa avec sa couvée au milieu des fidèles émerveillés. A la fin de l'office, laissant au plus populaire des saints l'offrande d'un de ses petits, elle repartit, on ne sait vers quels mystérieux marais. Presque chaque année, à la même date, affirme la tradition, il en fut ainsi, jusqu'en 1744, où elle quitta l'église pour n'y plus jamais revenir. Louis Grignion, que nous sachions, n'a jamais parlé de cette légende, dont son enfance dut être bercée. Elle est aujourd'hui oubliée, évanouie, ainsi que les enceintes crénelées de la vieille ville, son château-fort, son prieuré, ses douves profondes. Au cœur d'un paysage frais et confidentiel où le Meu et le Garun joignent leurs eaux lentes, Montfort-la-Cane est devenu Montfort-sur-Meu.
[3]
Dans ce chiffre, figure un enfant, né avant Louis,
et mort au bout de quelques jours.
[4]
Pour autant qu'on en peut juger
aujourd'hui, cette demeure ne se différenciait guère des fermes de la contrée;
il est vrai que la façade sud en a été rebâtie sans portes ni fenêtres, que le
vivier et les douves qui l'entouraient ont disparu, et qu'elle est découronnée
d'une tourelle qui lui conférait jadis allure de gentilhommière, mais tout cela
restait assez modeste. L'agrément de cette résidence était surtout fait du
paysage, riant, boisé comme celui de Montfort-la-Cane. Les tonnelles et
charmilles du jardin captaient les ombres chaudes de l'été. Mais l'humeur de
Jean-Baptiste Grignion n'était point de celles qu'apaisent les séductions de la
nature, et l'atmosphère familiale resta, de son chef, tourmentée.
[5]
Le
petit séminaire ne différait du grand séminaire que par le prix de la pension
qui y était moins élevé.
[6]
De
plus en plus, Louis-Marie Grignion sera connu sous le nom de Montfort. Derrière
lui, il a coupé tous les ponts. Le nom qu'il tient de son père doit lui-même
disparaître à ses yeux, aux yeux de tous, puisqu'il rappelle les liens
terrestres qu'il a brisés à jamais. X..., de Montfort-la-Cane, il ne veut pas
être autre chose. Ce n'est plus lui-même, c'est Jésus qui vit en lui. Mais la
gloire éternelle s'est emparée de sa propre personne sous 1« nom même qui le
devait vouer à l'oubli.
[7]
Ces
gouvernantes n'étaient pas, en effet, des religieuses, et le règlement
qu'entendait leur imposer Montfort était, de fait, bien roide pour des laïques.
[8]
De
cette famille de Lescure est issu le général de ce nom, qui s'illustra dans les
guerres de Vendée et qu'on appelait « le saint du Poitou ».
[9]
Le
Père Fradet, de la Compagnie de Marie, a donné une admirable édition critique
des
Cantiques de Montfort.
[10]
. Je pense notamment ici à M. Bourdeaut, prêtre du
diocèse de Nantes qui, sur les missions et les œuvres de Montfort dans ce
diocèse, a publié, dans un
Bulletin paroissial,
une série d'études remarquables, qui dissipent bien des erreurs graves et
trop courantes. Je pense également au Frère Benoît du Pont (Coissard), dont les
recherches ont abouti, sur nombre de points obscurs, à des découvertes de
considérable intérêt.
[11]
A l'hôpital, enfants et adultes valides travaillaient. C'était même le but
de l'établissement que de lutter contre la mendicité et le vagabondage par un
travail adapté aux forces et capacités des hospitalisés. Les lettres patentes
accordées par Louis
xiv
à l'hôpital de Poitiers insistent sur la nécessité
de manufactures et donnent droit à l'Hôpital d'en instituer comme bon lui semblera.
Elles conféraient même certains privilèges à ceux qui instruisaient les pauvres
en métiers manuels pendant trois ans. La manufacture de l'hôpital de Poitiers
comportait une filature de laine, lin et chanvre, une fabrique de
bas, de bonnets et de serge. Les métiers de
menuisier, de tailleur, boulanger, jardinier et sabotier y étaient enseignés
par
des artisans expérimentés venus du dehors. La charge de Montfort, comme
directeur de la manufacture, consistait à surveiller les ateliers, à diriger le
travail des hommes et des enfants, à remettre chaque mois leurs gains au
bureau. La manufacture était donc une véritable œuvre d'assistance par le
travail.
[12]
M. Olivier était le fils de cette veuve Olivier,
excellente chrétienne, qui avait cédé à Montfort la petite maison de la cour
Catuyt, dont il fit l'hôpital des Incurables. M. Olivier, prêtre très zélé,
seconda Montfort en maintes missions dans la région nantaise, durant le séjour
qu'il y fit de 1708
h
1711. Plusieurs biographes de Montfort — notamment Laveille et Blain —
accusent couramment M. Olivier de jansénisme et, à l'égard de Montfort, de
trahison. M. l'abbé Bourdeaut, dont j'ai parlé plus haut, fait bonne justice de
ces deux légendes. Il prouve, pièces en mains, que M. Olivier était homme de
saine et ferme doctrine, puisée à Rome où il avait fait ses études, et qu'il
fut même nommé supérieur de la communauté du Bon-Pasteur pour conjurer
l'influence de son prédécesseur, le fameux janséniste La Noë Mesnard, dont
Montfort eut tant à pâtir en la communauté Saint-Clément. Quant à son amitié
pour Montfort, elle fut indéfectible. Il reçut de l'évêque de Nantes la pénible
mission de transmettre à son ami l'ordre de quitter Pontchâteau pour n'y plus revenir,
mais, d'un tel ordre, il n'était à aucun degré responsable.
[13]
Ceux qui traquèrent Montfort à La Rochelle se proposaient bien fermement
d'occire le Frère Mathurin par surcroît.
[14]
Il faut toujours revenir à Grandet, comme à la biographie-souche.
Il était contemporain de Montfort et publia son petit livre, huit ans seulement
après sa mort. Ses informateurs n'ont été autres que MM. des Bastières et
Olivier, témoins die premier ordre, eux-mêmes abondamment renseignés par les
Frères. Après lui, toujours sur le plan de l'ancienneté (1785), Picot de
Clorivière est le plus intéressant à consulter. Il a utilisé Grandet lui-même
et surtout Besnard, supérieur général de la Compagnie de Marie, de 1755 à 1788,
qui a écrit en effet une
Vie de Montfort,
restée jusqu'à ce jour, on se demande pourquoi, à l'état de manuscrit.
Quant au chanoine Blain, son témoignage, dont Picot de Clorivière s'est aussi
servi, consigné en un mémoire non publié intégralement, est d'un intérêt sur
lequel il serait bien vain d'insister puisqu'il fut, mieux que le contemporain,
l'ami de M. Grignion. Il convient seulement de se méfier de la tendance de son
esprit à l'amplification. Ses indignations contre ceux qu'il suppose avoir été
les adversaires de ses héros (Grignion, Jean-Baptiste de la Salle) ne tombent
pas toujours juste ou sont exagérées. Ainsi de son jugement sur M. Olivier
[15]
En fait, ce n'est pas quinze ans, mais onze, Frère
Mathurin n'ayant rencontré qu'en 1705 Montfort qui mourut en 1716.
[16]
Les archives de l'hôpital de Nantes nous apprennent
qu'un Louis Danto — dit Frère Louis, selon la désignation, alors commune aux
laïcs qui donnaient gratuitement leurs services aux hôpitaux — enseignait à
l'école du dit hôpital depuis le 14 mars 1696, et resta dans ces fonctions jusqu'à
sa mort, survenue le 3 janvier 1731. Il y était entré au pair, par pur dévouement,
comme il arrivait à nombre de jeunes chrétiens fervents. Dans ses visites,
certainement nombreuses et prolongées à l'hôpital de Nantes, de 1708 à 1711,
Montfort n'a pu manquer de le connaître, de l'apprécier, d'avoir avec lui de
ces entretiens, peuplés de Dieu, où il se complaisait. Pas davantage, il n'aura
omis de l'initier à la méthode scolaire de Mgr de la Poype, qu'il avait
appliquée à Poitiers et qu'il appliquera à La Rochelle. L'a-t-il enrôlé dans
son équipe de Frères? On n'en a pas la preuve directe. Mais on a pu constater
récemment que, sur le registre où Frère Louis signait certains reçus, sa signature
ne figure pas du 22 janvier 1714 au 16 mai 1716, ce qui implique son absence de
Nantes dans cette période; or, c'est celle précisément où Montfort préparait,
puis commençait les écoles de La Rochelle. N'est-ce point le Frère Louis,
devenu ainsi le Frère Louis de la Rochelle, qu'il aurait appelé en cette
dernière ville pour y prendre une direction que lui méritait son expérience ?
La supposition est d'autant plus vraisemblable que — le testament de Montfort
nous le dit — il y avait à Nantes des Frères montfortains qui faisaient
l'école.
[17]
M. l'abbé Baraud dit expressément que le premier régent de l'école de
garçons de Saint-Laurent-sur-Sèvre fut le Frère Mathurin. Il est de fait qu'à
partir de 1714, le Frère Mathurin n'est jamais plus nommé comme auxiliaire des
missions de Montfort. On ne trouve par ailleurs son nom, sur les registres
paroissiaux de Saint-Pompain où résidèrent, à partir de 1716, MM. Vatel et
Mulot, qu'à partir de 1718. Donc, dans les deux années qui suivirent la mort de
Montfort, le Frère Mathurin ne se trouvait pas avec ces deux prêtres. Le temps
de sa « régence » à Saint-Laurent-sur-Sèvre devrait donc être compris entre
1714 et 1718.
[18]
Le document vaut, par lui-même d'abord,
d'être reproduit tout entier. Mai* comment ne pas souligner que, à ma
connaissance, il l'est ici, intégralement et avec la ponctuation qui s'impose,
pour la première fois.
[19]
Outre les inestimables indications d'ordre pratique
que j'ai soulignées ailleurs, touchant les Frères enseignants, ce testament,
qui est un acte juridique et ne veut être que cela, laisse filtrer la
sollicitude minutieuse dont le Fondateur les entoure. Au dernier moment, la
date étant déjà apposée par M. Mulot
au testament, il pense soudain aux meubles qui sont
à Nantes, et, voulant préserver les Frères de cette ville d'un détournement
possible, il fait spécifier que tous ces meubles sont pour eux et pour eux
seuls. C'est même à Nantes que, pour plus de précautions, M. Mulot, quelques
mois plus tard, fera enregistrer l'acte, sans doute sur la recommandation que lui en aura faite Montfort.
Ce n'est pas tout :
ces Frères, liés par des vœux et qui, en conséquence, sont bien une
congrégation, si embryonnaire qu'elle soit, restent sans supérieur. Qui donc
sera leur tuteur ? Ce ne peut être que l'évêque, et c'est pourquoi Mgr de
Champflour est institué légataire, M. Mulot étant particulièrement chargé de
l'exécution, dans le détail, des clauses du testament. Ainsi Montfort mourra
rassuré sur le sort de ses Frères : l'évêque fixera, quand et comme il lui
conviendra, la question du gouvernement.
[20]
Il semblerait que M. Mulot eût dû donner à sa société l'appellation que
Montfort avait de tout temps réservée à ses futurs missionnaires et qui lui
était très chère : Compagnie de Marie. Ayant rejeté la donation de Vouvant, il
n'avait plus de raisons juridiques à garder l'appellation :
du
Saint-Esprit.
Cependant il s'est arrêté à celle-ci. Par respect peut-être pour le
testament qui l'attribuait aux Frères, ou encore pour marquer le lien qui
unissait sa société au séminaire fondé par Claude Poullart des Places. De ce
séminaire, il espérait, comme Montfort lui-même, des recrues. Et, de fait, le
séminaire envoya de nombreux sujets à Saint-Laurent tout au long du XVIIIe
siècle et jusqu'en 1820. Le public, lui, considérant M. Mulot pour ce qu'il
était en effet, un second fondateur, faisait court en disant « les Mulotins ».
C'est surtout sous ce nom que. dans la région, les missionnaires étaient
connus.
[21]
Les Filles de la Sagesse, en effet, n'étaient
plus à La Rochelle depuis 1717. Alors qu'elles y tenaient l'école depuis plus
de trois ans avec un succès remarquable, la Mère Marie-Louise de Jésus, cédant,
dans un but tout apostolique, aux instances de sa mère accourue pour l'en
presser, était revenue à l'hôpital de Poitiers avec deux de ses compagnes,
tandis que les deux autres retournaient dans leur famille. Ainsi prenait fin la
fondation Montfortaine de l'école des Filles de La Rochelle. La Mère
Marie-Louise de Jésus ne tarda pas à déplorer sa décision. « Elle ne doutait
point, dit Clorivière, que l'Ange de Ténèbres ne l'eût trompée en se
transformant en Ange de Lumière. » Elle était dans le plus grand désarroi
intérieur. C'est sur ces entrefaites que la marquise de Bouillé, s'étant rendue
à Poitiers, eut avec elle l'entretien qui sauva tout. En gagnant Saint-Laurent
les Filles de la Sagesse allaient bénéficier prodigieusement di charisme
émanant du tombeau.
[22]
Le nom de Frère Dominique apparait pour la
première et unique fois à côté de celui du Frère Philippe, un des Profès du testament,
dans une quittance délivrée, en 1717, par M. Clémençon, propriétaire de la
maison où se tenait l'école.
[23]
Délicieuse figure que celle de Henri-François de
Raccapé, marquis de Magnagne. Né en 1664 à Saint-Séverin-d'Anjou, il entre,
après une jeunesse parfaitement sage, dans les armées du roi. A pourfendre les
adversaires du royaume, il met une bravoure exemplaire, mais ses deux plus
grands ennemis sont le jansénisme et le duel. Bientôt, il démissionne, épouse
une pieuse demoiselle et rn a deux enfants. Devenu veuf, il se donne aux bonnes
œuvres. A partir d' ce moment — sauf les signes distinctifs de sa condition et
de son temps — c'est une manière de M. Dupont (de Tours). Il pense même à se
faire prêtre et en fait confidence au pape Benoît XIII, au cours d'un voyage à
Rome. Le pape l'engage à rester dans le monde, où il est appelé à faire un plus
grand bien. Sa vie est désormais celle d'un homme d'œuvres très mortifié. Il
prodigue fastueusement sa fortune, fonde hôpitaux, écoles, et surtout comble
les pauvres, auxquels il distribue jusqu'à ses vêtements, à telles enseignes
qu'il lui arrive d'être a court et d'emprunter à son domestique. Au moins deux
fois il rencontra Montfort et en fut conquis à lui à jamais. Après la mort du
grand Apôtre, il alla l'invoquer sur son tombeau. La marquise de Bouillé n'eut
pas grand'peine à mettre un aussi saint homme dans ses plans charitables. En
cette maison, qu'il avait achetée pour les Frères et où vinrent aussi habiter
les Missionnaires, il vient lui-même, partageant leur règle, vivant dans un
profond esprit de mortification, d'humilité et de pauvreté, jusqu'à l'âge de 86
ans où il mourut. La communauté du Saint-Esprit rendit un insigne hommage à ce
bienfaiteur, en l'inhumant aux côtés de M. de Montfort en l'église de
Saint-Laurent-sur-Sèvre.
[24]
Ce Le Vallois est une conquête posthume de
Montfort. Quand celui-ci, s'étant rendu à Paris aux vacances de 1713, eut les
entretiens que l'on sait au séminaire de Saint-Esprit. il avait jeté son dévolu
sur lui. à sa manière qui ne ressemblait jamais à celle de tout le monde. M Le
Vallois, alors en cours d'études, se trouvait dans un groupe de séminaristes
oui entourait le missionnaire. « Qui vais-je choisir ? » leur demanda Montfort.
et, sans attendre la réponse, il coiffa de son propre chapeau le jeune Le Vallois
: « C'est celui-ci. Fit il. Il est bon; il m'appartient; je l'aurai. » Il l'eut
en effet, par delà le tombeau.
[25]
Saint Jean-Baptiste de La Salle, dès qu'il eut formé ses premiers Frères,
voulut se démettre, à plusieurs reprises, de la Supériorité. Chaque fois, son
Institut s'y opposa, mais le fondateur tenait essentiellement à ce que le
Supérieur de l'Institut fût, du moins après lui, un Frère et il fit de ce principe
un article capital de ses constitutions.
[26]
Cette règle, dite de 1773, ne comportait pas
de vœux. Par là, le P. Besnard rompait avec la tradition montfortaine. La règle
de 1713, telle que la rédigea Montfort et la compléta M. Mulot, imposait les vœux.
[27]
Il est difficile d'animer cette sèche nomenclature. Sauf les noms des
Frères Philippe et Dominique, qui sont signalés en 1717 dans une quittance de
M. Clémençon, propriétaire de la maison des écoles, on ne possède aucune
précision individuelle sur les Frères Montfortains qui enseignèrent durant
cette longue période. Le soul point intéressant qui ait surnagé est l'arrivée
du Père
Balch comme Supérieur. Depuis plusieurs années, il était aumônier de l'Hôpital
Saint-Louis à La Rochelle, avec, à ses côtés, le P. Dizy, membre également de
la Société du Saint-Esprit, à Saint-Laurent, comme aumônier en second. En 1725,
M. Mulot y avait envoyé M. Vatel. En 1754, le P. Besnard remplace le P. Balch.
Rien qui doive surprendre dans l'intérêt porté à l'hôpital de La Rochelle par
les Pères de Saint-Laurent : il s'y trouvait, de 1715 à 1718, puis à partir de
1725, des Filles de la Sagesse. Comme à l'hôpital, le P. Balch, aux écoles, eut
à diriger spirituellement une communauté montfortaine. Ici et là, il était bien
à sa place et dans son élément. Pour les Frères des Ecoles, sa présence dut
être d'un grand réconfort. Ils avaient en lui, comme supérieur, non un prêtre
étranger, mais un Père montfortain; ainsi étaient-ils environnés de
l'atmosphère même de la Maison-Mère. De plus, entré dans la Société en 1740, le
P. Balch avait vécu avec les premiers Pères, disciples de Montfort, MM. Mulot,
Vatel et Le Vallois. Les Frères respiraient avec lui le pur esprit des
origines. Le dimanche, les écoles n'ayant pas de chapelle, le P. Balch disait
la messe à celle de l'hôpital où se retrouvaient donc les trois familles de
Montfort.
Des écoles à l'hôpital,
il y avait courant continu. L'hôpital n'ayant pas d'école, il incombait à
l'aumônier d'apprendre aux enfants à lire et à écrire. Pour soulager le P.
Dizy, puis son successeur, le P. Balch envoya l'un des Frères de son école à
l'hôpital, une fois la classe terminée, afin de remplir cet office.
[28]
Le P. Besnard ne devait pas être optimiste
sur le développement de la Société, puisque sa règle de 1773 limite le nombre
de Pères à douze. Il est vrai que Montfort semble n'avoir jamais souhaité une
société très étendue. De petites équipes, mais de qualité exceptionnelle, c'est
à quoi parait bien s'être fixée sa surnaturelle ambition pour la Compagnie de
Marie. L'idéal, que définit la torrentielle Prière
à Dieu pour demander des Missionnaires, implique une rigoureuse sélection.
[29]
Il n'en garda pas moins la supériorité des Sœurs de
Saint-Gildas et, conjointement avec l'abbé de Lamennais, celle des Frères de
Ploërmel. Comme il éprouvait toujours allégresse à entasser Pélion sur Ossa, il
fonda, en 1839, un autre institut, les Frères agriculteurs de
Saint-François-d'Assise qui, d'ailleurs
,
après un temps de prospérité, s'éteignit. Enfin, il donna son concours le plus
actif à la fondation ou au développement des Soeurs de l'Ange Gardien, de la
Congrégation de Saint-Jacut, des religieuses de Saint-Joseph de Beaupreau. Il
s'intéressa, sur
la demande de l'abbé Gaillard, fondateur des
Sœurs de Sainte-Philomène, à la fondation de cet institut poitevin, mais de
façon incidente et passagère. Mgr Laveille, dans sa Vie de Gabriel Deshayes, a
notablement exagéré son rôle en cette affaire. Il reste que la somme de
travaux, embrassée par le P. Deshayes, est proprement vertigineuse.
[30]
Ainsi à Torfou. II y existait une Congrégation des
Filles de Sainte-Marie, fondée par le curé, M. Foyer. Celui-ci ayant demandé au
P. Deshayes deux sœurs de son Institut de Saint-Gildas, le Père les lui envoyé.
La petite communauté prospérait, atteignant le chiffre de dix-huit membres,
quand M. Deshayes s'avisa de s'en considérer comme le fondateur et agit en
conséquence. M. Foyer n'aimait pas les conflits. C'était une âme douce et
plaintive. Bien que formulées sur le mode mineur, ses réclamations agacèrent le
P. Deshayes qui décida incontinent le départ des deux sœurs qu'il avait
envoyées, ainsi que de toutes les novices et postulantes. M. Foyer se trouva
soudain devant une maison vide. A Beaupréau, les choses furent menées plus
rondement encore. L'abbé Rabouan avait fondé, conjointement avec le P.
Deshayes, une Société des Sœurs de Saint-Joseph. Bientôt, désaccord : le P.
Deshayes voulait ces religieuses uniquement enseignantes; M. Rabouan les
voulait aussi hospitalières. Le P. Deshayes trancha la question en débouchant,
un beau jour, à Beaupréau, au grand fracas d'un coche ventru. Ayant réuni
religieuses et postulantes de Saint-Joseph, il leur adressa une exhortation
d'une brièveté toute militaire, et, avant qu'elles aient pu se ressaisir, tassa
la Communauté dans le coche qui partit à grande allure pour
Saint-Gildas-des-Bols. Les Sœurs y furent installées dans un établissement
qu'il venait d'acheter. Le P. Deshayes n'avait laissé au malheureux M. Rabouan
qu'une religieuse infirme, quelques malades, et l'exercice obligé de la vertu
de résignation.
[31]
Il en témoignait parfois de façon sommaire. Un
jour, visitant une Communauté de la Sagesse, il s'indigna d'un par
quet à son
goût trop bien ciré. Il prit un papier, le froissa, cracha dessus et, de ses
gros souliers, l'écrasa sur le parquet délictueux.
[32]
Au témoignage du Fr. Augustin, les Frères «
mangeaient à la table de MM. les curés et devaient la quitter au moment où l'on
servait le dessert. » Ce n'est qu'après plusieurs sollicitations des
pasteurs eux-mêmes que le P. Deshayes « permit aux Frères qui mangeaient à la
table de MM. les curés d'accepter un fruit. Plus tard, on leur a permis de
rester jusqu'à la fin du repas, lorsqu'il n'y avait point de compagnie; mais
ils ne devaient prendre ni café, ni liqueurs. »
[33]
Elle fut présentée avec la demande d'approbation
légale pour cinq départements.
3. Qu'était devenue la Règle primitive ? Le Frère
Siméon, futur supérieur général des Frères de Saint-Gabriel, a certifié « avoir
vu une Règle faite sans doute par un des successeurs du P. de Montfort et dans
son esprit. Un des anciens Frères, a-t-il ajouté, m'a dit qu'une ancienne Règle
avait été détruite. » Le P. Laveau, des Missionnaires du Saint-Esprit, dans sa
Dissertation
(qu'une lettre de lui
permet de dater d'avant le 16 octobre 1863), écrivait : « Les Frères du
Saint-Esprit, institués par le P. de Montfort, existaient avant l'arrivée du P.
Deshayes à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Ils avaient leur Règle et la suivaient. »
Enfin, la Règle de 1773, établie par le P. Besnard, ne mentionne même pas les
Frères, d'où il semble résulter que ceux-ci avaient leur règle particulière,
par ailleurs.
Que la Règle primitive ait disparu ou ait été
détruite, les gens bien informés ne sauraient s'en étonner. Destructions ou
disparitions, également surprenantes, ouvrent des lacunes béantes
dans la
documentation montfortaine, pour le plus grand désespoir de l'historien. Le Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge
ne fut-il pas retrouvé, par hasard, en mai 1842, alors que la cause de
béatification était commencée depuis treize ans ? La fameuse Prière pour demander des Missionnaires
ne fut-elle pas ignorée du P. Deshayes jusqu'en 1831, où on la retrouva par hasard
encore ? On pourrait multiplier les exemples analogues.
[35]
Les initiatives prises par le P. Deshayes en
faveur des sourds-muets sont un de ses plus beaux titres à la reconnaissance
universelle. Il en sera question dans un chapitre spécial.
[36]
Une bonne fortune du Fr. Augustin fut d'avoir à ses
côtés, comme maître des novices, un Frère de caractère aussi doux et conciliant
que le Fr. Siméon. Celui-ci trouva, en sa nature et en sa vertu, le moyen de
s'accommoder, à toute heure du jour, à l'humeur inégale du Fr. Augustin.
Le Fr. Siméon, et même le Fr. Augustin, étaient
bien jeunes pour leurs emplois. Mais le P. Deshayes, dans les intervalles de
ses voyages, en contrôlait de près l'exercice, et son intervention fit beaucoup
pour transformer leurs aptitudes, d'ailleurs remarquables, en une véritable maitrise.
[37]
A vrai dire, leur sollicitude était parfois
accablante. Ayant pris l'habitude d'user largement des Frères pour les travaux
de jardinage, elles se faisaient tyranniquement maternelles. Les Frères,
tiraillés de l'enclos de Saint-Laurent à celui de la Sagesse, en gémissaient.
Le Fr. Augustin, notamment, trouvait cela fort mauvais. En bon psychologue, le
P. Deshayes estima que le meilleur remède était de rendre les Frères plus
indépendants financièrement des Sœurs. Il prit à cet égard, en bon administrateur,
quelques mesures qui ramenèrent le bon ordre. Les Sœurs restèrent aussi généreuses,
mais leur don fut plus patient, les Frères aussi serviables, mais leur service
plus volontaire.
[38]
Voici ce que, dans cette histoire, le P. Dalin dit
de la Société des Frères : « Elle était menacée d'une ruine complète et
prochaine quand la Providence suscita pour la sauver M. Deshayes... Entrant dans
l'esprit et les vues de Montfort, il la releva bientôt et la développa au point
qu'il devînt nécessaire de partager les occupations, afin que chacun pût
s'appliquer avec plus de fruit à son œuvre spéciale. Il
se
forma en conséquence une Société particulière des Frères
cons
acrée à l'instruction chrétienne des enfants
(Réplique,
notons-le encore, des Frères da la Communauté du Saint-Esprit pour faire les
écoles charitables)
tandis que les autres, conservant le nom des Frères du Saint-Esprit,
conservèrent aussi le reste des attributions primitives de leur
Institut. »
[39]
Quant à la
Congrégation de la Sagesse, elle comprenait, à l'arrivée du P. Deshayes, 96
maisons et 778 religieuses; à la mort du P. Deshayes, elle comptait 1.668
religieuses réparties en 128 maisons. II faut néanmoins noter ici que,
congrégation déjà puissante, la Sagesse s'est développée, pour une grande part,
par son propre mouvement. En fait, elle était plutôt, vis-à-vis du P. Deshayes
et des deux autres communautés, créditrice quo débitrice.
[40]
Formules, d'ailleurs, qui lui
étaient, le plus souvent, commandées par la situation particulière — complexe
et délicate - de la Société des Missionnaires à l'égard des réglementations officielles,
fort, sourcilleuses, touchant les Congrégations.
[41]
Le Frère Abel qui, quelques mois après, devait
occuper une place éminente dans l'Institut des Frères, a fait bonne justice de
cette assertion extravagante. « Cette note, a-t-il écrit, contient deux grandes
erreurs que nous ne pouvons laisser passer : 1° il est faux que la congrégation
de Saint-Gabriel soit une branche de celle de Ploërmel... Elle est évidemment
une branche de celle du Saint-Esprit, dont elle a porté le nom et avec laquelle
elle n'a fait qu'un corps jusqu'au moment où elle a changé de demeure. Cette
note laisserait croire qu'il n'y avait point de Frères au Saint-Esprit. Il y en
avait quatre lorsque le P. Deshayes y envoya deux novices d'Auray. Quelques
jeunes gens venus de Bretagne et entrant en qualité de novices et de postulants
dans une congrégation qui comptait plus d'un siècle d'existence n'ont pu
absorber cette congrégation : ils se sont donnés à elle, ils se sont fondus en
elle aussi bien que les novices qui, pendant quatorze ans, sont entrés dans la
Communauté du Saint-Esprit et qui certainement n'ont jamais eu la pensée qu'ils
appartenaient de près ou de loin à la Congrégation de Ploërmel. Au reste, de
neuf sujets venus d'Auray en 1821, quatre sont retournés dans leur pays, deux
seulement sont entrés à Saint-Gabriel, les trois autres sont restés au Saint-Esprit;
2° il est faux en
second lieu que le P. Deshayes soit le
fondateur de la Congrégation des Frères de Ploërmel et que M. de La Mennais
n'en soit que le directeur. Pourquoi refuser le titre de fondateur à M. de La
Mennais et ne l'accorder qu'au P. Deshayes ? Tous deux ont été également
inspirés d'établir une Société de Frères pour l'instruction de la campagne.
Tous deux ils ont donné un commencement d'exécution à leur projet, l'un à
Auray, l'autre à Saint-Brieuc. C'est alors que ces deux hommes de Dieu se sont
connus et ont décidé d'unir leurs deux congrégations naissantes pour n'en faire
qu'une seule. »
Le Frère
Abel eût pu ajouter qu'en droit canonique l'assertion du Fr. Augustin était
insoutenable. Les Frères de Bretagne vivaient sous le régime des congrégations diocésaines,
et dépendaient donc, en l'espèce, des évêques de Saint-Brieuc et de Vannes.
Sortis de ces diocèses, les novices bretons envoyés à Saint-Laurent n'étaient
plus que des laïques, et, une fois
intégrés dans la communauté de Saint-Laurent, ils entraient sous le régime
approuvé par les évêques de La Rochelle au
xviii
» siècle pour les Frères Montfortains.
Le résultat de recherches toutes récentes
achèverait de démolir la thèse « bretonne » du Frère Augustin, s'il en était
besoin. Sur le registre d'inscription des Frères de Ploërmel
ne figure pas un seul nom
de la liste des sujets reçus au noviciat, du
Saint-Esprit, depuis l'entrée en charge du P. Deshayes, comme supérieur des
communautés de Saint-Laurent, jusqu'à la fin de 1821.
Enfin, si le P. Deshayes eût été capable de
partager la pensée du Fr. Augustin, il n'eût pas manqué, pour la souligner,
l'occasion des statuts de 1838, qui séparaient les Frères enseignants du reste
de la Communauté du Saint-Esprit. Or, il use, en les désignant, de l'appellation
traditionnelle : « Les Frères de l'Instruction Chrétienne du Saint-Esprit. »
[42]
Le Fr. Augustin mit une extraordinaire
application à faire converger sur cette image tous les éléments de sa thèse. On
y cherche en vain le chevalier de Marie, Grignion de Montfort, aux pieds de la
Dame de ses pensées : c'est maintenant le P. Gabriel Deshayes qui offre à la
Sainte Vierge le livre des Constitutions ; du coup, celui-ci prend l'envergure
et la solennité d'une Règle primitive. L'archange saint Gabriel, en emplissant
de ses ailes le fond de la composition, se trouve accomplir un message, à quoi
le céleste Messager ne s'attendait certes pas. L'inscription qualifie le P.
Deshayes de vicaire général de Vannes, ce qui tend, sans discrétion, à rappeler
la soi-disant origine bretonne de l'Institut. « M. Gabriel Deshayes, vicaire
général de Vannes et fondateur des Frères de Saint-Gabriel, offrant leur Règle
à Marie, leur Mère, par saint Gabriel, leur patron », telle est la
légende, qui en est bien une dans les deux sens du mot, et voilà prétendument
supprimée, par le jeu d'une gravure fantaisiste, une histoire d'un siècle et
demi. »
[43]
Le Fr. Augustin n'était pas, dans les mois qui précédèrent l'assemblée
générale, sans inquiétudes sur l'issue du scrutin qui en était l'objet. Il
procéda, auprès de personnalités de marque — Dom Fulgence, abbé de Bellefontaine,
le supérieur des Jésuites de Nantes et celui des Jésuites de Poitiers, — à des
consultations dont il fit état pour renforcer sa position. Favorables à la
désignation d'un Frère comme supérieur général de l'Institut, elles ne
portaient que sur ce point, le seul, dans la thèse du Fr. Augustin, qui fût de
quelque solidité. Au vrai, le Frère Augustin redoutait surtout que son
successeur, à la faveur du « complot », fût un missionnaire, ce qui aurait
renoué aussitôt la tradition montfortaine.
[44]
Il s'agit de quelques élèves, embryon du célèbre
pensionnat actuel, que le Fr. Augustin avait groupés à Saint-Gabriel dès 1840.
[45]
Depuis 1853, les Missionnaires avaient adopté la
dénomination « Compagnie de Marie » que leur avait désirée Montfort. En cette
année même, les Frères avaient abandonné celle de Frères de l'Instruction
Chrétienne du Saint-Esprit, de par la manœuvre du Fr. Augustin.
[46]
La première approbation légale, celle de 1823, n'avait
été sollicitée et obtenue que pour cinq départements : Vendée, Maine-et-Loire,
Deux-Sèvres, Vienne, Charente-Inférieure.
[47]
Le Frère Augustin pourchassait cette appellation
depuis longtemps. De quoi témoigne curieusement le registre des décès de Saint-Laurent.
Le 6 mai 1826, un Frère George Le Borgne étant mort à la Maison du
Saint-Esprit, le Frère Augustin, accompagné d'un autre Frère, se rend à la
mairie pour déclarer le décès. Il est huit heures du soir, heure à laquelle les
maires n'ont pas accoutumé de hanter encore leurs bureaux. Mais quoi! Le Fr.
Augustin ne s'embarrasse pas de tels obstacles quand il s'agit de pousser de
l'avant son dessein. Et le magistrat municipal, dérangé de son repos, d'écrire
sous la dictée du Frère Augustin : « L'an 1826, le 6 du mois de mai, à 8 heures
du soir, par-devant nous, Joseph Lhommèdé, maire de la commune de
Saint-Laurent-sur-Sèvre, ont comparu les sieurs Jean Eveno (Fr. Augustin),
frère de l'instruction chrétienne,
âgé de 28 ans, et Sochard,
frère de l'instruction chrétienne,
âgé de 22 ans, les deux domiciliés à Saint-Laurent,
lesquels nous ont déclaré que le 6 du présent mois de mai, à 6 heures du malin,
est décédé dans cette commune Georges le Borgne
frère de l'instruction chrétienne,
etc..
Ainsi, par trois fois, les mots
du Saint-Esprit,
qui complètent officiellement l'appellation des
Frères, sont supprimés. Et l'on remarquera la date : 1826, qui souligne
l'ancienneté des velléités séparatistes du Frère Augustin.
[48]
Les
passages de cette correspondance, ici reproduits, sont empruntés aux Mémoires
du Frère Augustin.
[49]
Le Frère Louis était « quelqu'un ». Il devait
connaître une juste renommée, comme directeur de l'Institution départementale
des Sourds-Muets de Nantes, où il fit merveille. Mais les titres éminents qu'il
s'est acquis dans ces fonctions n'empêchent qu'il était peu qualifié pour
prendre parti dans l'affaire des origines montfortaines. Il avait été reçu au
Sainte Esprit, non parmi les Frères, mais parmi les « Enfants de la Providence »,
que le P. Deshayes entretenait dans la maison commune. Quand il eut
17
ans, il fut envoyé à l'école de Châtellerault pour y faire ses études
primaires. Le P. Deshayes, qui avait été frappé de son Intelligence et de sa
sagesse, avait décidé d'en faire un professeur de sourds-muets. Il l'expédia en
cette qualité à l'Institution de Soissons, et comme il ne s'embarrassait pas de
formules, il fit revêtir à son protégé l'habit des Frères, sans qu'il eût même
fait son noviciat. Sous l'habit, il resta ce qu'il était : un « enfant de la
Providence », non un Montfortain. Il va de soi que, dans ces conditions, il
n'ait voulu reconnaître comme fondateur que le P. Deshayes, son protecteur,
auquel il devait tout.
[50]
Il ne pouvait, évidemment, se référer à cet
égard au P. de Montfort. Celui-ci d'ailleurs n'a pas laissé de code
pédagogique. Les règlements — dont quelques fragments seulement nous sont
connus par Grandet et Clorivière — qu'il a édictés pour les écoles de La
Rochelle, n'avaient rien qui lui fussent propres. Il appliquait simplement la
méthode de Mgr de la Poype, qui s'inspirait elle-même de celle de Charles
Démia.
[51]
Il est à noter que le Saint-Siège, par une lettre
de la Sacrée Congrégation des Evêques et Réguliers du 10 juillet 1901, avait
fait connaître que « pour éviter des conséquences très graves, il permettait, à
certaines conditions, que les Instituts non reconnus demandent l'autorisation.
» C'était, pratiquement, laisser les Congrégations libres de leur décision.
[52]
Les Frères savaient, au surplus, que les intérêts
diocésains étaient profondément engagés en cette affaire. Les écoles primaires
qu'ils dirigeaient étaient des écoles paroissiales.
[53]
En 1903, la situation générale se présentait ainsi
: la Congrégation de Saint-Gabriel était divisée en cinq provinces, dont trois
seulement — le Midi, le Centre et le Canada — étaient administrées par un Frère
provincial. L'Ouest et le Nord l'étaient directement par le supérieur général
et ses assistants.
Sous le coup de la persécution, la province du Nord
disparut, à l'exception des maisons de Tournai et Thuin. La province de l'Ouest
ne s'expatria pas, Maison-Mère et pensionnat étant situés dans le même
établissement, Mgr Catteau, en sauvant celui-ci, sauva celle-là. La province
créa la mission des Indes et envoya des Frères en d'autres postes à l'étranger.
La province du Midi se réfugia à San Remo, en
Italie, et y fonda un district, tout en gardant la charge de la mission
d'Abyssinie. La province du Centre émigra en Espagne et, de cette installation
fortuite, naquit une province nouvelle.
La persécution, qui éprouvait si rudement les
provinces métropolitaines, favorisa la province du Canada ; les nombreuses
recrues qui lui furent envoyées lui permirent d'étendre notablement son champ
d'action.
[54]
Déchargé de ses fonctions, le Frère Sébastien
rentra dans le rang avec joie et simplicité. Il accepta un professorat au
Scolasticat de la Mothe-Achard et mourut, avec sa piété coutumière, au début de
1938.
[55]
Ainsi flt-il paraître, dans l’
Ordo
du diocèse de Luçon, de 1878, une notice sur les Frères de Saint-Gabriel
qui commence ainsi : « Le développement de cette congrégation date de 1821. Sa
fondation remonte plus haut mais, jusqu'à cette époque,
elle avait
été peu nombreuse. Elle fut autorisée pour cinq départements, le 17
septembre 1823, sous le titre de
Frères de l'Instruction Chrétienne du Saint-Esprit.
Plus tard, l'augmentation considérable de ses
membres l'ayant obligée à quitter la Maison des Pères de la Compagnie de Marie,
avec lesquels elle avait demeuré jusque-là, elle changea son titre... » En
1879, l'ombre du Frère Augustin se faisant évanescente, le texte de l’
Ordo
était plus vigoureusement exact : « L'origine de cette congrégation remonte
au vénérable P. de Montfort. Avant 1793,
et
depuis, jusque vers 1821, elle ne se composa que d'un petit
nombre de
sujets,
etc. »
[56]
Le Frère Hubert eut d'autant plus de mérite à
affirmer une telle position qu'il eut, de ce chef, à subir, de la part du Fière
Louis, une opposition dont le caractère acerbe rappelle celle du Frère
Augustin. Opposition d'autant plus pénible qu'elle venait d'une personnalité de
l'Institut, vraiment éminente dans l'ordre de sa compétence. Malgré cela, il
n'employa ou ne laissa employer que deux ou trois fois le mot Fondateur, au
sens large, en parlant soit du P. Deshayes, soit du Frère Augustin ou même du
Frère Siméon.
[57]
Peu après, le 16 juillet, une circulaire du Frère
Hubert dégageait la question, en termes excellents, de tout malentendu : «
Sûrement, mes chers Frères, vos cœurs se sont réjouis de toutes ces solennités
qui, tout en exaltant notre Sainte Religion, glorifient un apôtre de notre
contrée, apôtre dont le tombeau est tout près de nous et dont notre vénéré P.
Deshayes est devenu le disciple et l'enfant en entrant dans sa Compagnie ; si
bien que notre congrégation a toujours été heureuse de se regarder comme ayant
un certain degré de parenté spirituelle avec le B. P. de Montfort : parenté
assez peu définie cependant et qui se confondait et se résumait.
« Cependant, il fut un temps où les principaux
Frères de notre congrégation, ceux qui, par leur position et leur ancienneté
dans l'Institut, étaient le plus à même de connaître notre origine, comme par
exemple le Très cher Frère Siméon, les chers Frères Abel, André, Denis, etc.,
et je pourrais ajouter le P. Deshayes lui-même, affirmaient de différentes
manières que nous descendons du P. de Montfort.
« Si, alors, cette affirmation n'a pas été soutenue, débattue publiquement,
ce n'a été que dans l'intérêt de la paix.
Et comme, à plusieurs points de vue, on pouvait
donner, et maintenant encore, au vénéré P. Deshayes les titres de Père et de
Fondateur, on se bornait à cela, évitant d'approfondir davan
tage la
question. Il en est résulté que des Frères assez nombreux, depuis bien des
années, n'ont pas eu à ce sujet d'autre croyance que celle-ci : le P. Deshayes
est notre Fondateur; le P. de Montfort est aussi pour nous quelque chose, par
la raison qu'il est mort à Saint-Laurent et que le P. Deshayes est un de ses
successeurs.
« A l'occasion de la
béatification de ce vénérable serviteur de Dieu, nous avons été tout
naturellement amenés à étudier cette question... »
Le Frère
Hubert fait ensuite un rapide mais net historique de la filiation montfortaine.
Il reproduit le testament^ mais le texte intégral, qui donne à cet historique
une base inébranlable, lui était alors inconnu, comme d'ailleurs des historiens
et du public. La ponctuation y est, par ailleurs, gravement défectueuse.
[58]
La
différend était déjà ancien; sous Mgr Soyer, évêque de Luçon, au temps du P.
Deshayes, il avait pris un tour assez vif. Le P. Deshayes avait même songé à
transférer la Maison-Mère des Filles de la Sagesse à Auray, pour la dégager de
l'ingérence de Mgr Soyer. Puis, il avait tenté de faire
approuver
à
Rome, à la fois l'Institut des Missionnaires et celui des Filles de la Sagesse,
afin qu'ils relevassent directement du Saint-Siège, en quoi il échoua. Les
relations, sur ce point,
restèrent
tendues, tant jusqu'à la fin
de l'épiscopat de Mgr Soyer, que sous ceux de Mgr Bailliès et de Mgr Colet,
prédécesseurs, au siège de Luçon, de Mgr Catteau. Ce type de conflits, entre
l'administration diocésaine et les instituts religieux, fut, comme on sait,
extrêmement fréquent au cours du
XIX
e
siècle.
[59]
Cette controverse, regrettable et pénible à tant de
titres, aura eu du moins l'avantage de provoquer les Frères de Saint-Gabriel à
une étude approfondie (dont, à vrai dire, ils ne s'étaient pas suffisamment
souciés depuis 1842), de leur filiation montfortaine. Et cette étude, pour être
faite d'un point de vue particulier, n'en a pas moins fait progresser
remarquablement l'ensemble de nos connaissances sur Montfort et son temps. Un
travail considérable reste à faire. Une bonne et complète histoire critique de
Grignion de Montfort n'existe toujours pas. La destinée posthume du grand
apôtre est aussi singulière que sa vie. Il a fallu sa béatification pour le
mettre en lumière, du moins auprès du grand public. Les manuscrits de ses précieux
ouvrages ont eu le sort le plus hasardeux. Rappelons que celui du
Traité
sur la vraie dévotion à la Sainte Vierge
fut découvert, par hasard, en 1842, « confondu avec
un grand nombre de livres tronqués » ! Faut-il ajouter que la controverse n'a
pas peu contribué à reléguer, dans l'ombre d'archives, jalouses de leur secret,
et où, d'ailleurs, ils sont encore, nombre de documents inestimables ?
[60]
Un des
historiographes de Montfort, l'abbé Quérard, a recueilli, sur la cause de cette
destruction, certains témoigna
ges
: « Le Père Deshayes,
écrit-il, ayant dit plusieurs fois à ses Frères qu'il avait ramenés de Bretagne
que cette Règle le gênait bien et qu'il ne savait comment réussir, à la rendre
pratique pour le but qu'il se proposait, c'en fut assez : l'un des frères
étrangers dut la soustraire et la jeter au feu. C'est ce qui nous a été attesté
par nombre de Frères. »
Vie du Père de Montfort.
tome
IV, page 617. Selon Quérard, le P. Deshayes trouvait la Règle primitive « trop
parfaite ».
[61]
Sur ce point, la lettre des Constitutions est
actuellement dépassée, comme il sera précisé dans le chapitre suivant.
[62]
Le
Frère Augustin prétendait que la vocation du P. Deshayes avait été « de
compléter celle du vénérable de la Salle, c'est-à-dire d'établir pour les
campagnes des instituteurs religieux, comme ce dernier l'a fait pour les villes
». On se demande comment le Frère Augustin a pu écrire ceci en 1838, alors que
lui-même reçut du P. Deshayes son obédience pour Montmorillon, qui n'est pas un
village, et que le même P. Deshayes avait fondé des écoles à Loudun, à
Châtellerault, à Paimbœuf. Ce qui est exact, c'est que, le P. Deshayes ayant
décidé qu'un Frère pourrait occuper isolément un poste, ce à quoi M. de la
Salle n'avait jamais pu se résoudre, la campagne, qui manquait de maîtres, était
largement ouverte aux Frères du Saint-Esprit; de ce fait, ils y affluèrent plus
particulièrement.
[63]
Après
avoir occupé d'autres postes — notamment Olonne pendant dix ans — le Frère Traséas
fut, de 1882 à 1912, directeur de l'école de Machecoul, où il mourut âgé de
quatre-vingts ans. C'était une manière de grand-père de cette importante
paroisse vendéenne. Tous les pères de famille machecoulais n'avaient-ils pas,
enfants, passé par ses mains ? II les avait instruits, formés selon les
plus antiques méthodes pédagogiques mais surtout de toute son âme qui était
celle d'un religieux parfait, observateur impeccable de sa règle. Très populaire
et aimé de tous, il était appelé, avec la plus affectueuse familiarité, « le
petit Père Tranquille ». Il n'était pas dans la ville un foyer où il ne fut
chez lui.
[64]
Il y a, dans le
Traité de la Vraie Dévotion,
un curieux passage où Montfort
semble avoir prophétisé cet abandon : « Je prévois bien des bêtes frémissantes,
qui viennent en furie pour déchirer, avec leurs dents diaboliques, ce petit
écrit et celui dont le Saint Esprit s'est servi pour l'écrire ou du moins pour
l'envelopper dans les ténèbres et le silence d'un coffre afin qu'il ne paraisse
point. » Certains ont cru discerner les Jansénistes dans ces « bêtes
frémissantes ». Il est certain que les Jansénistes n'aimaient point Montfort et
le lui ont fait sentir. Mais leur rôle, dans la vie du grand apôtre, a
certainement été exagéré. On voit mal aussi comment ils auraient, au cours du
XVIIIe siècle, empêché de
paraître le
Traité,
les Missionnaires ayant
certainement bien trop le courage de leur foi pour se laisser impressionner par
leurs clameurs. Le certain est que « les ténèbres et le silence » des coffres
ont eu toujours — ont encore — une mystérieuse et excessive prédilection pour
les documents montfortains.
[65]
Au
début du XXe siècle encore, le Frère Louis-Victor, religieux
d'éminente vertu, se plaignait que le
Traité de la Vraie Dévotion
ne fût
pas assez familier aux Frères.
[66]
Ce témoignage est consigné dans les premières
Chroniques de l'Institut des Filles de la Sagesse, rédigées par la sœur
Florence. Aux quelques rares extraits que nous en connaissons, nous pouvons
pressentir l'intérêt de l'ensemble, qui constitue, m'a-t-on assuré, une pile
imposante de cahiers manuscrits. Ces chroniques de la sœur Florence sont un des
documents auxquels fait allusion mon « avertissement » et dont je déplore de
n'avoir pu obtenir communication
.
[67]
Le Père Deshayes avait en outre tenté, mais sans
succ
ès, une fondation à Lourdes et une autre à La
Rochelle.
[68]
Sous ce titre, M. Louis Arnould, professeur à
l'Université de Poitiers, a publié un livre dont le succès a été grand et fort
mérité, non seulement par le sujet, mais par la façon consciencieuse dont il
est traité. Il s'agit des sourdes-muettes-aveugles, instruites à l'Institution
des Filles de la Sagesse. A Larnay, près de Poitiers. Sur Sœur Marguerite et
ses méthodes, il y a là une documentation remarquable. Un bref appendice à
l'édition de 1942 mentionne les cas de deux sourds-muets-aveugles à
l'Institution des Frères de Saint-Gabriel, à
Poitiers.
[69]
Surtout par
l'Enseignement logique de la langue française aux sourds-muets,
en usage actuellement dans toutes les écoles.
[70]
Actuellement,
sur quarante-quatre institutions de sourds-muets, trente-sept sont fédérées;
sept seulement, dont les quatre institutions nationales, ne le sont pas. Sur
vingt-neuf établissements pour aveugles, dix-neuf sont fédérés; dix, dont une
école nationale, ne le sont pas.
3. Ce que les Frères do
Saint-Gabriel font pour les garçons, les Filles de la Sagesse le font, avec une
égale maîtrise, pour les filles. Elles ont même, dans l'instruction des
sourdes-muettes-aveugles, la gloire de l'initiative.
[72]
Pendant la guerre
1914-1919, toutes les Institutions de Sourds-Muets de Saint-Gabriel devinrent
des centres de rééducation pour les soldats devenus aveugles, muets, sourds,
aphones ou bègues.
Cette précieuse
expérience a permis au Frère Amance de publier La lecture sur les lèvres aux soldats devenus sourds, et au Frère Chrysogone
: La rééducation auditive, des sourds de guerre.
L'un et l'autre auteurs étalent, comme le Frère Coissard, du centre de Nantes.
Dans cette même catégorie de publications, il faut ranger le Manuel pratique de lecture labiale par
le Frère Vincent du centre d'Orléans.
[73]
Ainsi :
Méthode des exercices méthodiques du Dr Jousset,
partie pédagogique en collaboration avec le Docteur
Jousset (1900) ;
Statistique des établissements de sourds-muets; L'enseignement de la phrase
par la vue,
en six tableaux muraux;
Carte murale des Institutions de Sourds-Muets de France et des Colonies
(honorée d'une lettre de félicitations de M. le
ministre de l'Intérieur);
Collection d'instruments pour la correction des troubles de la parole, et
la démutatisation du jeune sourd-muet; La lecture sur les lèvres
(Bulletin international de l'enseignement aux
sourds-muets;
Enseignement de la pa
rôle aux sourds-muets (Ibid.) ; Comment on doit
parler aux sourds pour leur faciliter la lecture labiale; Les troubles de la
parole chez les enfants atteints de fissures velo-palatines
(bec de lièvre).
En un catalogue dactylographié, dont on
souhaiterait la publication, le Frère Benoît du Pont-Coissard a groupe wus le
titre
Laboratoire de la Parole,
les dessins de ses appareils (H en est quatorze) avec explications
détaillées
.
[74]
Notons une fois pour
toutes que l'on ne peut jamais dire que telle méthode a été inventée, au sens
rigoureux du mot, à telle date et par tel ou tel. Méthode mimique, méthode
mixte, ou mieux, méthode orale, dite pure, ont été, plus ou moins sommairement,
employées depuis des temps lointains. En ce qui concerne cette dernière,
adoptée par le Congrès de Milan en 1880, on peut même dire q
ue,
apparemment
la plus récente, elle répond à une préoccupation et à des expériences fort
anciennes, puisqu'on en trouve trace jusque dans le XVIe siècle. Au XVIe
siècle, Pedro Ponce de Léon écrivait déjà : « L'enfant sourd étant pourvu
d'organes phonateurs semblables à ceux des autres enfants, il est possible et
il convient de lui enseigner la parole. » Et, joignant l'exemple au précepte,
il organisa un enseignement régulier, basé sur la parole. L'abbé de l'Epée, par
la prépondérance donnée à la mimique, par la réputation qu'il acquit
légitimement à d'autres titres et dont la méthode mimique bénéficia, a freiné
plutôt que servi le progrès de la technique pédagogique.
Quand il est question
des trois grandes méthodes et de leurs dérivés divers (telle la
phono-dactylologie du Frère Bernard), il s'agit donc, non d'inventions à
proprement parler, mais de mises au point, de perfectionnements et d'innovations
de détails qui, régulièrement et collectivement pratiquées, prennent
l'importance et ont l'envergure d'une création.
[75]
Les Frères de Saint-Gabriel ont composé nombre d'ouvrages
sur la pédagogie des sourds-muets. Ils ont même été les premiers a publier sur
l'enseignement de la langue française un livre essentiellement classique et
complet. La
Méthode d'enseignement pratique
du Frère Anselme (1853), avec une partie du maître et une partie de
l'élève, représentait à l'époque une innovation. En 1870, paraissait la
Nouvelle méthode d'enseignement pratique de la
langue française,
par le Frère Emmanuel Dieudonné, qui rééditait, revue, corrigée et
considérablement augmentée, la
Méthode
du Frère Anselme. En 1900, vint le magistral et classique ouvrage, en
quatre volumes, du Frère Lemesle :
l'Enseignement logique de la langue française aux Sourds-Muets,
et, en 1900 encore,
l'Enseignement pratique de la langue française
(Notions graduées de grammaire et de style), par le
Frère Robert, directeur de l'Institution de Toulouse.
Le Manuel du jeune Français,
du Frère Savinien, et les travaux, déjà cités, du
Frère Benoît du Pont-Coissard, complètent l'importante contribution de
Saint-Gabriel à la Bibliothèque pédagogique des Sourds-Muets.
[76]
En
1824,
un sourd-muet de grande valeur, de grand cœur, M.
René Dunan, ancien élève de l'abbé Sicard, avait groupé dans son modeste
domicile de la rue Crébillon, à Nantes, une demi-douzaine de sourds-muets des
deux sexes. La municipalité s'intéressa à cette école, la subventionna, puis,
d'accord avec le conseil général, l'installa en 1834 à l'Hospice
Saint-Jacques. En 1843,
les sourds-muets de la Chartreuse d'Auray, conduits par le Frère Ildefonse, un
de leurs professeurs, émigraient à Nantes, fusionnaient avec les sourds-muets
du groupe Dunan, tandis que les sourdes-muettes de ce dernier groupe allaient
rejoindre leurs consœurs de la Chartreuse d'Auray. Telle fut l'origine du
magnifique établissement nantais d'aujourd'hui.
[77]
Le sourd-muet souffre-t-il de son infirmité ?
J'ai posé la question au Frère Coissard : « Plus ou moins, m'a-t-il
répondu. Beaucoup, si sa surdité est acquise. Si sa surdité est de nais
sance, il en souffre moins. On ne souffre pas d'un
bonheur ignoré. » Le célèbre sourd-muet Massieu, qui fut directeur de l'école
de Lille, a raconté de son enfance quelques traits qui révèlent, avec l'appétit
du savoir, la souffrance secrète : « Les enfants de mon âge ne jouaient pas
avec moi ; ils me méprisaient. J'étais comme un chien ; je voyais de jeunes garçons
qui allaient à l'école ; je désirais les suivre et j'en étais très jaloux. Je
demandais à mon père, les larmes aux yeux, la permission d'aller à l'école. Je
prenais un livre, je l'ouvrais du haut en bas pour marquer mon ignorance. Je le
mettais sous mon bras comme pour sortir ; mais mon père me refusait. On me
faisait signe que je ne pourrais jamais rien apprendre parce que j'étais
sourd-muet ; alors je me désolais et je criais bien haut. Un jour, je sortis et
j'allai à l'école sans le dire à mon père ; je me présentai au maître, je lui
demandai par signes de m'apprendre à lire et à écrire. Le maître me refusa
durement et me chassa de la classe. Cela me fit pleurer beaucoup, mais ne me
rebuta pas. Tout seul, j'essayai de former avec une plume des signes
d'écriture. »
[78]
C'est ainsi, par exemple, que pour les temps du verbe, le
futur
sera indiqué par une triple opération, indéfiniment répétée. S'agit-il de :
je sauterai?
Le bâton de craie entre en action (nulle part il ne
sert autant qu'ici, « La meilleure classe, dit un axiome des Frères, est
celle où l'on dépense le plus de craie. ») Ces mots sont écrits au tableau;
l'élève les lit sur les lèvres du professeur qui les articule très visiblement ;
enfin, celui-ci, monté sur une chaise, exprime par gestes qu'il ne saute pas
maintenant, mais sautera « tout à l'heure ». Et
bientôt tous les élèves répéteront « je sauterai », l'écriront et, exerçant l'action eux-mêmes, montreront qu'ils ont compris.
bientôt tous les élèves répéteront « je sauterai », l'écriront et, exerçant l'action eux-mêmes, montreront qu'ils ont compris.
[79]
Dans son rapport au premier congrès de la
Fédération (1926), le Frère Benoît du Pont-Coissard notait : « Tout en
cherchant à Instruire nos sourds-muets le plus complètement possible, afin
qu'ils soient ensuite mieux en état de se suffire, on n'a nullement la
prétention d'en faire des bacheliers. La durée si restreinte des études ne
permet pas de viser si haut ; 7 ou 8 années sont à peine suffisantes pour
inculquer aux sourds-muets l'ensemble de ce qui constituera leur petit bagage
intellectuel à leur entrée dans la vie... D'autres institutions vont plus loin
et, malgré les tendances contraires des Ecoles nationales, plusieurs de nos
institutions fédérées persistent à présenter chaque année quelques-uns de leurs
élèves au certificat d'études (
officiel),
au certificat complémentaire, et même au brevet. »
[80]
Harassés par une année
scolaire, réclamant, on l'a vu, une tension exceptionnelle, les professeurs
doivent s'accorder un repos qui ne permet pas encore une organisation complète
et rationnelle de cours de vacances.
[81]
Ces dictées ne contenaient
aucune
faute d orthographe. Sur ce point, le sourd-muet surclasse l'enfant normal.
C'est qu'il apprend le mot par les yeux, non par les oreilles ; l'orthographe
d'un mot, écrit au tableau, s'inscrit ineffaçablement dans sa mémoire visuelle,
remarquablement développée.
[82]
L'institution de Poitiers a été fondée en 1837,
Elle est la seule, non seulement des Institutions de la Fédération, mais de
toutes celles de France (à l'usage des garçons) à posséder une section de
sourds-muets-aveugles, ce qui lui donne un rang éminent... En 1883, une belle
construction neuve, aux dégagements spacieux, largement ouverte à la lumière,
pourvue d'une grande chapelle, s'est adjointe aux bâtiments anciens. Il y
manque malheureusement ces vastes espaces, emplis d'arbres bruissants, dont les
Frères de Saint-Gabriel aiment à donner à leurs œuvres le précieux bénéfice. Je
vois bien de vastes préaux de récréation, un potager suffisant pour permettre
des leçons d'horticulture. Mais me voilà loin des beaux jardins de la
Persagotière ! La ville envahit ces horizons.
[83]
Je l'ai vu en effet, avec une admirative
stupéfaction, parcourir de la main l'ensemble d'un énorme globe terrestre, où
les pays du monde figurent en saillies, les fleuves et les mers en creux. Avec
aisance, sa mémoire ne fléchissant jamais, il nommait les capitales, les
grandes villes, les régions, situant impeccablement les grands événements
passés et présents de la guerre (j'ai visité l'Institution au début de 1945),
la situation des diverses armées en présence. A cette démonstration
géographique, il joignait ses souvenirs de lecture, parlant par exemple de
saint François-Xavier à propos de la Côte de Coromandel qu'il évangélisa.
[84]
Sur les quatre autres sourds-muets-aveugles
de l'Institution, deux voient un peu; le troisième, sourd-muet de naissance,
n'est aveugle que depuis l'âge de neuf ans ; le quatrième, âgé de trente ans,
est devenu progressivement aveugle. Il a été instruit avant d'être complètement
privé de la vue. Leurs cas, si remarquables soient-ils, sont donc moins
significatifs que ceux de Richard et de Bernard... Cependant, deux d'entre eux
ont fait, à l'atelier de rempaillage des chaises, mon admiration. Avec quelle
dextérité et de quel rapide mouvement les pailles ne sont-elles pas allongées
sur le cadre du siège, ployées, entrecroisées selon l'ordre impeccable d'un
dessin géométriquement colorié ! Pas une erreur dans la répartition des jaunes,
des verts, des bleus ou des rouges. Nous interrompons l'un de ces maîtres
artisans, Lafon, et le voilà qui, avec des gestes de la plus amusante
volubilité, nous raconte des histoires qui doivent être fort divertissantes, à
en juger par sa figure épanouie. Ainsi, « bonne ouvrage », comme dit notre
vieux peuple de chrétienté, métier bien fait et joie du travail, joie de vivre,
qu'accroît une cigarette opportune, voilà le don fastueux d'une intelligente et
fraternelle charité à ceux qui, sans elle, seraient les plus malheureux des
hommes, le déchet du monde.
[85]
La Vendée militaire,
qui forme une région morale d'une parfaite homogénéité, déborde largement la
Vendée départementale, très artificiellement tracée. Elle englobe les « pays »
de Retz, du Marais, du Bocage, du Leroux, de la Plaine, de la Gâtine et des
Mauges, donc une partie de la Loire-Inférieure, des Deux-Sèvres et du
Maine-et-Loire, en sus de la Vendée départementale. Sa limite est, ai: nord-est
la Loire, à l'est le Thouet, au sud une ligne idéale passant par Fontenay-le-Comte
et Luçon, à l'ouest l’océan.
[86]
Nulle politique en tout cela. Les Frères de
Saint-Gabriel savent que l'épopée vendéenne fut une épopée de la Foi. Pas un
historien sérieux n'y contredit.
[87]
Sauf très rares exceptions, la noblesse de la
région n'envoie pas ses enfants à Saint-Gabriel. Elle tient à ce qu'ils fassent
leurs Humanités. Or le latin est exclu de l'enseignement de Saint-Gabriel qui
est celui du secondaire moderne.
[88]
Je me fais un scrupule d'ajouter que, depuis que
ces pages ont été écrites, le Frère G. M... m'a précisé crue, dans sa pensée et
celle de ses confrères, sa forte réserve sur certaines conséquences, morales et
sociales, de l'humanisme classique, vient non d'une hostilité de principe mais
d'une constatation de fait et qu'elle est applicable à la seule clientèle du
pensionnat de Saint-Laurent. Sur un terrain ainsi réduit, je me mettrais vite
d'accord avec lui mais je garde l'impression — qu'il m'en excuse ! — que
l'habitude d'un « humanisme sans latin » détermine à la longue ici,
à certains égards,
quelque prévention, à mon sens injustifiée, à
l'endroit d'un Humanisme classique considéré en soi et, si j'ose dire,
ad usum infidelium.
[89]
L'influence du maître s'augmente encore de ce
que, jusqu'en troisième, il n'est que deux professeurs par classe, un pour les
lettres, un pour les sciences. Plus nombreux, les influences des professeurs se
heurtent souvent.
[90]
Un exemple récent : en 1944,
sur quarante et un candidats au brevet, quarante et un furent reçus dès la
première session.
[91]
Ce premier essai fut de courte durée. Trop
fraîchement arrivés au Canada, ces Frères no pouvaient être suffisamment au courant
des méthodes commerciales en ce pays. On jugea que mieux valait appliquer ces
Frères aux petites écoles, d où l'on pouvait attendre de plus nombreuses vocations.
En 1892, Saint-Gabriel abandonnait le collège de l'Assomption.
[92]
St Johnsbury est la seule école que les Frères
aient dirigée aux Etats-Unis. Cette petite ville de 10.000 âmes était habitée,
pour un bon tiers, par des Canadiens français. Le reste de la population,
américaine et protestante, s'entendait fort bien avec elle; les uns comme les
autres estimaient et aimaient les Frères. Un incident sans portée, mais que le
caractère difficile du curé de St Johnsbury aggrava, provoqua le rappel des
Frères et la fondation fut abandonnée.
[93]
Le rapide succès et
le développement qui s'ensuivit doivent beaucoup au très précieux et généreux
appui que ces frères trouvèrent, dès leur arrivée, chez les Sulpiciens. Ces «
Messieurs de Saint-Sulpice », établis depuis longtemps au Canada et qui y
disposaient d'une influence considérable et men justifiée, accueillirent de
tout leur cœur les Fils de Montfort. Pendant une bonne dizaine d'années, sans
qu'on se souciât de part ni d'autre de la controverse qui, à Saint-Laurent
grossissait son tonnerre, les Pères du Saint-Esprit, installés au Canada depuis
1883, et les Frères de Saint-Gabriel, vécurent dans la plus familiale entente
et se portèrent réciproquement un soutien chaleureux. Puis les nuages, portés
par un vent maléfique, franchirent l'Atlantique et firent écran au grand regret
des Frères, entre les deux groupes montfortains du Canada.
[94]
Les curés canadiens ont joué, dans le Canada
de langue française, un rôle immense et bienfaisant. En 1760, tous les hommes
formant les cadres du pays vieux français furent expulsés par les Anglais, sauf
les curés. Et ce sont ceux-ci qui ont sauvé et maintenu la culture et la langue
françaises, terrain sur lequel bien vite, à l'exclusion de la politique, s'est
circonscrite la lutte. Ce sont eux qui, peu à peu, ont élevé le niveau social
et, sans cléricalisme, fait le pays ce qu'il est.
[95]
Depuis, les novices ont quitté le Sault-en-Récollet pour Sainte-Geneviève.
D'autre part, la séparation a été réalisée, au Canada comme en Europe, entre juvénat,
noviciat, scolasticat.